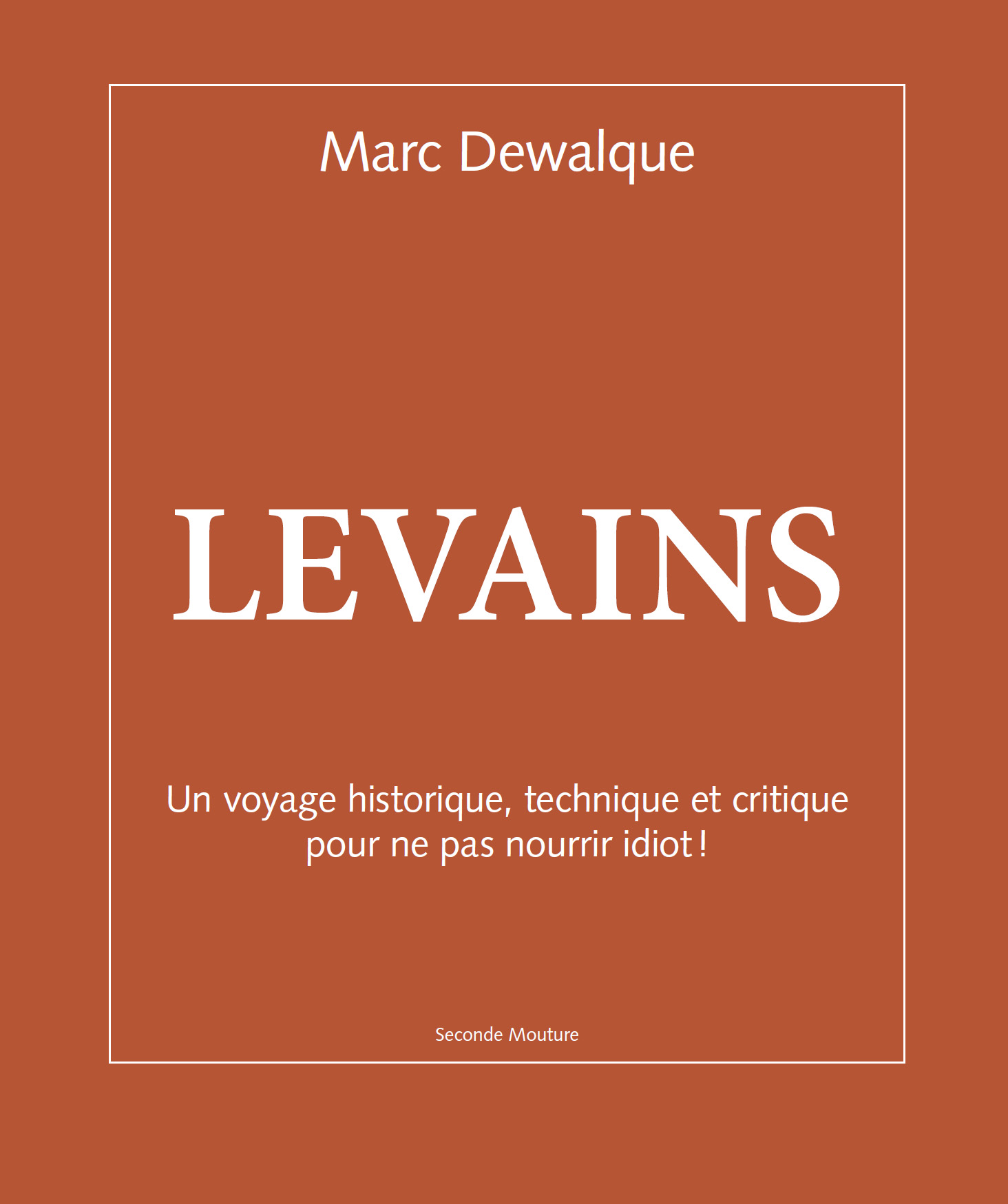Chapitre XXIV. Travailler autrement ?
Ce chapitre est un peu la postface du livre. On peut le voir comme le vestige de l’ambition originelle qui présidât à l’élaboration de celui-ci. Nous voulions une rédaction assumée collectivement, hélas, les vicissitudes de la vie en ont décidé autrement. L’espoir est de présenter dans ce dernier chapitre le fruit de nos vécus et de nos réflexions autour de la boulangerie en tant que profession.
XXIV.1. Artisan ou industriel ?
Dans le projet, il faut que l’âme de l’artisan rayonne dans les heures de travail. D’autant qu’il est aussi inutile d’espérer concurrencer l’industriel. Un exemple, extrait de ma carrière, j’ai fait des millions de petits pains (pistolets) en 35 ans de vie professionnelle de boulanger, je suis fier de la prouesse. Mais l’industriel belge a lui réalisé le même score en quinze semaines seulement[1], c’est dire qu’il vaut mieux ne pas se mettre à rêver trop de ce côté et que quantité et qualité doivent pouvoir se différencier.
XXIV.2. Justifier son prix !
Lorsque l’on veut fabriquer un bon pain, il faut pouvoir en justifier le prix. Et là, il nous faut, pour voir l’avenir, être gestionnaire en plus des qualités techniques professionnelles. La prise en compte de notre salaire de manière justifiée est possible. L’inquiétude de demander « trop » ou « trop peu » peut se soigner par une méthode dénommée « Calcul du prix de justifié ». Connaître ce que l’on gagne ou paye à l’heure et par la même occasion, vérifier sa rentabilité horaire qui est le point approché par cette méthode.
Il s’agit plus d’approcher sa propre rentabilité horaire, que la rentabilité de la matière première ou on applique arbitrairement un multiplicateur (XVI.5).
C’est plus complexe, puisque cette méthode consiste à reprendre dans un calcul, le prix des matières premières mise en œuvre, auquel s’ajoute le salaire du temps passé à la production du produit. Le total des deux résultats (formant les frais variables) est alors multiplié par un coefficient de ses frais fixes. C’est à dire les frais de vente de gestion, loyer, entretien et chauffage, etc. qui ne changent guère si l’on produit 10 ou 300 pains, que l’on sait établir soit ; par des estimations données par la fédération (estimée à plus ou moins 50/50 dans le cas d’une production artisanale avec vente comptoir du matin au soir).
| fig.1. Schématisation du calcul du prix de revient justifié | ||
| Suivant l’exemple d’un chiffre d’affaires de 1.000.000 € | ||
| Prix de revient total (sans T.V.A) | ||
| Bénéfice | Frais variables | Frais fixes |
| Matières premières + Main d’œuvre de production | Frais généraux
Frais ne changeant pas lors de la production |
|
| 30.000 € | 520.000 € | 450.000 € |
| Calcul du coefficient ou clé de répartition entre frais variables et frais fixes | ||
| 520.000 + 45.000 = 970.000 (prix de revient total) | ||
| 970.000 divisé par 450.000 = 2,155 | ||
| 100 divisé par 2,155 = 46,39 % de frais fixes à ajouter aux frais variables | ||
Soit le calcul se réalise de manière plus personnelle, grâce à la ventilation des frais généraux en frais fixes et variables établis par sa déclaration annuelle qui permet de vous donner un coefficient spécifique.
C’est un gros travail d’entrées de données dans un tableur. Pour les adeptes de l’informatique qui y croient, l’argument du gain de temps est important. Les nombreuses simulations évitent les mises à jour fastidieuses, de nouveaux formulaires et l’automatisation des calculs permettent aussi de gagner du temps. Tout cela devrait pouvoir confondre les sceptiques de l’ordinateur. Enfin prenons par l’exemple, les avantages ou précisions économiques que peut permettre ce calcul du prix de revient.
Laisser tomber ou ne pas « pousser » tel article ou activité et miser sur la production d’un autre.
Exemple : beaucoup de recettes reçues en successions répétées de ses parents ne tenaient pas compte de cette donnée qui a fort évolué dans nos sociétés : le prix de la main d’œuvre. Exemple type, la tarte aux pommes épluchées et coupées en lamelles bien rangées en spirale sur fond de tarte tapissé de broyage est un aperçu chiffré très parlant en coût salarial.
Cela permet de voir ce que coûtent les petites productions.
Exemple 1 : Il s’agit de comparer par simple simulation informatique en changeant une ou deux données, la main d’œuvre sur une petite production et sur une grande production d’un même produit. Là encore, ce calcul fait parler les chiffres.
Exemple 2 : La pâtisserie autrefois glorifiée pour le prix de vente qu’elle permettait est l’exemple type du produit qu’il faut revoir sous l’éclairage du rendement horaire. C’est souvent des petites productions engendrant beaucoup de frais indirects (plus de vaisselle et d’entretien) et plus de préparations différentes.
Faire des choix sur les poids ou les ingrédients des recettes et d’en voir les retombées économiques.
Mais attention, à la qualité ! Il ne faut pas tomber pas dans le travers de la compression des prix d’achat en touchant à la qualité des matières premières. Par contre souvent le calcul du prix de revient a permit de relativiser l’incidence toujours moindre du prix de la matière première, ce qui permet de remarquer qu’une meilleure valorisation du travail agricole a une faible incidence sur le prix de revient justifié. Faites des simulations, vous le constaterez.
Remarquer qu’une réduction de main-d’œuvre à tel ou tel poste peut être rapidement remboursé par l’emploi de machine ou par des processus plus rapide et ainsi libéré du temps pour d’autres tâches ou engagements. Attention encore une fois au savoir-faire, il faut le favoriser plus que le dévaloriser. Par exemple, le travail au levain est plus fastidieux que le travail à la levure (XIX.5). Lorsque l’on parle de rationalisation de main-d’œuvre, on pense ici vaisselle, entretien, enfournement au tapis plutôt qu’à la pelle. Toucher aux recettes et aux méthodes, c’est aussi toucher au résultat et à la qualité de vos heures de travail (être heureux dans ses heures de travail est important).
La qualité de la matière première et de la main-d’œuvre, il faut y réfléchir à deux fois, car une dérive qui s’amorce se propage insidieusement souvent pour longtemps. Bref, cette approche économique du prix de revient justifié peut permettre de soigner ses faiblesses et de renforcer ses points forts.
Voilà pourquoi on considère important, d’au moins s’en informer en prenant pour une fois, le temps d’y réfléchir. Ces quelques heures de pause dédiées à la réflexion sur les aspects économiques seront probablement les plus rentables au cours d’une carrière professionnelle.
XXIV.3. La certification bio, plus d’échecs que de victoires ?
Sans vouloir ici dénigrer les collègues qui travaillent en bio, nous le faisons tous pour des raisons différentes. Pour notre part, on a toujours vécu la certification comme une contrainte et un aveu d’échec politique dans le sens grec du terme. Si l’on se passe de cette certification, c’est à coup de marketing qu’il faut assommer le client. Cela peut être une contrainte parce qu’elle permet d’ouvrir des marchés dont on a parfois un besoin vital (épiceries bio, cantines d’écoles, magasin de producteurs, etc.). Notons l’absurdité du processus en lui-même, qui consiste essentiellement pour le certificateur à contrôler des factures et des étiquettes, d’avoir de plus en plus de difficulté à assurer une traçabilité[2]. Peu importe par ailleurs, comment tout cela est transformé, avec un contrôle sur l’ajout d’enzymes recombinées ou pas (XVI.10 à comparer avec XVI.11) et dans quelles conditions de travail. La bio industrielle distribuée en grande surface n’est évidemment plus un marché de niche, on sait que sa croissance ne cesse d’émerveiller les investisseurs du secteur dans un marché agro-alimentaire plus que saturé.
La certification bio est surtout un aveu d’échec parce qu’elle manifeste l’impossibilité de relations de confiance, donc de proximité, entre les producteurs et les consommateurs. Les cahiers des charges et la traçabilité n’ont de sens qu’à partir d’une certaine échelle de production, de transformation et de distribution, elles n’en ont aucun dans le cadre d’une véritable économie locale, en face à face. Il est bien évident que l’industrie agro-alimentaire a besoin de tels outils de communication pour rassurer sur leurs lasagnes aux diverses viandes d’origines nébuleuses, par exemple. De tels outils de contrôle servent pour se retourner contre un intermédiaire bouc-émissaire lorsqu’un scandale quelconque éclate.
Mais faut-il aller jusqu’à militer contre la certification bio et en arriver à épaissir le doute sur cette façon de produire ? Gros débat de société ou il reste plus qu’anachronique que celui qui veut produire sain soit pénaliser par le coût de contrôle supplémentaire et que la production s’autorisant des interventions d’agrochimie soit favorisée économiquement. Il est clair que l’incitant s’inverse là !
XXIV.4. Le travail de nuit difficile à abroger.
Autre débat sociétal d’avenir, pourquoi travailler la nuit ?
On explique d’ordinaire le travail de nuit par la concurrence qui aurait poussé les artisans à avancer l’heure de la pétrissée pour proposer le pain frais toujours plus tôt. La lecture de Malouin[3] laisse penser qu’en ville, la forte demande poussait les boulangers et les fourniers à enchaîner les fournées pour que les fours ne refroidissent jamais. On sait cependant qu’au Moyen Âge déjà, les seigneurs punissaient d’amendes les sous-utilisassions et la non-fréquentation des fours banaux.
Nous ne nous risquerons pas ici à donner dans la généralisation ; suivant les époques et les lieux, les conditions de travail varient du tout au tout. D’après une complainte de la fin du xviiie siècle[4], les garçons boulangers de Paris connaissaient par exemple un sort bien moins enviable que leurs comparses des villes limitrophes de la capitale. Dans la capitale, les ouvriers enchaînent les fournées et vont souvent livrer les clients avant de goûter un court repos et reprendre le travail en soirée. À l’époque, le travail de nuit n’avait pas ce caractère d’évidence qu’on lui prête largement dans la profession aujourd’hui. Il fallut attendre le soulèvement de la Commune de Paris en 1871, pour que cette pratique soit brièvement abolie[5].
Un ouvrier de Toulon rapporte en 1909 : « Dès sept heures du soir l’ouvrier va prendre son travail et cela sans entrain, sans vigueur, aussi fatigué et abattu que le matin, et tandis que les autres travailleurs vont se reposer, lui, le paria de la société, s’enferme dans un atelier, dénommé gloriette, taudis infect ayant une température de 30 à 35 degrés de chaleur, sans air, éclairé bien souvent par une lampe à pétrole dont la fumée âcre vous étouffe et vous prend à la gorge. Tout est répugnant dans ces ateliers jamais nettoyés, où sont entassés pêle-mêle, tous les ustensiles servant à la panification ; les uns sont couverts de poussière, les araignées tissent leurs toiles, les cafards s’y multiplient, les mouches y abondent, l’eau nécessaire au pétrissage est bien souvent dans des baquets qui se nettoient une fois le mois. Voilà l’endroit où l’ouvrier boulanger tout nu, ruisselant de sueur, râlant, gémissant, se débattant sur un morceau de pâte et cela, pendant huit à dix heures consécutives respirant à pleins poumons un air corrompu[6]… ».
Un secrétaire du syndicat des ouvriers boulangers de Paris a écrit : « Nous devons convaincre les ouvriers boulangers des avantages du travail de jour. Cela vous étonne qu’ils n’en soient pas convaincus ! C’est que plus d’un est aussi routinier que son patron, qu’il ne voit pas la cause du mal qui ronge notre corporation, et que, même s’il la voit, il n’a ni la volonté, ni la confiance nécessaire pour lutter[7] » ( XVIII.2).
Pourquoi, de nos jours encore, travaille-t-on la nuit ? La raison n’a pas varié depuis le Moyen Âge : pour que le pain soit disponible le matin, aussi frais que possible. On aurait pu penser que cet impératif s’est imposé avec la généralisation du pain à levure, qui rassit nettement plus vite. Il n’en est rien, même lorsque l’on consommait des pains volumineux fermentés sur levain, la fraîcheur était très recherchée.
Voilà qui nous laisse face à une poignée de choix : travailler avec le froid positif (XVII.6) ou pétrir la veille avec moindre ensemencement de ferments (XVII.7) pour vendre à des heures matinales. Ou alors travailler en direct et se résoudre à vendre l’après-midi. Les trois choix ont leurs mérites, le second présentant l’avantage de se dispenser de l’achat d’unité frigorifique et de réduire les dépenses énergétiques du fournil, mais exige une maîtrise technique de l’ambiance du temps de fermentation et de se tenir au courant de la météo. Reste que dans le troisième cas, tandis que certains clients sont aisément convaincus de changer leurs habitudes, d’autres refusent catégoriquement de fréquenter un fournil fermé le matin.
Espérons en tout cas que les nouvelles générations de boulangers mettront toujours plus un terme au travail de nuit qui n’a vraiment pas de raison valable de perdurer.
XIV.5. Quelle forme sociale pour entreprendre ?
EURL, SARL, SA, etc., soit de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée jusqu’à la bien nommée responsabilité qui se dilue dans l’anonymat ( la S.A.) et bien peu susceptible d’éveiller des responsabilités autre que la rentabilité des actions face aux défis environnementaux qui devrait réguler la pratique économique et énergétique.
Presque à l’opposé au niveau économique et sociétale, se situe l’engagement commun (vendeurs et acheteurs) en membre d’association 1901 où tout le monde « peut être associé aux décisions » où l’entreprise est sans but lucratif. Ce qui est souvent limite face aux obligations légales des entreprises. Le vécu de l’ami Daniel a débuté sous cette forme pour se muter en microentreprise individuel (MIC) sans que la relation client/boulanger n’en souffre[8]. Il faut dire qu’il faut probablement entretenir une relation de projet commun par un blog, des feuilles de contact ou d’informations sur le produit et l’origine des matières premières.
Les réelles coopératives (une personne = une voix) ont également plusieurs expériences, surtout sous la forme en France des Scoop ou en Belgique ou de sociétés coopératives à finalité sociale. Pour retourner au vécu afin de mieux cerner leurs limites, on y relève souvent des difficultés au niveau de la stabilité des personnes engagées, mais aussi d’impressionnants vécus. Comme les bénéfices y sont limités par la loi, le réinvestissement obligatoire de ceux-ci dans l’entreprise occasionne souvent une forme saine d’engagement financier. La formule mériterait un effort collectif et en réseau pour les faire maturer cet esprit d’entreprendre à plusieurs et de manière solidaire et les difficultés dont ce type d’entreprise doit faire face.
Lorsque l’on reprend le vécu d’une forme de vie communautaire qui a un vécu de longévité avérée, on doit reconnaître que la vie de communauté religieuse l’a réalisé.
Et on n’hésite pas alors à reprendre les paroles du père de l’abbaye Saint-Sixte de Westvleteren propriétaire d’une brasserie qui est une association sans but lucratif. Il écrit : « Comme tout être humain, nous devons disposer de moyens de subsistance […]. Bien sûr nous devons vivre de et avec notre brasserie. Mais nous ne vivons pas pour notre brasserie. Il n’est d’ailleurs pas étonnant que nous puissions paraître étranges pour les gens qui sont dans le monde des affaires et ne comprennent pas que nous profitions si peu des possibilités commerciales offertes par rapport à ce que nous pourrions obtenir. Je pense parfois que notre attitude agace même certaines personnes. Je suis personnellement convaincu qu’il serait dommage qu’il en soit autrement. Nous ne sommes pas des brasseurs. Nous sommes des moines, et pour pouvoir l’être, nous fabriquons de la bière. »
Du coup, il est important également de ne pas laisser le client définir la demande et faire peser sur l’offre votre signature ou votre projet de ne pas nourrir idiot (X.21).
- Émission RTBF « Question à la une » thème « Artisanal ou industriel, où est passé le bon pain ? » du 27-11-2013. ↑
- Agathe Mahuet, le 06-04-2012. ↑
- P.-J. Malouin, 1767, p. 12-13, 307-308 et 343-344. ↑
- Les misères de ce Monde ou complaintes facétieuses sur les apprentissages de différents Arts et Métiers de la Ville et Faubourgs de Paris, Paris, 1783, p.153. ↑
- Site : https://macommunedeparis.com/2018/08/06/le-travail-de-nuit-des-boulangers-a-paris-1869-70/ ↑
- Justin Godard, p. 38-39. ↑
- Justin Godard, p. 44. ↑
- Daniel Testard, Que fais-tu là boulanger ?, 1985, p. 14-15; Où vas-tu d’un si bon pain ?, 1994. ↑