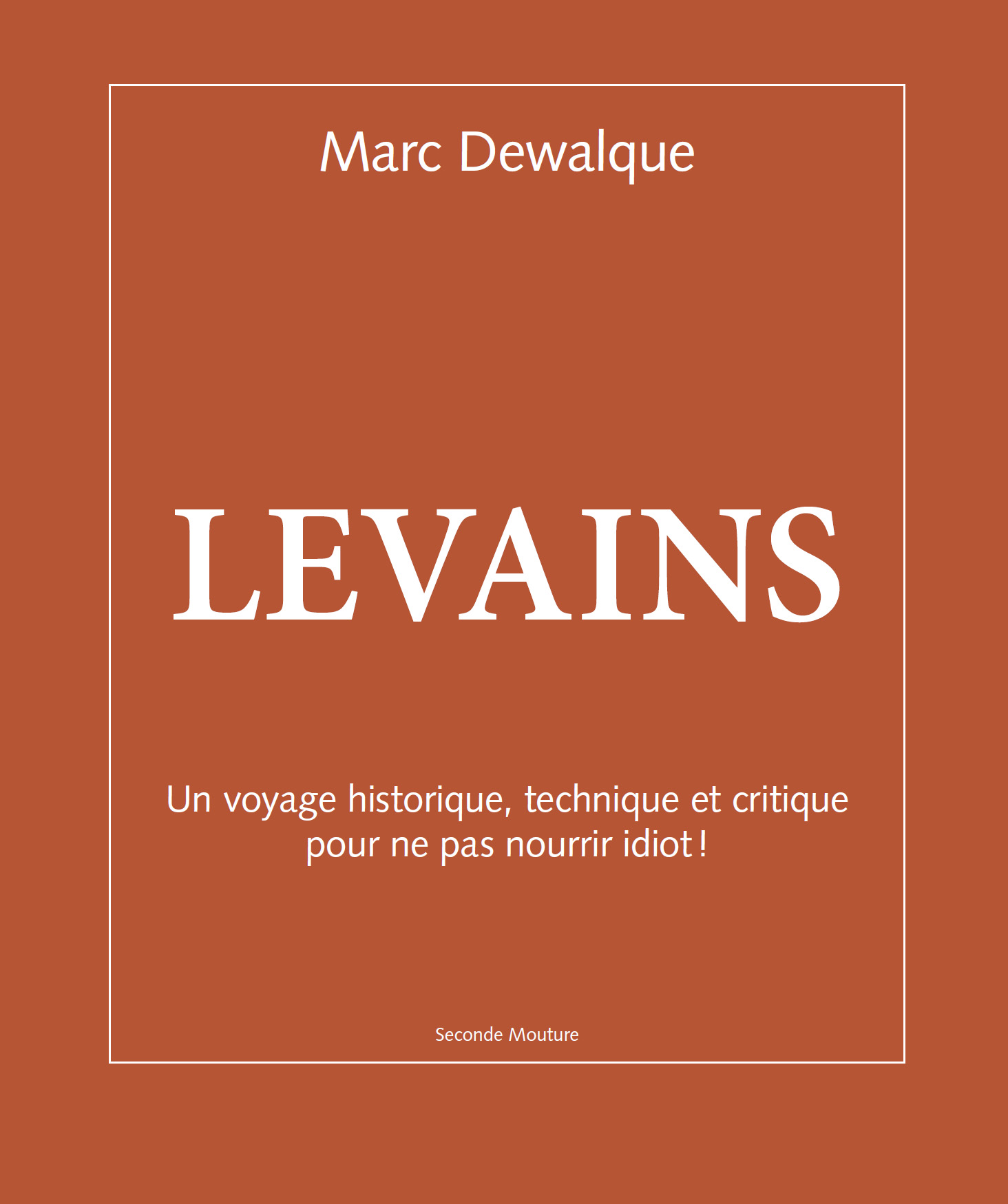Chapitre X. Le choix des Graines et des Farines
X.1. Les engrains (dits aussi : petits-épeautres)
Surnommé « graine de la peine » ou « caviar des blés », l’engrain passe souvent d’un extrême à l’autre. 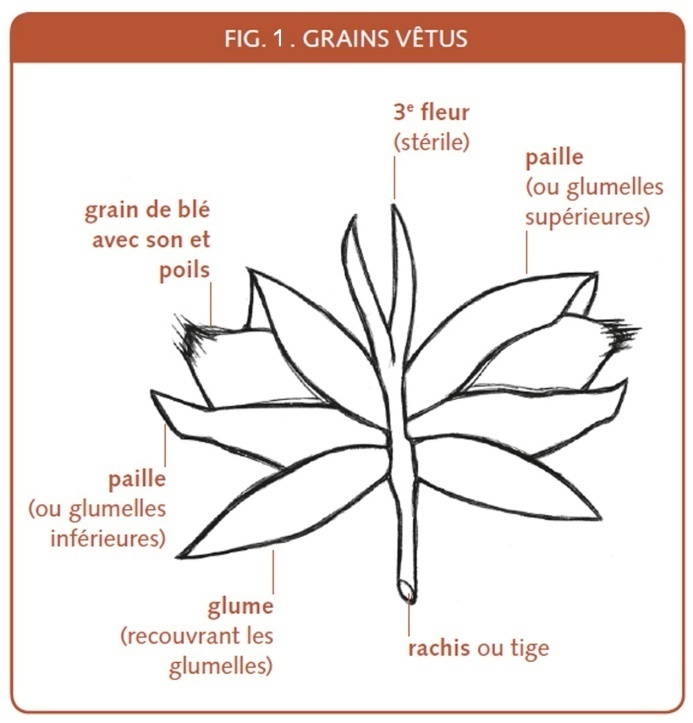
Au Maroc on parle de graine de la peine, puisque ce petit grain est vêtu et qu’il doit être décortiqué à la main avec une sorte de baguette en bois qu’il faut manier avec dextérité pour ne pas trop casser les grains[1].
D’ailleurs, au Maroc, on le donne aux chèvres qui, contrairement à nous, savent digérer les pailles et les balles composées de glumes et glumelles.
Dans la figure 1 représentant deux grains par épillet (et non un grain par épillet comme il se devrait pour l’engrain), le grain apparaît pour la démonstration, mais en réalité pour les grains dits vêtus, les glumes et les glumelles paillées ou balles enserrent tellement le grain qu’on ne voit pas le grain. Et il est même difficile de détacher le grain de sa seconde enveloppe paillée.
C’est le cas de l’engrain, dénommé en Provence, « pichoto espeuto », soit « petit épeautre » en français.
Ainsi dans le grand Sud français, l’appellation épeautre ne correspond pas à l’épeautre, dit « grand épeautre » au Sud de l’Allemagne ou de la Belgique et au Nord de la Suisse.
En Haute-Provence, l’appellation a même reçue en 2010, après des démarches de plus de dix ans, une identification géographique protégée (Igp) pour le grain, puis la farine. Cette zone protégée a été déterminée par la carte d’implantation des moulins à meules verticales (fig.4 dans XII.4) servant à monder (décortiquer) le petit épeautre[2]. Ce produit du terroir a ainsi pu être mieux valorisé et le nombre de cultivateurs de petit épeautre a presque doublé près du Mont Ventoux dès l’obtention de l’Igp.
Cultivé à plus de 400 mètres d’altitude, dans la même zone géographique que la lavande, sur sol pauvre appelé « épeautrière », le pichoto espeuto bénéficie ainsi d’un climat méditerranéen tempéré.
Ce mouvement agricole provençal qui défend le petit épeautre jusqu’à dans sa spécificité nutritionnelle veut mettre fin à l’ambiguïté de l’appellation épeautre. La confusion entre les grains vêtus dénommés d’emblée, « épeautre », ne s’arrête pas à l’embarrassante différence nominative entre petit et grand épeautre.
L’amidonnier (X.2), est parfois appelé « épeautre de Tartarie[3] » et l’amidonnier blanc de printemps « épeautre de mars ». En Espagne, quelques variétés dites d’espelta seraient des amidonniers[4]. Dans les Carpates, on distingue avec peine les trois variantes de blés vêtus : engrain, amidonnier et grand épeautre[5]. Dans le Caucase et au Moyen-Orient, pays riche en variétés originelles, l’échange entre ces espèces prête encore plus à confusion (IV.3.1.).
Dernier exemple : on trouve dans un excellent livre de cuisine régionale la mention du farro, « épeautre » en italien, présenté comme une céréale spécifique à l’Ombrie. Mais l’appellation latine « Triticum durum dicoccum » le rangerait plutôt du côté des amidonniers[6].
Il n’est pas simple de faire la différence, parce qu’en botanique, ce sont des connaissances très modernes qui permettent la recherche des origines, pas les archives (III.1). Ainsi l’étude de la composition des couches terrestres et de leur contenu en pollen (palynologie), l’analyse au carbone 14 (le décompte de la demi-vie radioactive, qui peut durer des milliers d’années), et les connaissances du génome du froment vont avoir plus de poids au niveau des preuves qu’une source historique sortie de son contexte et sujette à interprétation. C’est pourquoi sur le terrain, l’agriculteur appellera les grains vêtus « épeautre » en français et « farro » en italien, puisqu’il ne peut pas deviner à l’œil nu le nombre de chromosomes par exemple.
On n’a pas fini avec nos démêlés d’appellations.
Sur la même gravure sur bois R. Dodoens (1566) dénomme l’engrain, le monococco et M. Delobel (1581) l’appelle, le briza. À cette époque de la Renaissance, on dépréciait l’engrain. Rembert Dodoens 
écrit en 1554 dans l’édition en flamand, « On en cuit du pain brun qui a un goût très étrange et désagréable », et dans son édition traduite en français par Charles de L’écluse en 1557, « Le pain de briza est fort pesant, nourrit mal et est malsain ». Mathias Delobel, en 1581, reprenant probablement ces prédécesseurs, insiste aussi gravement sur ce sujet en disant que le briza « donne du pain noir avec mauvais goût », probablement dû à l’amertume des enveloppes. Delobel ajoute que « le pire des épeautres, nommé briza en grec », a un effet « somnifère » selon Galien. C’est la concentration du son (peut-être même accompagné de la paille ou balle) dans la farine qui faut probablement traduire dans ces interprétations.
Pour clore cette réflexion sur la dénomination, retenons que ce terme monoccoco (« monococcum » de nos jours) signifie qu’il n’existe qu’un grain par épillet, spécificité que l’on retrouve dans les termes « engrain », « einkorn » en allemand et en anglais, et « eenkoren » en néerlandais. Briza est, quand à elle, une appellation qui fut appliquée à trois graminées différentes au cours de l’histoire[7].
L’engrain est certainement un des plus petits graines de céréales. Comparé à un des plus grands blés, voyez ce que cela donne avec cette image de Jacob Allen Clark (fig.2)
Son rendement à l’hectare est de 10 à 35 quintaux contre 60 à 80 quintaux pour le blé, fin du xxe siècle en France. Ajoutons que, comme il faut décortiquer ces petits grains, on ne sort, pour une farine blutée, que 50 à 60 % du grain.
L’engrain a ainsi la plus faible valeur meunière de tous les blés (XII.5) [8]. D’ailleurs, dans le département de l’Hérault entre les deux guerres, on avait dégradé le statut de l’engrain à celui de mauvaise herbe[9]. On comprend bien qu’avec de tels rendements en agriculture et en mouture, ceux qui le produisent sont obligés, d’en demander jusqu’à dix fois plus que pour du blé commun pour valoriser leur travail.
Et voilà bouclé le parcours du « grain de la peine » au « caviar du blé ».
Maintenant n’allez pas croire que les engrains sont tous non décortiquables. Seuls 13 à 26 % des grains de l’engrain, l’amidonnier et l’épeautre sont prêts à être « déshabiller » au battage contre 97 % pour les froments panifiables[10].
Il y a toujours des exceptions à une règle qui devrait plutôt être appelée une généralisation.
Ainsi l’engrain nu ou sinskajae originaire du Caucase, (du nom de l’agronome russe Eugeniya N. Sinskaya engagée par Vavilov), existe bel et bien. Il a été « redécouvert » il y a cinquante ans à peine par des scientifiques. On essaye bien sûr de relancer plutôt celui-là que les autres qui nécessitent une opération meunière en plus. Non décortiqué, il se conserve plusieurs années. Mais attention, une fois décortiqué, comme le recommande Hervé Cournède [11], il faut conserver l’engrain nu non seulement à l’abri des ravageurs tels que les rongeurs, les charançons et les mites, mais la chambre froide est aussi pertinente vu les matières grasses contenues dans le grain qui rancissent plus vite que d’autres à température ambiante. Cela confirme que le caractère vêtu a sa raison d’être, comme nous le verrons plus loin, pour la grasse avoine (X.9).
Une deuxième exception à la règle porte sur le fait qu’il y a plus qu’un grain par épillet.
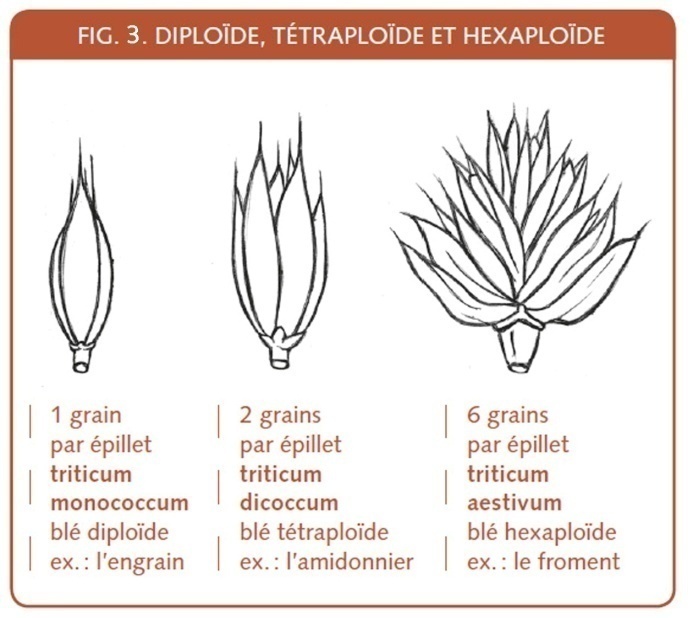
Il existe en effet l’engrain double que Henri de Vilmorin présente de cette façon : « L’engrain double est, dit-on, ainsi nommé parce qu’il se développe assez souvent deux grains dans le même épillet. Il n’y a là rien que de très naturel, puisqu’il y a toujours dans l’épillet deux fleurs, dont l’une doit avorter pour qu’il ne s’y trouve qu’un seul grain. Il s’ensuit que le nom de Triticum monococcum, s’il veut dire, comme on l’admet généralement, blé à un seul grain, prête à la critique, car il est pris d’un fait qui n’est pas constant et qui, en tout cas, est dû à un simple avortement[12]. »
La farine d’engrain, sans trop forte présence de ces enveloppes, est plutôt jaune. Cette couleur vient des pigments caroténoïdes et témoigne de sa très forte teneur en provitamines A (III.7).
Comparé au froment, l’engrain est plus riche en lipides, vitamine B1 et B2 et en minéraux (zinc et magnésium[13]). Ses acides aminés sont par ailleurs mieux équilibrés. Il contient plus de lysine que les autres céréales, ce qui permet une meilleure assimilation des autres acides aminés (fig. 12 dans VII.7).
La qualité « élastique » de ses protéines ne peut que très difficilement se comparer au gluten actuel. Il suffit de réaliser un simple test d’extraction du gluten (VIII.11) pour s’en apercevoir. À la fin de la lixiviation, vous n’obtiendrez pas de « pâte slime » avec les protéines de l’engrain et souvent nous avons dû arrêter le lavage de sa farine avant le terme pour garder une partie entre soluble et insoluble et très peu extensible.
Bon nombre d’allergiques au gluten non cœliaque et même des cœliaques qui osent braver l’avis médical, tolèrent l’engrain, surtout lorsqu’il est panifié au levain. Et pourtant, la teneur en protéines de l’engrain est bien souvent supérieure aux teneurs protéiques des blés actuels au gluten tenace. Manifestement, on ne peut pas parler de gluten ou protéines au singulier.
Comme une des interventions les plus critiquées médiatiquement sur l’alimentaire est le génétique, l’engrain est en termes d’évolution du génome, par la nature ou par intervention humaine, le blé de base n’ayant pas vécu de polyploïdisation (duplication du génome), comme le seront tous les autres ancêtres de céréales décrits ici par la suite. Trop souvent, on emploie une expression peu précise et dès lors interprétable : céréale non hybridée.
Cela sème la confusion. De quelle hybridation s’agit-il ? Pas l’hybride F1, c’est-à-dire celle issue de la première année d’un croisement entre deux populations qui est peu reproductible sous sa forme première, puisque non fixée.
Pas non plus le sens que donnaient les premiers sélectionneurs de blé. Comme chez les, de Vilmorin, Jos.-Marie Philippe[14], qui a employé le terme pour signifier qu’il s’agissait de croisements orientés et conduits par la sélection généalogique que son grand-père avait définie dans un écrit[15]. Ici l’engrain n’a pas subi de polyploïdisation et reste avec les chromosomes qui sont obligatoirement présents par paire, d’où le qualificatif génétique « diploïde ». Mais il se peut très bien qu’il y ait un croisement ou hybridation intraspécifique entre deux engrains différents. Le triticale est le résultat d’une hybridation interspécifique, entre deux espèces, le blé et le seigle. Le croisement intergénérique (entre genres) est pire que les mules/mulets, qui résultent d’un croisement entre une jument et un âne, qui est encore interspécifique. L’hybride est tout cela, mais laisse parfois trop penser au pire de la science-fiction, au contre nature, c’est pourquoi il faudrait être plus précis lors de l’emploi de ce mot non-hybridé, qui a plusieurs sens.
En tout cas, pour les fervents de l’indigestibilité du blé (régime paléo ou ancestral) attribuant à ce dernier cette critique d’évolution (polyploïdie), l’engrain a été, quelques rares fois, mieux reçu que les autres blés.
Cette faible teneur en matière élastique qu’est le gluten de l’engrain fait que son réseau liant est fragile, on le pétrit peu pour cette raison.
Si c’est une pâte très hydratée, cela passe presque obligatoirement par un support en moule lors de la fermentation et cuisson.
Il vaut mieux ne pas trop le saler pour laisser toute sa place à son goût un peu brioché. Eh oui ! Sans beurre, ni œufs ou sucre, il produit ce goût à lui tout seul. « C’est du gâteau », diront certains en le découvrant.
La pâte d’engrain fermente très vite ; parfois, même en le pétrissant en dernier pour accompagner dans la même chambre de cuisson d’autres pains, cela ne suffit pas. Il faut souvent décaler ou retarder sa confection par rapport aux autres pains de blés et/ou avec une eau de coulage plus froide. Un ensemencement sur plusieurs rafraîchis préserve sa douceur et évitera l’acidité que la fermentation au levain peut procurer surtout pour des pâtes de farines plus « blanches ». C’est pourquoi il est parfois panifié en mélange avec des farines de blé dur qui ne diluent pas sa couleur jaune et n’altèrent pas trop la douceur de son goût, mais améliore sa panifiabilité.
X.2. Les amidonniers
Ce n’est pas de l’engrain que descend l’amidonnier comme on l’a longtemps cru, mais du blé Urartu repéré en Arménie en 1937. Comme ce dernier ne sait pas se croiser avec l’engrain on le considère comme une espèce distincte[16]. C’est à la fin du xxe siècle qu’on désignera le blé Urartu comme parent direct de l’amidonnier à la place de l’engrain[17]. Les parents sont donc Urartu et une égilope, « qui murit avec le froment et autres blés »[18], mais dont l’espèce n’est pas franchement précisée, elle est simplement dite, de type speltoïde. Spécifions bien, qu’au lieu d’offrir en mariage et mélange leurs chromosomes chacun, dans leur échange-pollen (qui fera l’héritage génétique), ils ont mis la totalité, en les superposant ou fusionnant les deux entités génétiques. L’amidonnier possède ainsi quatre paires de sept chromosomes, soit vingt-huit chromosomes, deux fois plus que ses parents. Cela fait de lui en terme génétique, un tétraploïde (IV.3).
Tout cela se passe de manière spontanée et naturelle, sans intervention de l’homme. C’est une expression génétique, qui même si elle est rare, se retrouve à l’état non domestiqué.
L’amidonnier et l’engrain sont les deux seuls blés que l’on peut encore trouver à l’état « sauvage » de nos jours.
Durant le bas Moyen Âge, on préfère mettre en culture l’amidonnier plutôt que l’engrain. Il sera par la suite détrôné par l’épeautre, puis, comme on le sait, c’est le froment qui s’imposera.
C’est généralement l’amidonnier que l’on va retrouver comme objet cultuel, plaqué or, ou lors des fouilles archéologiques. Les analyses au carbone 14 ont montré que depuis -10200, la domestication du blé ne s’égrenant pas va s’installer jusqu’à atteindre les deux tiers des blés carbonisés et excavés à -6500.
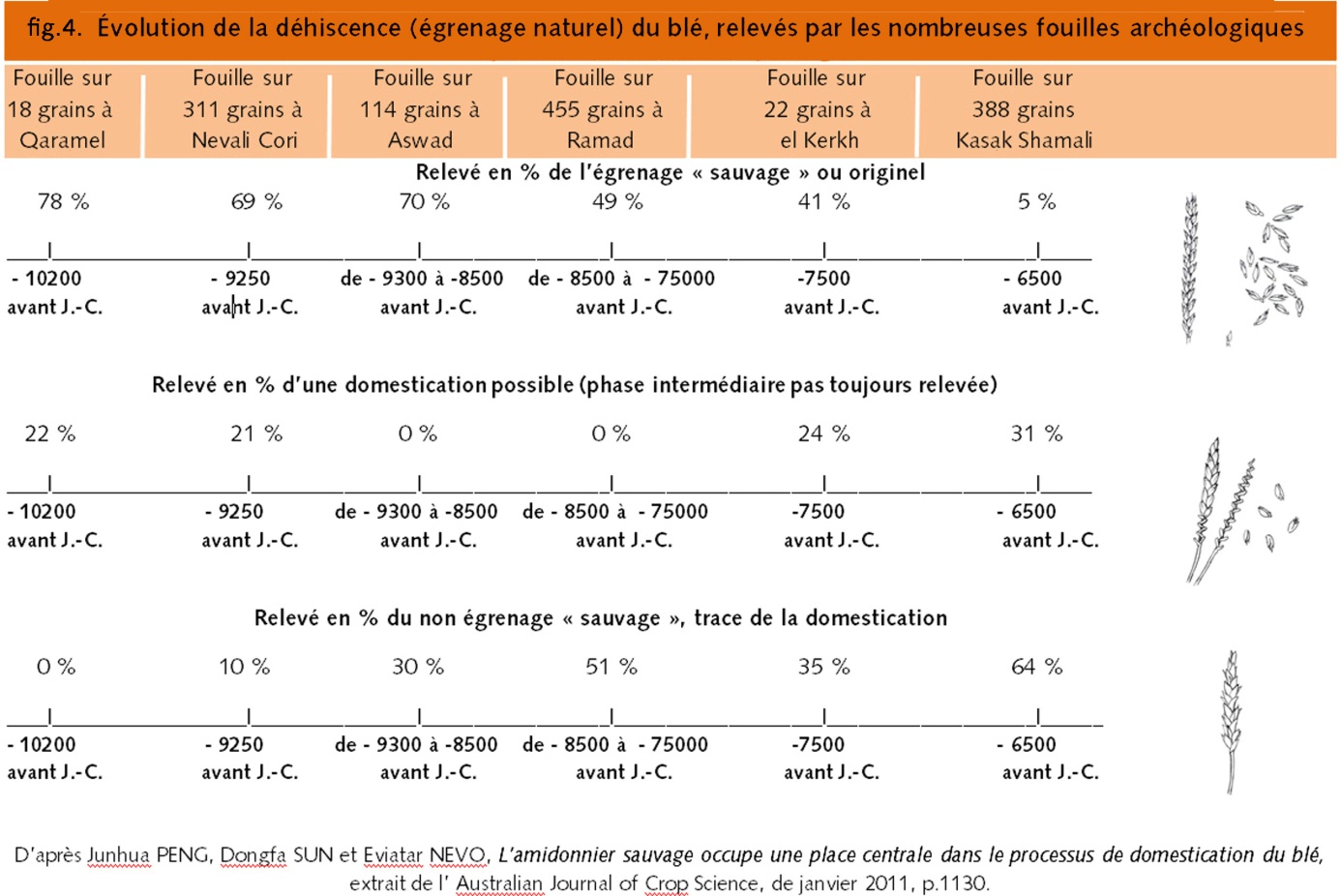
Les relevés des premiers livres d’imprimerie sur les plantes au xvie siècle n’en parlent déjà plus que comme une plante qui vient « en usage de médecine » et encore, en reprenant les écrits latins et grecs où l’amidonnier figurait probablement sous divers dénominations, dont Typha ou Olyra. À Lille, deux autres blés sont renseignés dans ces premiers traités de botanique officinale de la même époque. Ils sont dénommés blé Luisier, un blé noir brillant, et blé Turquet, ayant « la couleur perse », c’est-à-dire bleue. Les deux semblent bien être des amidonniers[19].
Nous verrons (X.4), que ceux-ci disparurent des champs cultivés en Europe occidentale après le xie siècle. En Turquie, la sole de culture des blés vêtus étaient en 1953 de 137.300 hectares et quarante ans après (en 1993), il ne reste qu’un dixième (12.900 ha)[20] qui sont situés au Nord près de la Mer noire.
Un point qui favorisera l’amidonnier vis-à-vis de l’engrain, son épi mieux fourni en gros grains. Deux points le défavoriseront par contre vis-à-vis des céréales qui le supplanteront : une teneur en grains assez durs procurant semoule plutôt que farine à la mouture et le fait qu’il faille le décortiquer.
L’amidonnier qui se dénomme emmer en allemand et en anglais, porte le nom latin « dicoccum » ou zweekorn en néerlandais, soit deux grains par épillet.
Il est dit le père, des blés durs et d’autres moins proches parents de cette descendance nombreuse comme les blés ; turgidum – poulards (X.3.1), polonicum (X.3.2), turanicum – khorazan (X.3.3), carthlicum (X.3.4) ou compactum (X.3).
En juillet 2017, un consortium réunissant un groupe de chercheurs internationaux déclare qu’ils ont séquencé l’Adn de l’amidonnier, ce qui permit à ces chercheurs de mieux comprendre l’évolution génétique du blé[21].
En panification, il apparait comme une curiosité à visiter, ce blé dit parfois « antica » en Italie.
Médiatiquement, il a refait surface dans la Garfagnana, région du Nord de la Toscane, ou il fut un des premiers blés a obtenir une identification géographique protégée (Igp) de la communauté européenne en 1996. Dans cet endroit, on avait su conserver et reproduire de manière ancestrale ce blé adapté à cet environnement spécifique situé entre les Alpes Apuanes et l’Apennin toscan. C’est également à Castelvecchio di Garfagnana, que se déroula en juillet 1995, la première rencontre internationale sur les hulled wheat (soit blés vêtus, vu comme blés anciens) [22]. Plus au Sud, au cœur de l’Italie et toujours dans les Appenins à Monteleone di Spoleto en Ombrie, on retrouve une dénomination d’origine protégée (Dop) reçue en 2010. C’est aussi un amidonnier qui est plutôt destiné à la confection de pâtes et résulte d’une conservation du à un repas rituel dédié à Saint-Nicolas à la veille de sa fête, le 5 décembre[23]. Il s’agit de véritables sauvegardes sur sites avec une empreinte ethnique liant une population humaine et une population végétale avec ce que le climat et le terroir impriment dans celles-ci.
Dans les recettes de pain d’amidonnier, on composera ou non avec l’amertume de ses enveloppes.
On le voit encore bien rectifier et donner le caractère trop peu « hard » dans le mélange avec des épeautres anciens (qui vêtus comme lui, peut suivre le même parcours meunier).
On ne pourra pas exiger une mie très aérée et plastique de cette farine assez rêche. En revanche, l’amidonnier apporte un goût puissant dans le mélange. On en fera par exemple une grande tourte vendue au détail pour apporter une plus grande variété de textures de mies aux clients.
Ce qui est certain, c’est que nous nous trouvons là avec des espèces de blé qui ont les plus beaux épis et il ne faut pas oublier de les présenter en bouquet d’épis, ils ont droit à la vitrine.
X.3. D’autres blés tétraploïdes
X.3.1. Les blés turgidum ou poulards.
Avec les poulards, on reste dans des blés à faire parader. Ce blé vit plutôt à l’intérieur des terres et est plus résistant au froid, il passe l’hiver, c’est clair [24]. Comme ce blé est décorticable, il bénéficie d’une préséance d’emploi (X.4).
On remarque souvent que sa paille près du port de l’épi a tendance à faire des courbures en forme de col de cygne, comme pour exprimer que malgré le poids des épillets qui le fait plier, il se redresse vers le soleil [25]. C’est que ces grains étaient appelés « gros grains » à Lyon et dans le sud de la France, « grains de gaudelle », c’est à dire grain de taille plus importante, terme qui sera attribué plus tard au grain de maïs. Et de nouveau c’est ces caractéristiques qui lui donneront un nom, au blé poulard. Les termes « rivet » en anglais, « turgidum » en latin, disent assez que le grain est renflé (IV.1). Mais au fait, d’où vient le nom français, poulard ? Certains disent que le terme vient de pullus, le petit de n’importe quel animal, ici la poulette [26], ce qui est un peu en contradiction avec sa réputation de gros grains. D’autres explications, pensent que le nom est dérivé du latin pulliginis (brun), parce qu’il alterne entre couleur rouge et jaune sombre (pullum) expression que l’on retrouve dans de vieux textes de Jean Ruel en 1536 [27].
La frontière entre les blés poulards et les blés durs n’est pas nette selon Florent Mercier, fan du poulard. On trouvera des poulards plus farineux et d’autres à l’amidon donnant de la semoule vu leur dureté, d’où son classement dans les blés mi-durs. La teneur en protéines vue par un examen d’Eugène Péligot en 1849 a tendance à prêter aux poulards coniques – composé de trois épillets sur la couronne du rachis – de bonnes teneurs en protéines[28].
Mais cela n’est pas toujours confirmé, Florent Mercier signale par exemple que le Blanco de Corella espagnol contient peu de protéines à propriétés élastiques en tout cas.
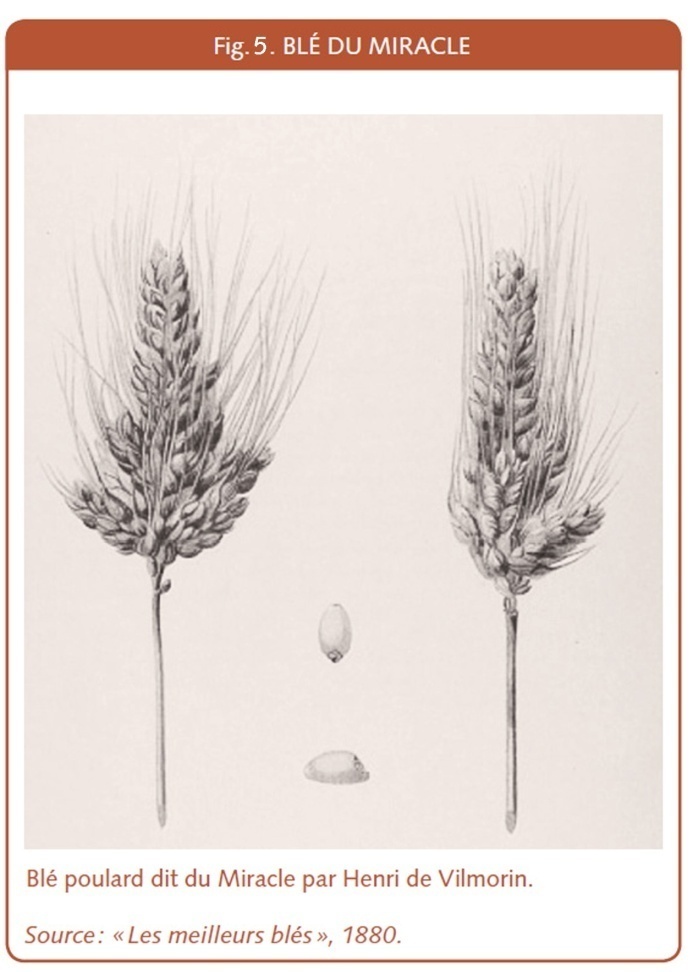
Le blé blue cone rivet (bleu, conique et bombé) fut exporté dans les années 1850 d’Europe aux antipodes. Les essais de culture de l’émigration anglophone en Australie faisant l’objet de concours, il prit de l’importance, puis, avec un « effet boomerang », fut réexporté vers son continent d’origine, un siècle plus tard, estampillé de « naturellement d’Australie » et dénommé Poulard d’Australie[29]. C’est « le nom de variété par lequel elle est le plus généralement désignée, bien que ce ne soit pas le plus ancien », dit Henri de Vilmorin en 1880[30].
En provençal, le poulard porte le nom de « pétanielle ». Dénomination que Jean-François Berthellot a retrouvée dans un écrit de 1825, sous le curieux nom de « pet d’agnel [31] ».
Et encore une fois pour la beauté du blé, on trouvera dans les collections, rien que pour émerveiller la vue, la pétanielle noire de Nice qui au regard, sera préférée à la pétanielle blanche.
Toujours pour dynamiser l’attrait des collections, les blés poulards ont aussi l’occasion de donner un spécimen appelé, blé miracle. Un blé qui forme « un gros bouquet sur un seul tronc » et qui « ne se sème que par curiosité », selon des auteurs du xviie et xviiie siècle (IV.1 et fig.5).
Nicolas-Charles Seringe (*1776-†1858) dit [32] qu’il « est actuellement [en 1818] très certain, comme l’avait déjà pensé Mr. A. P. De Candolle [*1778-†1841] que le Triticum Compositum [le blé miracle] n’est qu’une simple variété du Triticum Turgidum[33], dont la base se ramifie plus ou moins. J’en ai trouvé [en Suisse] des individus à peine rameux et dont les épillets de la partie supérieure étaient absolument conformés comme ceux du Tri.Turgidum ».
En 1880, Henri de Vilmorin donne les synonymes du blé Miracle[34] : blé rameux ; blé de Smyrne ; blé de momie ; blé Eldorado ; blé d’Égypte ou Egyptian wheat (Angleterre) ; grano a grappoli (Italie), puis il commente ainsi : « Les poulards sont la classe de blés où les épis se ramifient le plus fréquemment. Cette monstruosité a déjà été observée dans l’antiquité, car Pline en fait mention ».
Effectivement dans l’Histoire Naturelle de Pline (Livre 18, XXI.1), on trouve ceci : « les froments les plus productifs sont le froment rameux, et celui qu’on appelle à cent grains ». D’où d’autres synonymes s’ajoutent: blé branchu, blé des pharaons, blé de cent grains, blé aux septuples têtes, blé de Pline et blé Osiris[35], triticum spica multiplici en latin (à épis multiples[36]), preuve s’il en fallait qu’il impressionne.
Henri de Vilmorin continue ses observations en 1880 : « Les blés à épis rameux ont toujours eu le don de frapper vivement l’imagination des ignorants et des cultivateurs novices qui s’imaginent en obtenir des rendements prodigieux, tandis qu’ils ne donnent en général qu’un produit assez médiocre, surtout au point de vue de la qualité. Un très grand nombre de poulards ont produit des variétés rameuses : il en résulte que le nom de blé de miracle ne s’applique pas toujours exactement à la même variété dans les différents endroits ».
On portera encore ce blé miracle en haute estime après la guerre 1940-45, en URSS. Lyssenko et les agronomes « mitchouriens » l’appelèrent le blé fourchu. Sous le conseil de leur dirigeant, le géorgien Joseph Vissarionovitch Djougachvili dit Staline qui avait reçu du blé branchu de kolkhoziens caucasien en 1946, le responsable de la politique agricole Lyssenko (III.5) en espéra des récoltes extraordinaires. Il avait même proposé à grand renfort médiatique dans les années 1950 une expérience à grande échelle[37]. Mais, hélas, le blé à multiples épis ne tint pas ses promesses et il ne « fourcha pas ». La critique d’un autre généticien soviétique, Jaurès Medvedev, indique qu’il aurait du répéter des expériences préalables avant de se lancer en grandes cultures avec des résultats aléatoires[38].
On retrouve encore le blé miracle en 1949, Henri-Charles Geffroy et Pierre Sauvageot évoqueront dans le livre Osiris le miracle du blé[39] les péripéties d’un blé en état de germer après sept siècles -sic-, sorti d’une tombe égyptienne. Dans un numéro de la revue « La Vie Claire » de septembre 1947, 50 graines sont proposées aux abonnés qui le souhaitent[40], puis la revue et son réseau de magasins en distribuèrent 12 000 sachets.
On le mentionne encore ici et là au début du xxe siècle[41]. C’est vrai que ce type de blé a souvent été associé à l’égypte[42], et on évoque même les saisons 1, 2 et 3 de cette tenace légende [43], comme un feuilleton T.V. qui fait réapparaître les revenants pour l’audience. Aujourd’hui à son sujet, certains hommes de terrain glisseront du mot miracle au mot mirage.
La Nonette de Lausanne, l’Aubaine, la Saissette d’Arles et certaines Touselles sont parfois classées parmi les poulards [44]. Alors que l’on sait que l’ancestrale Touselle, connue depuis fort longtemps, faisait plutôt office de blé tendre sans barbes pour le pain. Les poulards se rencontrent en Espagne ; Sigarzani, Blanco de Corella, Cabezas grano de Cro, Poulard Asturias par exemple. Dans bien d’autres contrées, on trouve encore le magnifique poulard Maliani d’Italie qui est bicolore (glume bleue et glumelle rouge, fig.1 dans X.1 pour glumes).
S’agissant de la panification, dans cette classe des poulards mal définie, ce sera un peu au cas par cas. Il est clair que la touselle était connue « pour sa délicatesse à faire le pain » d’après Olivier De Serres[45], c’est en 1600. Certains blés « grano del Miracolo », sont employés en mélange avec d’autres variétés d’après-guerre pour faire le panettone à Corregio, près de Modène. On pense ici au Forno di Mario de Paolo Folloni. La recette est réalisée sur quatre rafraîchis, par intervalles de six heures, avec la farine de Claudio Grossi. Un grain que Claudio dit avoir trouvé dans un grenier de la ferme familiale de Lesignano Dè Bagni[46]. L’université de Padoue a analysé ce grain et trouvé une plus grande quantité de phosphore (43 % en plus) et de fer (25 % en plus), par rapport au blé « moderne ».
L’emploi du blé miracle est là comme pour prouver, s’il le fallait, que le panettone existait bien avant la vogue récente des blés au gluten tenace (les blés dit Manitoba) que l’on prétend parfois indispensables pour réussir ce splendide dessert de Noël (XIX.3.3). Plus que probablement qu’il était moins aéré et moins développé en forme de champignon dépassant la forme.
X.3.2. Les blés polonicum

Le blé polonicum (fig.6) n’est pas polonais, on a déjà vu (III.6) qu’il s’agissait d’une erreur de traduction de langues vernaculaires vers le latin, de la « Galice » espagnole par la « Galicie » polonaise. Amalgame repris en 1753 par Carl Linné qui dans « Species Plantarum » veut définir et classer chaque plantes suivant une appellation de deux noms latins représentant le genre et l’espèce. Cet ouvrage de référence n’est pas sans faille, puisque Linné, reprenant notamment la confusion de Joseph Pitton de Tournefort en 1700, appellera un blé dur présent en Espagne et au nord de l’Afrique de « triticum polonicum » ou blé de Pologne.
Joseph Pitton de Tournefort[47] ayant tenté de clarifier le tableau sur le tritico établi en 1671 par Gaspard Bauhin dans Pinax theatri botanici…[48]. Ce dernier travail du xviie siècle est un impressionnant index des ouvrages de Théophraste, Dioscoride, Pline et de botanistes du monde qui ont écrit sur les plantes (sept pages de bibliographie), avec les synonymes des six mille noms de plantes, classés méthodiquement. G. Bauhin mit quarante ans à le composer avec l’aide de ses étudiants de l’université de Bâle et tenta de mettre de l’ordre, dans les limites des connaissances botaniques de l’époque.
On doit notamment cette rectification de l’erreur Polonicum inscrite dans Species Plantarum par Linné à Michel Chauvet du musée Agropolis de Montpellier qui trouve source dans la description du blé de Pologne d’Henri de Vilmorin[49] : « malgré son nom, il est surtout cultivé dans le nord de l’Afrique, en Égypte et en Algérie » et confirmation dans cette étude d’Eugène Péligot [50] qui, dans son tableau de 1849, différencie clairement le blé Poolish Odessa « venant de la Pologne russe », (sous-entendu l’Ukraine occidentale actuelle), du blé de Pologne, « blé très dur à grains très allongés, originaire de l’Afrique septentrionale ». Il est effectivement très dur ce blé, comme le souligne son surnom anglais « diamond wheat », blé diamant.
En allemand, son nom est « Riesenroggen », soit « seigle géant », puisque l’épi est effectivement impressionnant en taille (voir fig.2 dans X.1, où on le compare au petit épeautre). Ce critère de taille devait donner à ce triticum Polonicum (fig.6), une prévalence dans les choix variétaux d’ensemencement. Notons quand même que c’est la cosse qui est impressionnante, le grain est certes long.
Ce blé très dur, originaire du pourtour méditerranéen, aurait peut-être été un des géniteurs d’un cultivar [51] (variété sélectionnée par croisement et cultivée) et ici au nom protégé commercialement, nommé blé Khorasan Kamut®. Blé, qui a la même implantation méditerranéenne, et que nous allons examiner maintenant.
X.3.3. Les blés turanicum ou khorazan
D’où nous vient ce nom latin turanicum, probablement du mot « Touran » reçu en persan[52], désignant une variété-population d’Asie centrale à dominance turque et turcophone. En tout cas, son nom actuel est le blé Khorasan, de la même dénomination que des provinces de l’est de l’Iran (du coté du soleil levant, signification de Khorazan), mais la région est bien plus vaste que les provinces perses, puisqu’elle englobe des villes et des régions afghanes (Kaboul, Kandahar) et ouzbèkes (Samarkand). Le Khorazan est géographiquement un peu le centre de ce qui se dénomme l’Asie centrale.
En Italie, on appelle ces blés ; « grano etrusco » puisqu’on a identifié des grains de khorasan minéralisés dans des fouilles de tombes de la civilisation étrusque (viiie au ier siècle av. J.-C.) [53] à Voltera au sud de la Toscane. Ivo Totti, un des pères de la bio en Italie, avait retrouvé du khorazan et en re-cultivait dès 1981[54]. En effet, on le retrouve facilement comme d’autres blés antici dans les provinces des Abruzzes et Basilicate du sud de l’Italie [55] et dans tous les pays du pourtour de la Méditerranée.
Notamment en Turquie, où les fermiers appellent ce grain « dent du chameau », en raison de la grosseur importante de son grain ou « blé du prophète », en faisant référence à une légende selon laquelle Noé avait emporté ce grain avec lui sur son arche[56].
En Sicile, on trouve une variété de blé dur fort proche, le grano Perciasacchi, à traduire par ; grain perceur de sac, (à cause de ces bouts pointus). Cette variété est décrite comme multiséculaire dans le livre « I frumenti siciliani »[57] d’Ugo De Cillis en 1942. Dès lors, c’est plutôt le blé Khorasan qui est a comparer au perciasacchi et non l’inverse vous diront les italien(ne)s.
En tout cas, le blé etrusco ou khorasan existe bien avant l’estampillage Kamut® venant du Montana aux États-Unis. En comparant les deux sigles de la firme Kamut®, l’ancien et le nouveau, on remarque que la référence nominative à l’égypte n’existe plus et que le nom de Khorasan apparaît sur le nouveau. La pyramide est toutefois restée en toile de fond. Un peu comme on l’a déjà vu avant (II.3, X.3.1), « quand la légende est plus belle que la réalité, imprimez la légende », c’est encore le cas ici. Une légende circulant sur le blé Red Fife (III.6) racontait qu’il ne subsistait que deux des cinq épis de cette variété dans la ferme et que l’épouse de David Fife les sauva en chassant la vache qui voulait les brouter[58]. J’ai entendu le même scénario colporté sur le blé surnommé alors « blé du roi Toutankhamon » qui allait devenir le Kamut®.
Alors pour sortir des légendes, quelle est la véritable histoire ? On l’a trouvée sur le site de la firme Kamut®. En 1949, un aviateur américain, Earl Dedman, reçut d’un ami qui revenait d’un voyage en égypte un peu de graines, soi-disant excavées d’ancien sarcophage. Du Portugal, Earl envoya trente-six grains à son père Rube E. Dedman, agriculteur à Fort Benton dans le Montana, le long du Missouri naissant.
C’est lui qui les multiplia et les baptisa « Blé du roi Toutankhamon », dont on avait découvert la tombe en 1922, ce qui avait déclenché une véritable « égyptomania ». Ce blé du « King Tut », devint presque une spécialité locale, qui disparut de l’intérêt général dans la fin des années 1960, début des années 1970.
C’est à cette époque qu’un dénommé Bob Quinn reçut un bocal de quelques graines des mains de Clinton Stranahan lors d’une foire agricole. À la fin des années 1980, Bob Quinn, devenu ingénieur agricole, et son père Mack convertirent leur ferme à l’agriculture biologique et cherchèrent à exploiter ce gros grain égyptien. Ils iront jusqu’à le protéger en 1990 sous un nom commercial Kamut®, (soit traduit de l’hiéroglyphe égyptien, blé)[59]. Ni Dedman, ni Strahanan, ni les agriculteurs du pourtour méditerranéen n’avaient eu l’idée de s’accaparer l’identité de ce blé ; il fallut attendre B. Quinn. Ce dernier dit avoir agi de la sorte dans le but de protéger et de préserver les qualités exceptionnelles de la variété de blé ancien khorasan et dans l’intérêt de tous ceux qui sont intéressés par une alimentation saine de qualité supérieure [60].
Résultat, si vous n’avez pas acheté chez eux, ne faites plus mention de la dénomination Kamut®, au risque bien réel et vécu d’être poursuivis par les avocats de la firme, quand la protection commerciale dépasse celle de la préservation de la qualité. Faites plutôt la promotion du nom khorasan et vous éviterez de payer les frais liés à la « marque », ainsi que peut-être, les frais d’importation depuis les États-Unis.
Nous avons déjà vu au chapitre VII.10 que ce blé khorasan, surtout celui de la firme Kamut®, avait une meilleure teneur en sélénium, mais qu’elle vient davantage du terroir du Montana et des États voisins de « la grande prairie » que de l’espèce Khorasan.
Maintenant je ne connais pas les teneurs en sélénium des bonnes terres des grandes prairies du nord des États-Unis et du Canada voisin, ou s’il faut amender les terres en sel de sélénium, mais on peut lire que le blé estampillé Kamut® doit contenir entre 400 et 1 000 ppb de sélénium [61].
Une étude publiée en 1991 par l’International Food Allergy Association a révélé que 70 % des personnes sensibles au blé supportaient mieux cette céréale. C’est une des premières recherches à avoir relevé ce fait sur les blés dits « anciens »[62].
On peut travailler le khorasan en boulangerie en le mélangeant avec des blés qui peuvent compenser la « raideur » de ce blé dur, certains blés se « relâchant », comme par exemple, le petit épeautre et la goûteuse variété-population italienne, Gentil Rosso, contenant, très peu de gluténines[63].
Pour pouvoir utiliser le nom Kamut® sur le pain, il faut au moins 50 % de farine avec le petit® et il faut afficher le pourcentage employé dans le mélange[64]. Le pain de khorasan sera plus tassé en volume, comme tous les pains de blé dur, mais apportera son arôme et sa belle couleur jaune.
X.3.4. Les blés Carthlicum ou de Perse
Moins connu, ce blé dont on traduit le nom latin par « blé de Perse » est un petit grain mis à jour par Nikolaï Vavilov lors de ces recherches en 1916 et 1924, dans les années où il pérégrinait pas mal[65]. Du fait de sa petite taille, un peu par l’effet de concentration, ce petit blé atteint parfois de hautes teneurs en protéines[66], mais pas de qualité panifiable comme on l’entend actuellement.
Ce blé est décortiquable, ce qui est déjà un avantage par rapport à d’autres blés anciens tétraploïdes, souvent vêtus, avec glumes fort attenantes au grain. Ses deux paires de chromosomes ont été identifiées comme précurseurs de nombreux blés hexaploïdes [67].
Il sera encore choisi, un peu comme « porte-greffe », pour son immunité exceptionnelle face aux moisissures[68] dans les croisements ou les manipulations génétiques d’apport de gènes résistants (X.18).
Le but est d’introduire un gène de résistance aux champignons provoquant des maladies en culture, gène bien plus présent dans les céréales originelles sauvages que dans les céréales domestiquées. Exactement comme le sanglier aura de meilleurs gènes de défenses immunitaires que le cochon élevé en batterie. On réussira après pas mal d’échecs à faire porter ces gènes à des variétés modernes, par exemple le blé Vpm (Ventricosa, Persicum et Marne) qui permettra de créer en 1990 la célèbre variété Renan[69], dont les prémices de la recherche datent de 1948, d’abord par l’équipe de Nicole Maïa, poursuivie par celle de Gérard Doussinault.
Sa généalogie est succinctement expliquée dans la figure 7.
Je ne connais pas d’expérience de pain fait avec ce seul blé de Perse, qui reste par contre bien utilisé comme ressource génétique ou matériel pour sélectionneurs pour améliorer d’autres cultivars. Ce genre de blés homologués n’est pas toujours utilisé en culture et ils sont identifiés par des lettres et des chiffres disparates dans les centres de germoplasmes (III.12).
L’évolution des instruments d’identification génétique permettra d’obtenir parmi les descendances, les lignées qui ne conservent que le gène désiré également avec la technique du rétrocroisement (fig.11 dans III) – effectuer le même croisement autant de fois que nécessaire (III.12).
X.3.5. Les blés compactum
Autre variété (plutôt morphologie) présente aussi bien en tétraploïde et hexaploïde, le blé compact portera de nombreux noms, tels blé hérisson , blé de Sicile, du Chili[70], du Tibet[71] ou en anglais « club wheat » (blé massue [72], référence à la tête d’un club de golf).
Un caractère de compacité du port des épillets sur l’épi qui intéressera les sélectionneurs. Ainsi on le retrouvera encore en 1936 parmi les géniteurs du blé « Précoce de Gembloux », puisqu’en plus il nanifie un peu les tiges lors de croisement.
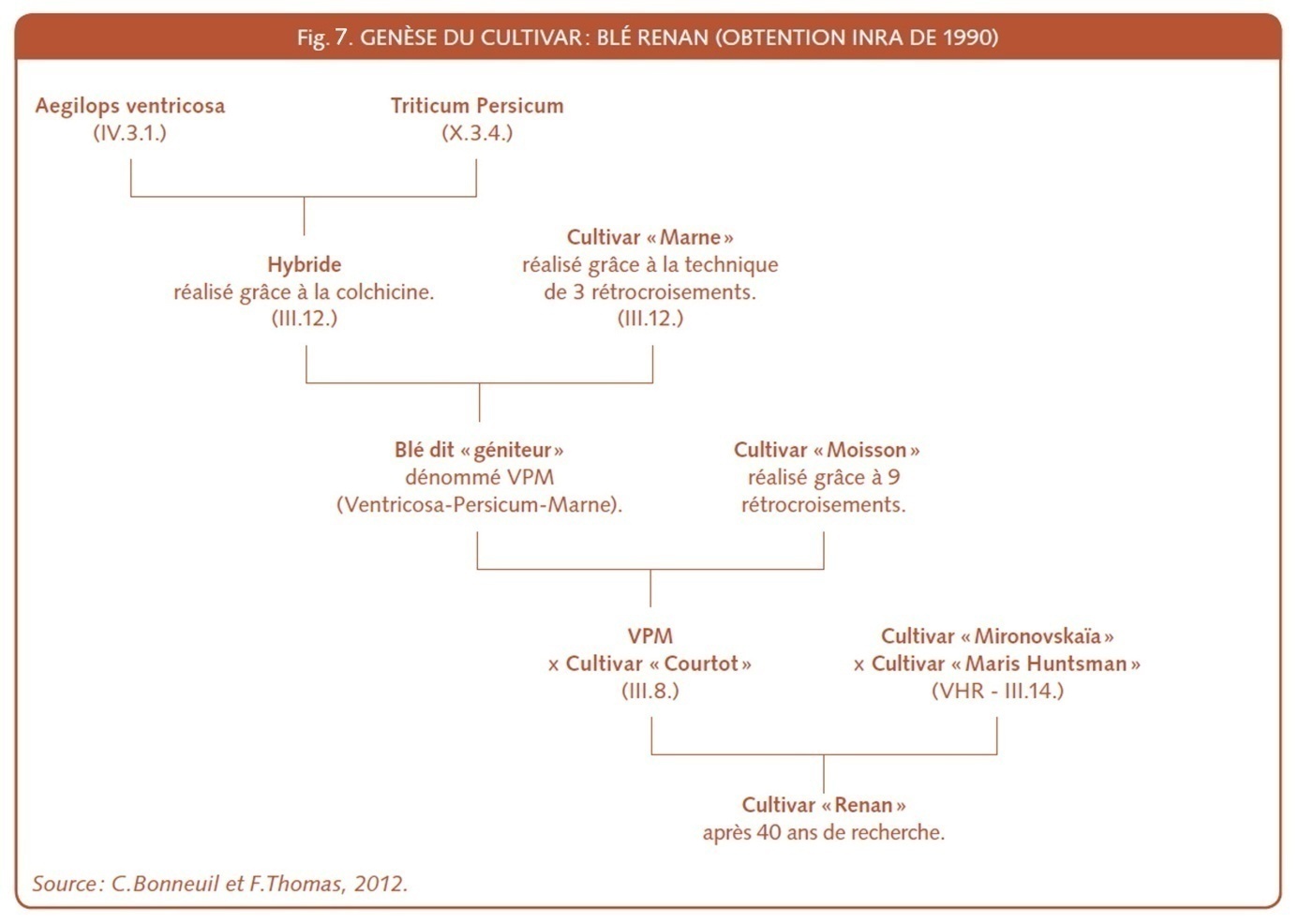
X.4. Les grands épeautres
Nous voilà avec un blé hexaploïde (trois paires de sept chromosomes). Ce n’est pas encore une polyploïdation (X.2) de quatre à cinq paires (octo- et déca-ploïde) comme on le voit pour certaines graminées, le brome par exemple. Ou jusqu’à dix paires de chromosomes (icosaploïde) pour certains fétuques[73]. Les graminées sauvages vivent la polyploïdation assez fréquemment.
Toutefois, parmi les céréales cultivées, on ne va pas plus haut que ces trois paires de chromosomes acquises dans la nature lors de la longue domestication du blé.
Comme scientifiquement c’est le latin qui demeure la langue utilisée, le grand épeautre est là, le Triticum Aestivum L. em. Thell ssp. Spelta, souvent raccourci en « Triticum Spelta ».
Ce qui différencie l’épeautre (blé vêtu) du froment (blé nu) par exemple, c’est notamment lorsqu’il arrive à maturité, les grains dans leurs épillets se détachent plus facilement de l’axe que pour le froment (fig. 8). Ils ont un rachis fragile (tige de l’épi ou s’attache l’épillet à chaque nœud).
Cette aptitude de rachis fragile fait que l’épeautre était récolté d’une autre manière ; les paysans espagnols des Asturies vont être nos témoins. Ils se servaient de deux baguettes qu’ils croisaient (mesorias) pour étreindre un bouquet d’épis, le torcher et l’arracher, avant de le secouer dans un grand panier[74].
Autre différence, mieux connue celle-là, entre l’épeautre et le froment, c’est cette balle (composée des glumelles et des glumes, fig 1 dans X.1) qui reste accolée aux grains d’épeautre alors que le grain complet de froment s’extrait aisément de cette « épluchure paillée ».
C’est généralement ce qui est l’identité, l’ habit d’anciens grains en somme.
Mais pour cette raison, l’épeautre doit subir une opération préalable à la mouture, cette action supplémentaire est le décorticage (XII.4).
C’est pourquoi, il est souvent d’usage d’entreprendre un calcul sur ce que rend en farine un grain gardé, ou acheté, vêtu avec la balle en plus.
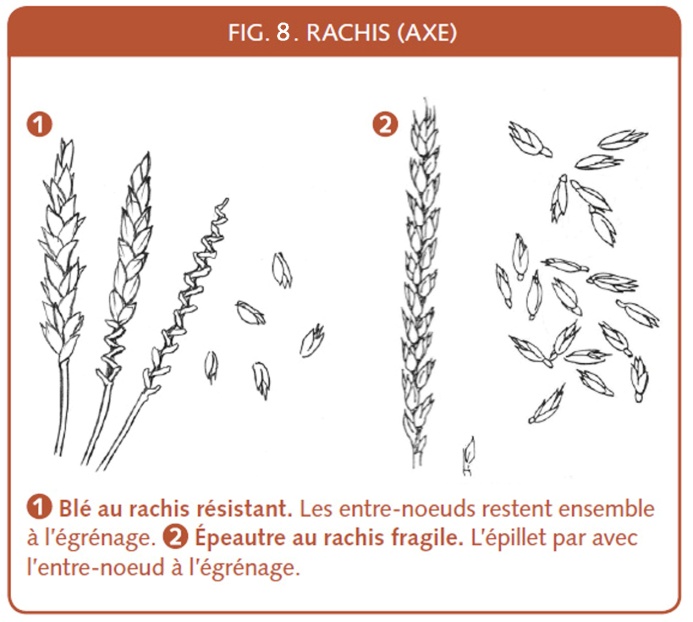
Il faut environ 190 kilos d’épeautre « vêtu » pour avoir dans les 133 kilos de grain « nu », qui donneront 100 kilos de farine blanche. Ces chiffres tiennent compte d’une perte de plus ou moins 30 % due au poids des enveloppes paillées. Les écrits donnent des chiffres différents sur la perte de poids lors du décorticage. En Belgique, on reprend ce 30 % de balles[75]. Le spécialiste allemand de la meunerie parle de 30 à 35 %[76] et une recherche historique relève dans ses références du xixe siècle une fourchette encore plus grande de 25 % jusqu’à 50 %, les mauvaises années[77].
Deux Français voyageant en Allemagne au xviiie siècle permettent de comprendre l’ancien procédé de décorticage de l’épeautre.
Tout d’abord M. Reneaume en 1708, qui précise que les allemands ont inventé des moulins qui ne servent qu’à dépouiller le grain de sa balle. Les meules ne mordent point le grain et un tuyau ou porte-vent est installé à l’endroit où sort le grain mêlé avec sa balle. Par ce moyen, il tombe tout nettoyé dans la maie, ce qui est fort commode. » Voyons ensuite le témoignage de Villeneuve en 1793. L’opération de décorticage « se fait par des meules tenues assez écartées pour ne pas endommager le grain. L’enveloppe seule est froissée, détachée et jetée au loin par un ventilateur que fait tourner la lanterne [engrenage en bois fixé sur l’axe]. C’est une machine fort ingénieuse que nous ne connaissons pas »[78].
De nos jours, il ne reste plus beaucoup de connaissances meunières du décorticage par les meules de pierres spécifiques, piquées çà et là, plutôt que garnies de sillons et de fines rhabillures (XII.7.). Les derniers meuniers sont parfois partis sans léguer ce savoir-faire. Des décortiqueuses par abrasion ont plus tard fait leur apparition comme nous le verrons chapitre XII.4.
Il est difficile de savoir qui, de l’épeautre ou du froment, précéda l’autre dans la préhistoire, bien que des recherches récentes osent proposer une hypothèse comme nous le verrons plus loin, on sait que l’un et l’autre ne sont pas des blés « sauvages » ou « primitifs ». Ils sont nés tous les deux en culture domestiquées[79]. Au Moyen Âge, la majeure partie des terres du nord de la France était ensemencée par trois céréales : l’épeautre, le seigle et l’orge. En 850, à Reims, le « spelta » des documents d’époque rédigés en latin tient la première place dans le rang des céréales[80]. Plus on descend vers le sud, du côté de Chartres, moins on mentionne la présence de l’orge.
Signalons que la culture de l’épeautre n’aime pas du tout la chaleur, surtout à ses pieds. Pour cette raison, les terres sablonneuses qui se réchauffe vite, ont rarement été choisie pour accueillir cette céréale vêtue[81]
D’après l’historienne du pain au Moyen Âge, Françoise Desportes, « passé le xie siècle, plus aucun document ne mentionne l’épeautre là où il avait été abondant ». Un autre historien écrit que dès le Haut Moyen Âge (vers l’an 1000), l’épeautre est devenu une « céréale régionale » par contraste avec l’orge et le froment et dans une moindre mesure l’avoine et le seigle[82]. C’est au xiie siècle que Sainte Hildegarde de Bingen (*1098 – †1179) prône une table sobre, mais surtout saine, dans son monastère sur le Rhin entre Koblenz (Coblence) et Mainz (Mayence)[83]. Elle met en avant l’épeautre pour la santé[84]. Revisitant ces écrits, une thérapie, une diététique et des centres de cure vont naître au xxe siècle[85].
Avant la Révolution française, l’épeautre n’occupe, par défaut, que les terres les plus pauvres, parce que le froment (son frère chromosomique, nu) n’y croît pas bien[86]. Beaucoup de raisons sont données pour expliquer ce déclin. L’épeautre « ne rend que peu de farine par l’abondance de son qu’elle fait en étant moulue ou pelée, cause qu’en ce Royaume, maintenant, telle sorte de blé n’est plus beaucoup prisé », écrit Olivier de Serres en 1605[87]. Le réchauffement du climat ouvre au froment des terres réservées à des céréales plus rustiques et ferme aussi l’accès aux cultures à l’épeautre qui n’aime pas tant la chaleur. L’amélioration des méthodes agricoles et meunières peut être le résultat comme la conséquence de l’emprise du froment sur les terres cultivables[88]. L’agriculteur tire progressivement profit d’une meilleure traction animale, le cheval remplace peu à peu le bœuf. Les charrues plus lourdes permettent, mieux qu’avant, l’exploitation de terres argileuses compactes[89]. L’apparition et la diffusion des moulins à eau éliminent graduellement les traitements domestiques au pilon et moulin à bras [90]. Une autre raison est l’exigence du peuple (on dirait aujourd’hui, les consommateurs) qui ne manqua pas de manifester, parfois avec fracas, sa demande d’un pain de qualité supérieure (lire ; pain blanc) [91]. Des locutions anciennes disaient même : « pain d’épeautre, pain de pauvre » ou « grain de pauvre » probablement parce que cela rimait, ces expressions seront reprises en 1980 et 2001 dans des revues hebdomadaires[92]. Mais peut-être qu’il s’agit aussi d’une farine grossière qui contenait encore de la balle, lorsque l’on broyait sans décortiquer et ne retirait les pailles qu’au blutage.
L’épeautre a été choisi par des agriculteurs « alternatifs » assez vite comme blé « ancien ». D’abord, parce que bien plus panifiable que les autres céréales plus difficilement maitrisables en panification et dès lors mieux acceptée par les consommateurs. C’est un blé tendre, contrairement aux amidonniers et à la majorité des poulards. Et puis, il est choisi pour des raisons écologiques. En réponse à des effets négatifs de l’évolution de la culture céréalière, on écrira « plus officiellement ou scientifiquement » que l’épeautre « pompe » mieux les nitrates qui polluent l’eau [93]. L’explication vient de son occupation plus précoce du sol : il est semé en septembre-octobre et récolté onze mois plus tard, en août, une longue couverture du sol qui laisse moins migrer l’azote vers la nappe phréatique.
Dans certaines zones polluées d’Allemagne, les agriculteurs ont reçu des subsides incitant à la culture de l’épeautre pour ce type d’effets dépolluants. L’épeautre a en effet plus de paille et une végétation (feuilles et racines) plus importante[94].
En Allemagne toujours, dans le milieu du xixe siècle, le Land du Bade-Würtemberg ensemence 200 000 hectares d’épeautre. Cela ira décroissant pour tomber en chute libre, au milieu du xxe siècle, jusqu’à atteindre 1 000 hectares en 1970. Difficile de tomber plus bas. Les surfaces remontèrent à 9 000 hectares en 1991. C’est ce que d’aucuns appellent là-bas, le « boom de l’épeautre [95] ». Cette renaissance n’est pas vécue qu’en Allemagne, mais aussi en Autriche, en Suisse et Belgique [96]. Dans ce dernier pays, il existera une initiative bien conjuguée pour relancer le grand épeautre. Côté agriculture, une coopérative « Spelta » relance la culture. Une association aujourd’hui disparue, le centre d’intégration des recherches sur l’épeautre (CIREp) assura une logistique centralisatrice de promotion et de recherche, et conjugua ses efforts avec les recherches de la faculté agronomique de Gembloux pour obtenir, début des années 1980, les nouvelles variétés dont nous allons parler plus loin[97]. Le centre initiera une unité de décorticage par abrasion et les grandes meuneries vont moudre et commercialiser la farine d’épeautre. Une commission « pain d’épeautre d’Ardenne » créée par l’Union professionnelle des boulangers de la Province du Luxembourg belge lancera en mars 1982, une marque collective, avec charte et appellation contrôlée au début[98].
Cette initiative tombera en désuétude et la dynamique a été relancée au début des années 2010, sur une aire plus restreinte, celle du parc naturel de Haute-Sûre, avec une marque collective, un cahier des charges et l’ambition d’obtenir l’identité géographique protégée [99] (Igp).
Signalons qu’il devient assez difficile de différencier l’épeautre du froment, lorsque l’on achète la farine, bien qu’au point de vue de la génétique (critère important dans la classification des céréales), l’épeautre possède le gène speltoïde -q au lieu du gène Q [100].
Si le boulanger n’a pas la possibilité d’avoir une filière commerciale courte et proche ou une traçabilité bien contrôlable de visu, comment savoir si la farine reçue est bien une farine d’épeautre ? Un outil d’analyse est venu sur le marché en 2000. Il s’agit d’une technique spectrométrique de fluorescence induite par laser qui met à jour la signature moléculaire spécifique du produit alimentaire. Afin de décourager la supercherie potentielle ou falsification mélangeant ou vendant du froment à la place, puisqu’elle se vend souvent le double du prix, qui s’est malheureusement vérifiée en Suisse[101]. Voilà qui va encore ajouter des charges pour devoir prouver son honnêteté. Nous vivons malheureusement dans un monde dévoyé par l’appât du gain.
Alors comme pour rester dans la transparence qui sait mieux se vivre dans un circuit court, parlons terroir de l’épeautre. L’épeautre est cultivé dans les régions humides à sols froids. De ce fait, l’épeautre est appelé « blé des montagnes » ou « blé de Souabe » (Schwabenkorn). À l’intérieur de ces pays, il est simplement dénommé, le blé ou le grain. C’est le cas en Souabe, en Suisse[102], en Espagne[103] et en Ardenne belge[104].
Dans les premiers écrits, il était appelé blé Loca ou Locar[105]. En dialecte « schwäbisch », et en Suisse, il existe encore l’expression « Veesen » et « Fesen » qui veut dire épillet. Du dialecte « schwäbisch », on trouvera généralement l’expression « Dinkel » qui vient de Thinkil venant du vieil allemand grain, blé. Dans un dialecte rhénan, on l’appellera « Spelt » ou « Spelz » qui veut dire glume ou balle. C’est de cette expression que l’on peut partir à l’origine du mot de l’ancien français « espeautre[106] ».
Avec la linguistique, on a déjà pu localiser les régions de l’épeautre. En Ardèche, Olivier de Serres, en 1601, mentionne l’épeautre comme se maintenant « en certains endroits d’Italie et d’Allemagne et par toute la Suisse, où il est réputé[107] ». Antoine Parmentier, en 1772, cite encore l’Italie[108] avec la Suisse et ajoute à la liste des régions d’épeautre en France, l’Alsace et quelques parties de la Picardie[109]. Il oublie l’Allemagne, qu’il a pourtant connue en captivité, mais c’était au Nord du côté de Hanovre, qu’il fut prisonnier. L’épeautre est aussi un peu présent en Rheinland-Palatinat. La région allemande spécifique de l’épeautre se situe au Sud entre Boxberg et Bad Mergentheim et tout le Bade-Wurtenberg, sur les contreforts du Jura Souabe et du Jura de Franconie. Sur les mêmes contreforts du Jura entre Neufchâtel et le lac de Zurich se situe dans le Nord de la Suisse la continuation de la zone Sud de l’Allemagne. En prolongation à la zone Sud-Ouest allemande, se situent l’Ardenne et la Famenne[110] belge. La Slovaquie, la Slovénie et les Carpates prolongent vers l’Est cette zone du centre de l’Europe dédiée à l’épeautre. Seules les Asturies, au nord de l’Espagne, sont à l’écart de cette zone centrale européenne[111] et aurait peut-être une origine différente[112]. Puisque des recherches récentes ont pu différencier deux grandes familles d’épeautre qui ont migré par les voies continentales (souvent par le Danube) et asiatique (par l’Afrique du Nord et l’Espagne) et semble déterminer que c’est le froment qui donnera l’épeautre et non l’inverse.
Comme la sélection de l’épeautre n’a pas connu la même évolution que le froment, c’est-à-dire qu’il n’a pas été adapté à l’intensification croissante de l’agriculture. Il a d’abord profité des soins des agriculteurs bio-dynamistes et biologiques qui l’ont maintenu en culture et l’ont sauvé de l’oubli. C’est le raccourcissement des pailles (V.9) qui mettra en avant l’épeautre, puisque c’est la céréale qui a la plus longue végétation (en durée) et la plus grande masse (en volume). S’il est vrai que l’on trouve toujours d’anciennes variétés d’épeautre sur le marché[113], il est plus diversement connu par ailleurs que certaines variétés récentes ont cherché à s’adapter aux exigences nouvelles de l’agriculture. Ainsi, en Wallonie, qui se dit parfois un peu pompeusement le premier producteur mondial d’épeautre, les variétés issues de la faculté agronomique de Gembloux, depuis l’année 1965, sont sujettes à discussion.
Comparativement aux épeautres des régions germaniques qu’il s’appelle « Dinkel », le spécialiste allemand du grand épeautre C.I.Kling dénomme les épeautres belges, les « Dinkel-Weizen », soit les épeautres fromentisés. Le Centre de cure d’Allensbach-D sur le lac de Constance (Bodensee) adepte de la thérapie hildegardienne ne s’autorise que cinq variétés dites « pures ». Le docteur Hertzka, fondateur de la médecine hildegardienne et son successeur le Dr. Strehlow, ne voulant entendre par épeautre que les épeautres traditionnels, donnent une liste, où le Franckenkorn ne sera plus présenté en 2017. Le Schwabenkorn serait issu vers 1988 de croisement spontané avec un hexaploïde au sein des champs du Centre de recherche d’Hohenheim[114]. La variété Bauländer: principalement employé pour la production de « grünkern » (XI.11.) est originaire du Bauland en 1924, région au Nord de l’ex – Grand Duché de Bade. La variété Ostro et l’Oberkulmer Rotkorn de 1948 que nous revoyons par après seront aussi dans la liste des épeautres « hildegardiens » (fig.9).
Les Suisses ont lancé en 2014 une appellation protégée sur l’épeautre qui, rappelons-le, est parfois surnommé « blé des montagnes ». La dénomination « épeautre pur suisse » est conditionnée au respect d’un cahier des charges assez strict dans lequel seules les variétés Oberkulmer et Ostro (issue d’un croisement entre Oberkulmer et Steiners Tyroler Roter Tyroler) sont acceptées. Sur la plate-forme des agriculteurs bio suisses, bioactualités.ch, on se demande si l’actuelle recrudescence des problèmes d’intolérance au blé ne vient pas de la sélection trop spécialisée et orientée par la recherche de haut rendements et l’exigence de valeur technologique de la boulangerie moderne (baisse de taille des pailles et protéines différentes[115]). Ils remarquent aussi que les types d’épeautres provenant des régions pluvieuses avaient des épis lâches, tandis que les formes issues des régions plus basses du plateau étaient plus fermes et plus dressées. Ils signalent enfin, que les nouvelles variétés d’épeautre de Peter Kunz sont consommées depuis plus de dix ans par de très nombreuses personnes, et il n’y a aucun rapport d’une quelconque intolérance. En 1996 déjà, des tests de biorésonnance ont permis de montrer que la nouvelle variété « Alkor » (1997) était « aussi bien tolérée que les autres variétés d’épeautre ». Une étude effectuée en Bavière avec des tests d’allergie sérique, c’est la seule expérience de ce type que nous connaissions à ce jour, n’a mis en évidence aucun indice précis d’un potentiel allergénique plus élevé. Au contraire, les nouvelles variétés d’épeautre, parmi lesquelles se trouvait la variété Alkor, ont même été classées comme étant meilleures que les « anciennes variétés ». Même la variété Sirino (2000) n’a jusqu’ici fait l’objet d’aucune annonce de suspicion de moins bonne tolérabilité. Et des produits alimentaires pour la prime enfance, qui sont très appréciés et considérés comme parfaitement digestes, sont fabriqués depuis des années avec Sirino.
C’est depuis la variété d’épeautre belge, « Ardenne », l’année 1965[116], que le centre de recherche agronomique wallon (Craw) de Gembloux a introduit les gènes d’un froment suédois (Virtus). La variété « Ardenne » n’eut pas beaucoup de succès commercial et d’après le témoignage d’agriculteurs, était plus un blé nu que vêtu. L’intention des chercheurs de la faculté agronomique de Gembloux était de régénérer les gènes de l’épeautre. En le croissant avec un parent éloigné on obtient plus d’effet d’hétérosis et la descendance donne plus de potentialité de choix dans les lignées. Comme du point de vue des chercheurs, l’épeautre et le froment étaient des hexaploïdes, il n’y avait pas, pour eux, de problème de mélanges d’espèces. Lorsqu’apparurent la critique allemande et la demande exclusive de races pures, les chercheurs belges firent remarquer qu’un des cinq épeautres acceptés par l’école hildegardienne avait dans ses gènes la variété belge Rouquin. Il s’agissait de l’obtention de Peter Franck, le Franckenkorn, qui a également pour géniteur Altgold et un blé mutant[117].
De par la sélection opérée en Belgique et dans d’autres pays, le grand épeautre entre même dans le club des cent quintaux à l’hectare. Ce rendement est obtenu sur épeautre fourrager, dans des essais probablement fort soignés et onéreux en fertilisation, peu reproductibles sur le terrain[118].
Une petite comparaison nous fera comprendre ce que, de nos jours, la Faculté agronomique de Gembloux elle-même, appelle une dérive[119]. Avec la variété Rouquin de 1979, on obtenait en moyenne 60 quintaux à l’hectare[120]. La variété dite « Lignée 24 », d’avant le croisement avec le froment, donnait environ 30 quintaux, la variété « Lignée 10 » 24 quintaux, et il existait encore une vieille variété ardennaise appelée « Lignée 73 », dite « blanc de Gembloux », qui donnait 34 quintaux[121], c’était aussi à une autre époque (avant 1900).
| fig.9. Descendances de quelques variétés d’épeautres européens | |||
| Espèces variétales | Pays d’origine | Date homologation | Descendances |
| Oberkulmer Rotkorn | CH | 1948 | Croisement d’anciens épeautres suisses réalisé par le centre de recherche de Reckenholz à Zurich. |
| Altgold | CH | 1952 | Sélection dans Oberkulmer Rotkorn. |
| Ardenne | BE | 1965 | Croisement entre un froment suédois (Virtus) et un ancien épeautre belge |
| Ostro | CH | 1978 | Croisement entre Oberkulmer Rotkorn et Steiners Roter Tyroler |
| Rouquin | BE | 1979 | Croisement à trois voies entre (Lignée 24 X Ardenne ) X Altgold |
| Frankenkorn | DE | 1980 | Croisement à trois voies de Peter Frank entre (Altgold X Rouquin) X Altgold |
| Schwabenkorn | DE | 1988 | Croisement spontané de Roter Tyroler avec un autre hexaploïde au sein des champs du centre de recherche d’Hohenheim. |
| Zollernspeltz | DE | 2006 | Sur la publicité de la firme déclaré d’épeautre pur reconnu officiellement. Dans la pratique, on y décèle un gluten tenace peu présent chez les épeautres originaux et obtenu par rétrocroisement. |
| D’après KLING,1993, GEISSLER, 2018, publicité de Zollernspelz et renseignement reçu auprès du CRA W de Gembloux | |||
Quoi qu’il en soit, la « typicité » de l’épeautre est donc souvent remise en question et l’on remarque qu’aussitôt que le marché devient porteur, cela change la donne. L’analyse des protéines des « nouveaux épeautres » a laissé entrevoir une différence entre les variétés bios suisses et allemandes (souvent des re-sélections ou croisements entre anciens) et les « épeautres-fromentisés » belges, même si pour certains scientifiques cela nécessite un approfondissement[122]. Mis à part un rétrécissement des pailles de vingt centimètres, rien ne permet de distinguer visuellement, les nouvelles variétés d’« épeautres fromentisés » belges, d’après C.I. Kling le chercheur spécialiste de l’épeautre à l’Université de Hohenheim-Stuttgart.
Au Canada, on s’est employé en 1988 à développer un épeautre de printemps plus petit en hauteur de paille, la variété Champ, pour les courtes saisons et moissons canadiennes[123].
Les bio-dynamistes ont sauvé et créé plusieurs variétés d’épeautres. Exemple : du centre de sélection de Darzau, la variété « Kipperhaus Weisser Spelz » (un épeautre blanc de 1997), ainsi que les variétés « Alkor » de 1997 et « Sirino » de 2000, du centre de sélection céréalière de Peter Kunz à la ferme de Breitlen à Hombrechtikon (CH). Il a fallu plus de quinze ans à Peter Kunz pour sélectionner, stabiliser, reproduire puis faire agréer ces variétés. L’obtenteur suisse et bio-dynamiste Peter Kunz est un des rares qui tient compte du test de panification lors de ses choix de sélection. Il a souhaité aussi confronter ces nouvelles variétés d’épeautre précitées au problème de digestibilité rencontré par les consommateurs. Il se dit encouragé que sa variété « Alkor » sur le marché pendant cinq ans n’a entraîné aucune plainte à ce sujet[124].
On remarque que ça bouge beaucoup sur le marché du grand épeautre et d’autres anciens blés pourraient bientôt connaître les mêmes vicissitudes.
Au niveau nutritif, dès le xiie siècle, Sainte Hildegarde de Bingen a attribué beaucoup de vertus à l’épeautre et cela sera repris par l’actuelle école de Sainte Hildegarde, qui ne soigne pas que le corps, mais aussi l’âme et l’esprit. Par des termes très fervents, on fait l’éloge de l’épeautre, « si je venais à être atteint du cancer, je me retirais sur un alpage avec un sac plein d’épeautre, afin de voir qui du cancer ou de l’épeautre serait le plus fort ». Ou encore, « l’excellente solubilité de l’épeautre constitue un de ses principaux avantages[125] ».
En 1778, Antoine Parmentier signale déjà la meilleure qualité digestive du pain d’épeautre[126], mais, sur ce sujet, les commentateurs de l’époque ne sont pas unanimes[127]. Le grand épeautre reprend des galons depuis que la recherche de qualité alimentaire s’opère quand la recherche de quantité est assurée. Sa balle protectrice n’est plus un obstacle technique et un désavantage économique, mais un avantage dans la lutte contre la pollution atmosphérique (notamment nucléaire). Lors de l’accident nucléaire de Tchernobyl, on a comparé l’épeautre au froment « non vêtu », le premier contenait dix fois moins d’éléments radioactifs[128]. La différenciation des protéines du froment et de l’épeautre n’est pas évidente avec les techniques d’analyses de prédiction. Certains chercheurs comparant les anciennes variétés comme le Steiners Tyroler et l’Oberkulmer au nouvel épeautre belge Rouquin, ont remarqué que ce dernier avait les meilleures qualités panifiables, mais d’autres profils d’α-gliadine et de teneurs en hauts poids moléculaires supérieures (VII.7) [129].
Pour comparer les protéines de l’épeautre et du froment, on peut juste constater une plus grande quantité en protéines, (jusqu’à 16 %) et pour les enquêtes sur les anciens épeautres en Italie, des fourchettes de 9,8 à 25,5 % de protéines pour les épeautres, pour 10,9 à 17,5 % pour les froments. Ces derniers ayant subi un certain nivellement de la diversité, de par la sélection plus intensive portée sur cette céréale[130]. Une valeur d’équilibre nutritionnel des acides animés semble supérieure du fait que malgré des teneurs en protéines supérieures, cela ne se reflète pas en termes de qualité « plastiques » des pâtes et hauteur des pains[131]. Cette teneur n’explique pas, pour beaucoup de scientifiques pourquoi les personnes sensibles supportent mieux l’épeautre que le froment. Dans sa composition résultant de l’analyse chimique, décortiqué d’une autre manière en somme, on se doit de comparer l’épeautre à son frère « chromosomique » ; le froment. À condition de comparer des farines complètes entre elles, on relève quelques différences, toutes à l’avantage de l’épeautre. Les teneurs en vitamines B1 (Thiamine), B2 (Riboflavine) et B6 (Pyridoxine) sont au moins du même ordre que le froment qui en est déjà bien pourvu[132]. La vitamine E (Tocophérol) est souvent citée comme spécifique à l’épeautre par des écrits « grands publics », mais les teneurs sont dites semblables au froment et au seigle par des analyses. La pro-vitamine A (Caroténoïde) est réputée plus présente dans les « anciens grands épeautres », mais encore une fois aucune source de recherche dans la littérature officieuse en notre possession ne permet de le mentionner pour le « grand épeautre ». Il est parfois facile de dire que ce n’est pas avéré, lorsque l’on ne prend pas la peine d’analyser scientifiquement en quantité suffisante. Dans les sels minéraux et les oligo-éléments, l’épeautre dépasse le froment. Il a ici le retour positif du désavantage de posséder plus de fibres. Le magnésium (Mg), le phosphore[133] (P), le zinc (Z) et le cuivre (Cu) sont les éléments les plus représentés dans la plus-value[134].
Le grand épeautre est utilisé en grains, flocons, semoules, « grünkern » et pains. Une forte mixité de transformation que ne connaissent ni le riz, la céréale cuisinée par excellence, ni le froment, la céréale la plus recommandée pour la panification. Le grand épeautre contient une grande proportion de protéines, ce qui le rend panifiable en suivant les mêmes principes de panification que le froment[135].
Fin des années 1980, des essais répertoriés par le CIREp belge signalent une moins grande élasticité de la protéine sur la variété « Rouquin », qui était pourtant déclarée comme la plus panifiable des sortes de grand épeautre à cette époque. Autre remarque de leurs essais, les tests prédictifs (Zélény et Alvéographe Chopin) sont moins probants pour l’épeautre que pour le froment. Il vaut mieux, dit le CIREp, en revenir aux tests de panification. Un pétrissage lent et un apprêt plus court caractérisent la panification du grand épeautre d’après les expériences belges[136]. Autre précision belge, la meilleure résistance du grand épeautre à la germination sur pied, lui donne un avantage sur les autres céréales, les années pluvieuses[137]. Le 17 mars 1982, après six années d’études et de mise au point fut présenté le « pain d’épeautre d’Ardenne ». La recette a été mise au point par Victor Christophe, un boulanger de La Roche-en-Ardenne, en Belgique. La pâte reçoit un apport de préfermentation d’environ trois heures sur poolish de moitié et contient 70 % de farine d’épeautre et 30 % de farine de froment type 65[138]. Personnellement, je préférais la panification au levain sur trois rafraîchis pour se marier avec le goût de l’épeautre clair. En Allemagne, des essais démontraient aussi la grande qualité panifiable de « Rouquin[139] » et « Baulander[140] ». Panifié à l’allemande, c’est-à-dire en grains concassés en éclats (Vollkornschrotbrot), le développement de l’amidon (on ne parle pas d’alvéolage, ici) est supérieur sur le grand épeautre par rapport au froment[141]. D’après des résultats d’essais allemands, il est probable qu’il faut accorder autant d’importance, sinon plus, à l’effet pentosanes qu’à l’effet gluten dans le développement de ce type de pains et remarquer que les variétés contenant beaucoup de protéines ne sont pas celles qui donnent le plus de volume aux pains de grains concassés en éclats (X.7).
Au vu de toutes ces analyses « modernes », il est surprenant de voir les descriptions des spécificités panifiables du grand épeautre par Parmentier en 1778. Il écrit qu’il faut de l’eau moins froide et plus de levain que pour le froment, pour ne pas avoir un pain « lourd ». Un « apprêt » moins fort et une cuisson moins vive[142]. Pour moi c’est « lumineux ». Il est vrai qu’avec ces écrits, on est au « siècle des lumières ».
X.4.1. Les blés Macha et Vavilov
Il existe dans les blés anciens ou primitifs, des « frères chromosomiques » au grand épeautre, c’est-à-dire des céréales qui ont le même nombre de chromosomes. Il s’agit ici du Triticum Macha, le blé Macha, présent dans le Caucase qui est un blé vêtu.
Le Triticum Vavilovii, blé Vavilov, du nom du chercheur russe, est un peu cultivé en Arménie[143], au point qu’on le dénomme parfois, blé d’Arménie. Il faut peut-être aller dans leurs pays d’origine pour voir leur « tronche » de pain.
X.5. Les blés durs
On revient vers des blés durs dans leur texture. Ce sont même ceux qui se dénomment comme tels dans les classements botaniques.
Le blé dur est à différencier du blé tendre. Ce sera dur, dur pour faire cette distinction[144], surtout, comme nous le verrons plus loin, si l’on est traducteur. Pas tellement par le fait plus qu’apparent, que tendre et dur font un contraste bien marqué dans le cœur du grain, mais parce que la frontière entre les deux peut parfois être bien difficile à définir au niveau dureté, il existe beaucoup de cas limite (X.3.1).
La différenciation par classement d’espèce du blé dur à part entière apparait même très tard dans l’histoire. Dans l’Encyclopédie méthodique de 1784, Alexandre Henri Tessier est parmi les premiers à faire une distinction claire entre le blé dur et le blé tendre. Après bon nombre d’expériences, il en conclut que les blés tendres sont favorisés par les climats du Nord et le blé dur par les sécheresses plus fréquentes du Sud, a fortiori en Afrique du Nord. C’est justement au nord de l’Afrique et principalement en Algérie que René Louiche Desfontaines séjourna, pour y étudier la flore pendant deux ans. Et c’est à ce dernier que l’on attribue la première dénomination de triticum durum[145], tout au début du xixe siècle dans son ouvrage sur la flore atlantique.
Cette nomenclature sera entérinée par les efforts classificateurs qui suivront, notamment ceux de De Candolle et Seringe, deux exilés d’origine française en Suisse. Et ce sera par la connaissance des chromosomes dans l’entre-deux guerres que l’on scellera génétiquement la frontière entre blé tendre, hexaploïde, et blé dur, tétraploïde (III.3 et IV.3.1).
Il est un peu logique que l’on ait réuni pendant longtemps les blés tendres et durs, puisqu’on les mélangeait pour composer la farine panifiable en France. Ainsi Eugène Péligot du Conservatoire des Arts et Métiers (Cnam) recevra en 1849 des échantillons de grains des Grands Moulins de Corbeil (ex-Grands Moulins du Roi) tenu par la famille Darblay proche de la famille Vilmorin, au point qu’en 1869 Louise Darblay épousera Henri de Vilmorin[146]. Dans ces échantillons figurent deux blés durs ; le blé dit d’Espagne (X.2.3) et le blé Tangarock ou Taganrock qui sont réputés « affluents sur le marché de Paris » ou « comme étant très commun et très abondant à Paris[147] ».
Ce même blé Tangarock, qui provient de la ville portuaire russe de Taganrog, situé sur le bord de la mer d’Azov en face du delta du Don, a transité par le port de Marseille pour aboutir dans l’Ain en 1821-1822. On peut lire, dans un rapport de la Société d’agriculture régionale, qu’il s’agit peut-être d’une « transmutation de blé dur en blé tendre[148] ». L’identification du blé dur est probablement plus confuse à l’époque que de nos jours. En 1828, c’est à Chalons-sur-Marne qu’un comice agricole mentionne les premiers essais du blé Tangarock[149]. Henri de Vilmorin présente en 1880 le blé Taganrock (et non Tangarock) comme synonyme du Poulard blanc lisse[150].
Ces mentions historiques étalées sur soixante ans peuvent facilement nous faire croire que la variété est bien originaire de Russie et d’Ukraine orientale, mais qu’une sélection massale l’a adapté sur le sol français (IV.3.2). Il ne s’agit probablement plus de blé d’importation nord-africains à l’époque où les Grands Moulins de Corbeil de la famille Darblay le procure au chercheur Eugène Péligot. La variété Tangarock est toujours utilisée actuellement pour la confection de pâtes bio dans les Marches, en Italie[151].
L’Atlas des produits typiques d’Italie consacré au pain, réalisé en 1997 montre que 28 % des pains cités étaient réalisés avec du blé dur[152]. Cultivé principalement au sud du pays et, par exemple, pour un des plus connus, à Matera dans le Basilicate, on doit utiliser des blés mentionnés dans le cahier des charges de l’Igp. Ce sont les variétés Senatore Cappelli, Duro Lucano, Capeiti et Appulo dont les farines donnent un goût unique au pain. Ces variétés anciennes doivent entrer dans la composition du pain italien au blé dur[153].
À Altamura, l’autoproclamée « cité du pain », on fait un pain avec des farines de blé dur déjà réputé et vanté par le poète Horace (* -65 avant J.C. – †-8 avant J.C.). Son appellation d’origine protégée exige le recours aux variétés Appulo, Arcangelo, Duilio et Simeto, les trois dernières variétés citées étant des descendantes directes de Senatore Capelli , qui elle-même a été obtenue en 1915 à partir de la variété-population tunisienne Jeanh Rhetifah [154].
La variété Senatore Capelli est aussi utilisée par certaines boulangeries de cette ville des Pouilles, remarquable pour avoir vu un McDonald’s fermer boutique en moins de deux ans, coulé par la concurrence de la foccaccia artisanale locale [155].
Le cultivar Senatore Capelli, nommé ainsi en hommage à un homme politique qui fut ensuite ministre de l’Agriculture sous Mussolini, a été obtenu en 1915 par Nazareno Strampelli, chercheur de renom international qui fut un des premiers sélectionneurs de blé à introduire des gènes de nanisme grâce aux apports de la variété japonaise « Akagomugi ». Cette création introduisit également les gènes de la variété néerlandaise Wilhemina et de la variété Rieti pour créer la variété de blé tendre Ardito en 1920[156]. Ce chercheur dédiera une de ces obtentions au sénateur Rafaelle Cappelli qui, au tournant du xxe siècle, établit des réformes agraires en Italie. Le dirigeant italien B.Mussolini avait comme objectif l’autonomie du pays en production du blé, alors déficitaire. Il établit en juin 1925 la campagne dénommée « la bataille du blé » qui atteint ses objectifs dans les années 1930[157].
Depuis 2016, une société commerciale italienne a déposé le nom Senatore Capelli , ce qui ne permet plus la commercialisation de ces semences sous ce nom, sans devoir payer de royalties[158]. Depuis, beaucoup utilise d’autres variétés de blés durs (descendante de Capelli) en remplacement.
On le voit, l’Italie abrite de nombreux pains d’origine protégée. Depuis 2009, le pagnota del Dittaino, dans le centre de la Sicile est encore de ceux-là. Il est réalisé avec des blés durs, dans des proportions variant de 30 à 70 %[159]. Il existe encore bien d’autres pains typiques et « locaux », à vous de les découvrir[160].

D’autres variétés de blés durs italiens, sont presque légendaires. Le timilia, un blé dur semé au printemps et, de ce fait, qualifié « de trois mois » ou « trémois ». C’est le temps qu’il lui faut pour venir à maturité, même si c’est souvent un peu plus long suivant les climats et pays. Il s’appellera trimenia chez de Vilmorin[161], et il est déjà cité très tôt dans l’histoire, notamment par Columelle, (livre 2, chapitre 6) qui cite ses variantes [162].
La variété population Rusello a été choisie par Adriano Farano pour son goût et parce qu’elle contenait des protéines ne laissant pas de résidus insolubles après une fermentation au levain d’après son approche analytique [163].
Vous aurez peut-être remarqué que tous ces blés durs sont barbus et parfois bien barbus même.
Comme si le fait d’être dans les zones arides qui leur conviennent pour donner un albumen fort « cimenté » donne ces expansions en silice pointées vers le ciel pour mieux capter la rare humidité ambiante ou sous forme de rosée ou gouttelettes de pluies.
L’exemple extrême est ce dessin du frère du peintre dit le Raphäel des roses, Pierre-Joseph Redouté. Il s’agit d’Henri-Joseph Redouté et du blé dit d’égypte par A. Delile[164] (fig.10).
Lorsque l’on regarde l’albumen amylacé, terme utilisé pour signifier que cet amidon est enserré de protéines, on remarque que pour le blé dur, il l’est de manière serrée. En tranchant le blé dur, on ne voit pas un aspect farineux, mais glacé, quasi translucide ou plus souvent dit vitrifié.
Lors de sa maturation, l’épi de blé passe d’une teneur en humidité de 40 % d’eau à l’état laiteux jusqu’à 12 % arrivé à maturité[165]. L’albumen amylacé se forme progressivement en cellules pour arriver à l’épi mur et sec[166]. La cellularisation croit de la périphérie vers le centre, d’où des liaisons plus résistantes dans le pourtour[167].
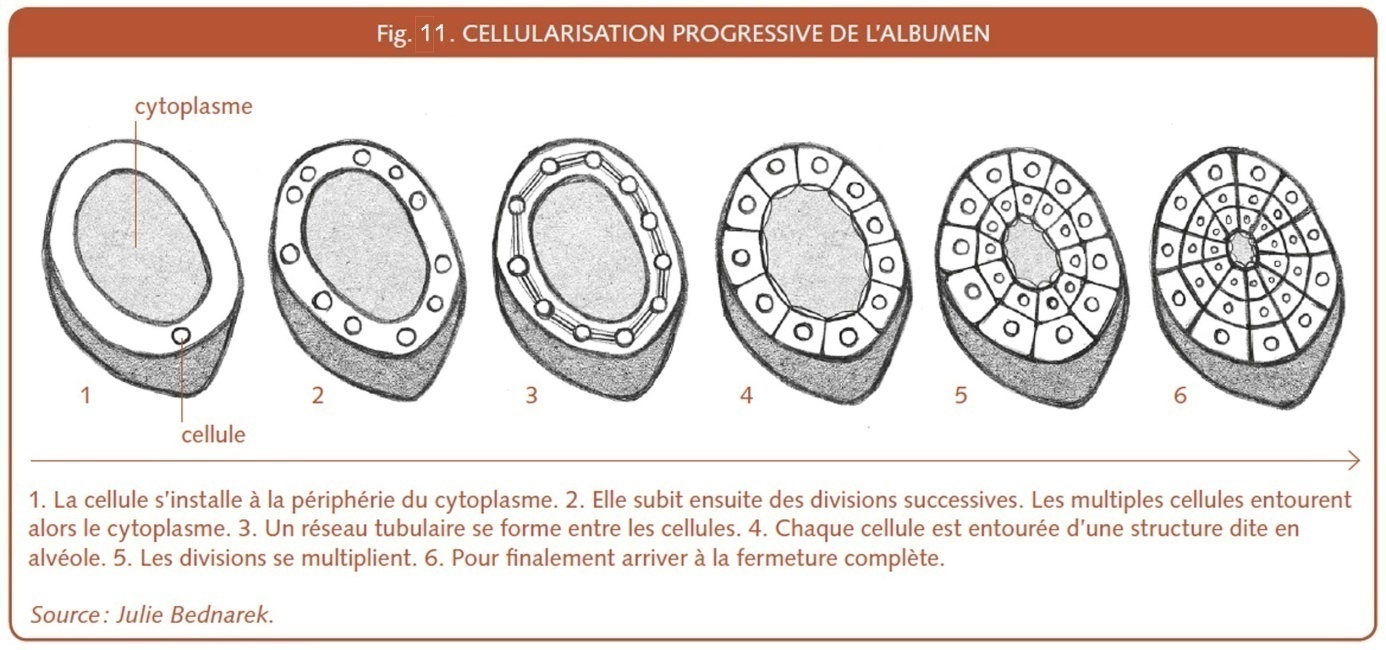
Il est probable que dans des climats très secs, la cellularisation est favorisée et plus compacte. Et comme on le remarque dans le schéma (fig.11), elle va, comme la minéralisation du grain, du périphérique vers le centre.
Il peut toutefois se produire un phénomène redouté par les semouliers et producteurs de semoule de blés durs, le mitadinage.
Il faut savoir que pour la fabrication de semoules, pour la polenta, le couscous et les pâtes alimentaires, on recherche particulièrement ce caractère granuleux sorti de la mouture, contrairement à la farine dédiée à la panification. Or le mitadinage, est considéré comme un accident climatique de la culture du blé dur, qui ne permet pas bien le transfert d’éléments du fait d’un manque d’humidité ambiant qui empêche la transformation des cellules en plus grosses particules et développe des aspects farineux non souhaité en semoulerie.
Précisons qu’au sud de la France au milieu du xixe siècle, des blés sont dénommés mitadins (ou mi-durs) du côté de Toulouse par Julia De Fontenelle[168], il s’agirait d’après Emmanuel Le Roy Ladurie et Georges Comet d’un semis mélangé de blés tendres mêlé avec des blés durs provenant d’Afrique du Nord ou d’Espagne[169]. Nous sommes, avec des blés, qui rappelons-le, à cette époque, sont encore en France utilisés en panification, surtout du fait qu’ils sont déjà repérés comme plus riches en nutriments, même si l’on parle déjà de gluten plutôt que de protéines, mais le gluten résonnait positivement à l’époque. Ce blé dur a effectivement plus ou moins 2 % de matières azotées en plus que les blés tendres[170], écart qui s’est réduit à l’époque moderne.
Cette différenciation entre dur et tendre est une observation plus propre à la meunerie qui doit transformer en farine ou en semoule l’amande du grain. Pourtant, si on ne peut que difficilement confondre les qualités mécaniques de résistance à la fragmentation d’un blé dur et d’un blé tendre entièrement vitreux, les deux blés sont différents. La notion vitreuse est visuelle ainsi que plus liée aux conditions de culture. Et la dureté est une notion de texture due au patrimoine génétique[171]. Plus il est chargé en gluten, plus le grain sera dur. Bien sûr, dès les années 1920 on a repéré chez le blé dur l’absence du génome D par rapport au chromosome du blé tendre (III.1). La dureté d’un blé dépend de la liaison entre les granules d’amidon et son pourtour protéique. C’est la théorie de l’adhérence et de la difficulté de dessouder ces deux matières. En poussant plus loin, les chercheurs remarqueront que si la matrice protéique, qui enserre le grain d’amidon, n’est pas totale ou discontinue, la dureté est différente et ainsi on mesurera la quantité d’amidon libre et de protéines interstitielles pour mieux définir la dureté du blé.
Pour l’aspect farineux ou semoulier, mathématiquement et en bon cartésien, la granulosité des particules de farine est de maximum 0,900 millimètres, avec une majorité avoisinant les 0,050/0,100[172]. Pour une semoule, on est dans des grandeurs maximales de deux à trois millimètres, avec une majorité proche d’un millimètre[173].
| fig.12 : Comparaison linguistique entre… | ||
| du blé tendre | du blé dur | |
| En latin : Triticum Common ou Triticum Aestivum | En latin : Triticum Turgidum durum | |
| à valeur meunière | à valeur semoulière | |
| Blé tendre (F) | Blé dur (F) | |
| Froment (F) | ||
| Bread Wheat (USA) | Macaroni Wheat (USA) | |
| Hard Red Winter Wheat | Durum Wheat | |
| Hard Red Spring Wheat | Hard Amber durum | |
| Soft White Winter Wheat | Amber Durum | |
| Le blé sera aux états-Unis | ||
| Soit, Hard = Résistant. ou Soft = Friable | ||
| Soit, Red = Rouge ou White = Blanc | ||
| Soit, Winter = d’Hiver ou Spring = de Printemps | ||
| Le tout exprimé en initiales : HRW, HRS, SWW
+ des grades allant de 1 à 5 |
||
| Weichweizen (D) | Hartweizen (D) | |
| Harterweichweizen (D) | Durumweizen (D) | |
| Grano tenero (I) | Grano duro (I) | |
| Tarwe (NL) | Durum Tarwe (NL) | |
| Trigo (ESP) | Trigo duro (ESP) | |
| D’après CHARVET,1990 et WILLM, 1997 | ||
Notez que pour les pains de blé dur du sud de l’Italie, pour cette raison, on va remoudre ( rimacinata en italien), la semoule en farine ou la moudre en plus fine, afin de réduire la granulosité, ce qu’indique les cahiers des charges des pains d’Altamura, Matera et de la vallée du Dittaino[174]. Cette opération se réalisant actuellement le plus souvent en mouture sur cylindres par les tourillons claqueurs (XII.10).
Déjà qu’avec un approfondissement scientifique, il n’est pas aisé de tracer la frontière entre les blés durs et les blés tendres dits parfois vitreux, il existe en plus des blés mi-durs. Et voilà que le marché international va encore plus compliquer le discernement.
Puisque dans ce cas c’est dans la langue qui est celle du commerce, l’anglais, qu’il faudra savoir interpréter, en plus de traduire.
Le blé tendre en français et en France c’est le froment panifiable. Mais attention, en anglais et en allemand, ce même blé tendre est soit hard/hart (dur) ou soft/weich (tendre). Pour trouver une expression plus précise en français et représentant la perception des meuniers, J. Abeccassis et Cl. Willm suggèrent[175] que l’on utilise en français, l’expression « résistant » pour hard et l’expression « friable » pour soft. Qu’on se le dise par toute la France et la Navarre[176]. En fait c’est la résistance à la mouture, corollaire à la teneur en gluten qui est soit forte (hard) soit faible (soft) et qui fait que l’on classe les froments comme cela aux états-Unis, au Canada et en Australie. La classification commerciale américaine du blé tendre risque fort de se standardiser vu les réponses que le marché français doit donner à la mondialisation du marché qui l’intéresse fortement (la moitié du froment français est exportée). En tout cas la conduite d’une classification commerciale s’oppose en terme linguistique à une classification qui essaye d’être claire au niveau génétique. Il nous faut bien distinguer les deux types de classement, si par hasard on a envie de s’y retrouver.
Jean-Paul Charvet, économiste et spécialiste du marché des céréales s’exprime en 1990 : « Une erreur monumentale, mais qui hélas est assez fréquemment commise, y compris dans d’excellents dictionnaires, consiste à traduire l’expression anglaise hard wheat par blé dur[177] ». Pourtant, blé dur se dit durum wheat en Amérique du Nord
Pour éviter les confusions, nous avons dressé un tableau (fig.12) des différents noms du blé dur et du blé tendre.
Le blé dur a plus de mal à s’imprégner d’eau que le blé tendre, que ce soit avant la mouture ou pendant la panification. En meunerie, si l’on voulait incorporer du blé dur au blé tendre, on conseillait de mélanger les deux, un jour à l’avance afin que le blé dur prenne l’humidité du blé tendre[178].
En boulangerie, une pré-pâte genre autolyse[179] lui laissera un peu mieux cet espace-temps. Et peut-être une portion ébouillantée que je regarde comme une imprégnation accélérée par la chaleur, peut être présente dans les processus de panification des blés durs.
Le levain est la méthode de fermentation recommandée, notons au passage qu’à Matera, en Italie du Sud, on pratique le levain sur trois rafraîchis. Le levain laisse le temps nécessaire pour que l’eau forme pâte avec une farine qui n’est pas si « poreuse » que celle du froment.
La sélection du blé dur, même conventionnelle et moderne, est orientée vers l’obtention d’une couleur jaune toujours plus prononcée, qui s’accompagne d’une forte teneur en provitamine A. Voilà pourquoi le blé dur est de meilleure qualité nutritionnelle et a plus de goût que le blé tendre. Ajoutons pour finir que les pains de blé dur présentent une croûte épaisse et se conservent très bien, surtout lorsqu’ils sont fermentés au levain.
X.6. Les blés tendres ou froments.
On va « tendre » beaucoup vers eux, parce qu’ils sont tendres et farineux, riches en gluten (enfin, pour la plupart), il n’y a pas besoin de les décortiquer avant de les moudre, leurs épis sont bien chargés d’épillets à grosseurs de graines intéressantes.
Dès lors, ils vont presqu’outrageusement dominer dans les choix de semis. De ce fait, on s’intéressera ici dans le chapitre qui leur est consacré aux blés qui se sont bien implanté dans le pays (les landraces) pour développer après sur les blés modernes. Les blés de pays sont souvent dénommés blés anciens, une appellation équivoque qui, si on y réfléchit, s’applique aussi bien à un vieux stock de blé conservé depuis quelques années qu’à un semis de variété population ancienne (III.20). Nous avons déjà vu cet aspect (IV.1 et IV.3). D’aucuns préfèrent maintenant faire mention de blés de hautes pailles ou blés de pays, plutôt que de blés anciens pour essayer d’éviter certaines ambigüités d’interprétations de la part de profanes en ce domaine.
Un peu comme une piqûre de rappel, disons que le blé tendre a dominé les emblavements destinés à l’alimentation humaine dès la fin du Moyen Âge.
Le premier témoignage un peu détaillé sur la diversité des blés tendres date du xvie siècle.
Pour comprendre ce texte, il va nous falloir solliciter beaucoup notre discernement.
Pline l’ancien, au ier siècle, écrivait d’ailleurs à ce sujet : « les espèces de blé ne sont pas les mêmes partout et, là où elles sont les mêmes, elles ne portent pas toujours le même nom[180] ». L’abbé Rozier ne disait pas autre chose seize siècle plus tard en France. Pour lui il est, « impossible ou du moins très difficile d’établir une nomenclature exacte des différentes variétés cultivées dans le Royaume. Le blé ne se ressemblera presque plus du tout après avoir été semé pendant plusieurs années de suite, au blé de l’endroit ou on l’aura originairement tiré»[181].
Pour savoir si l’écrit de la Maison Rustique ( c.à.d. La ferme ) du xvie siècle[182] est bien réel en termes de biodiversité, relisons-le et prenons-le comme point de départ historique dans notre réflexion sur la diversité biologique du blé tendre en France.
« Le blé de Beauce fait un grain de plus grand nombre que celui des autres pays, parce qu’il croit en terre glaise, grasse et non aride et a en soi une liaison qui se montre grande au pain, encore qu’il y ait moins de pâte. Celui de l’Île-de-France fait un grain plus court et moindre que celui de Beauce à cause qu’il croit en terroir ni trop gras, ni trop maigre, mais médiocre, ainsi le pain qui en est fait n’est ni si prodigieuse que celui du blé de Beauce, mais en récompense plus blanc et de meilleure manger que celui de Beauce. Le blé de la Brie fait un grain beaucoup moindre que celui de l’Ile de France et de la Beauce. Venant de ce grain, un pain de moindre grandeur que celui de Beauce, de moindre blancheur et de manger, non pas si bon que celui du blé d’Ile de France d’autant que la Brie est en pays de griotte [Malouin emploie autre part, l’expression grouéteux, de terrains pierreux]. Toutefois, il se trouvera que le vrai grain de Brie surpasse les deux autres en pesanteur et qu’ainsi le grain est court et “grouilleux” [je prends ce mot dans le sens de grouillant dans la main par sa forme et densité] plus que les autres, ce qui fait “poiser” [d’empois ou pesant] le grain. Le blé de Picardie est encore moindre que les trois pays décrits ci-avant. Venant de ce grain, un pain moindre en bonté, grandeur, blancheur et profit, parce que ce grain est plus dur, robuste, revêche et pas si facile moudre que les autres, duquel la fleur [farine blanche ou tamisée] ne peut être bonnement tirée, qui fait que l’on appelle communément le blé picard plus “coeneux” [je prends ce mot dans le sens de plus d’enveloppe ou de son], d’autant qu’étant moulu, le son de celui-ci détient en soi quelque farine. La Champagne, bien qu’elle soit abondante en grains et soit de belle apparence, est inférieure aux autres nations, d’autant que son grain rend moins de pain que les autres. Du fait de sa nature il est “corgeal” [probablement dur – résistant] et tortillant entre les meules, plus long à moudre que les autres, aussi il est long, ténu et fendu par le milieu, qui lui fait autant de place vide en lui. »
Cette traduction libre de l’ancien françois, nous dévoile surtout une grande diversité variétale sur un rayon d’à peine 200 kilomètres autour de Paris et une signature du terroir. Disons aussi que, plus ou moins un siècle après, Malouin reprendra un autre classement en déclarant les touselles du Languedoc, comme les meilleurs et le rouge de Flandres comme le pire[183] et relevant ce proverbe « gros blé, petit pain » émit par les boulangers et blatiers d’alors.
Parmentier, qui aura une approche plus rationnelle dans ses écrits, ne relèvera pas tant ces différences variétales géo-dépendantes, il évalue déjà, comme Malouin, plus la valeur des blés suivant les saisons que subira la récolte de l’année[184].
En termes de variétés du froment, Parmentier ne parle en 1778 que du blé de Barbarie (Afrique du Nord touchant la Méditerranée, hormis l’Égypte), procurant un blé dur. Et il cite, comme J. Le Couteur en 1836 [185], un blé tendre de Pologne, – à ne pas confondre avec le blé polonicum (X.3.2)-, il est, dit-il, le plus recherché des blés venant du nord de l’Europe. Il faut savoir que dès les xive et xve siècle, la ligue hanséatique exportera parfois du blé à partir de la Baltique vers les ports hollandais, ou belges[186], et surtout en période de disette, vers Rouen, par le biais de marchands flamands au xvie et xviie siècles[187].
Le blé de Crépy (dans l’Oise au Nord-Est de Paris) renommé déjà en 1500 est un de ceux dont la réputation a traversé le temps. Voici ce qu’en dit H. de Vilmorin en 1880 : « Le blé de Crépi est une des plus anciennes races françaises. Il se cultive de temps immémorial dans tout le nord de l’Ile-de-France et une partie de la Picardie et de la Champagne. Les environs de Crépi en Valois ont été longtemps renommés pour les blés de semence qu’on y venait chercher de bien loin à la ronde : c’était du grain nettoyé avec soin et parfois trié à la main. Sans doute le climat très âpre et rude de la plaine où il était récolté donnait à ce blé un tempérament robuste et rustique qui le faisait prospérer d’autant mieux dans les terres plus abritées des vallées environnantes. »
Mais qu’est-ce qu’un blé tendre local ?
Concernant le blé tendre, jusqu’au début du xxe siècle, il suffisait de trouver un blé et comme il n’avait pas plus que d’autres un nom spécifique, on le qualifie de gros s’il avait de gros grains ou à l’inverse, petits, voire bladette dans le sud de la France. La couleur va être souvent dénominative. Rouge, si les enveloppes étaient rouges, et blanc, si elles étaient blanches. Ainsi, on trouve fréquemment des gros blancs ou petits rouges, sans autres distinctions[188]. Les signalétiques, barbu ou non barbu, et ainsi de suite, à épis multiples ou compact, d’hiver ou de printemps, à grain long ou rond, feront aussi partie des descriptions quelque peu sommaires utilisées autrefois.
C’est l’échange venant de plus loin qui apporte un nom de lieu en plus. Très souvent il porte le nom du port d’où est parti le contingent de blé ; Dantzig, Odessa, Taganrog, Karachi… ou de la région : de Pologne, de Crimée, d’Alsace, de Lorraine, ou parfois de ville ou village, de Bordeaux, Puy Laurens, La Réole…
Au début de la recherche d’amélioration des semis, la ferme ou les fermiers à l’origine de la semence était parfois nommé. Exemple : la perle de Nuisement[189] originaire des environs de Chartres où il était cultivé par Monsieur Hermand à la ferme de Nuisement et puis surtout le blé de Noé. Monsieur Pérès, fermier de monsieur le Marquis de Noé à l’Isle de Noé près de Mirande dans le Gers l’a cultivé un des premiers en se servant dans les blés que le marquis importait d’Ukraine. Après, ce même châtelain et propriétaire terrien l’introduisit dans sa terre de Bréau, en Beauce, d’où elle se serait répandue dans les contrées avoisinantes[190]. L’exode rural dans le Midi lors de la guerre franco-allemande de 1870 occasionnera aussi une exportation de graines dites Rouge de Bordeaux, allant du Sud-Ouest au Centre de la France lors des rapatriements des personnes à la fin des hostilités[191].
Il faut compter plus ou moins dix ans dans leurs nouvelles terres et climats différents pour que la graine exprime son adaptation la différenciant de la semence d’origine. Le blé de Noé aura ainsi sur un vécu de quelques décades, des parents « éloignés » dans le blé Japhet présent dans les polders du mont Saint-Michel[192], le blé Gros Bleu connu dans le Nivernais et le Bourbonnais[193], le blé barbu à gros grains a été également été obtenu par variation spontanée dans la pépinière de la firme Vilmorin à Verrière le Buisson dans l’Essonne[194]. Le blé rouge de Bordeaux descend également du blé de Noé[195], il est de ceux qui vivront les premiers, le retour vers les blés anciens fin xxe siècle. Le blé de Pithiviers est une adaptation dans le centre de la France du Rouge de Bordeaux[196].
Autre exemple de blé à succès ayant voyagé sur d’autres terres, c’est le blé que David Fife accueillit en 1842. Ce blé rouge de printemps originaire de Galicie (en Pologne à l’époque) passa par l’écosse pour aboutir sur sa ferme d’Otonabee dans l’Ontario. On va appeler ce blé : Fife ou Red Fife. Dès sa sortie de la ferme, il portera d’autres noms comme Scotch Fife, Canadian Fife, Saskatchewan Fife. Jacob Allen Clark, co-auteur d’une classification des variétés pour les états-Unis, dira en 1922 que le nom « Red Fife » n’a jamais été adopté majoritairement, c’est plutôt le nom Fife tout court qui est utilisé[197] avec des qualificatifs, c’est ainsi que l’on retrouvera les dénominations Improved Fife (Fife amélioré), White Fife (Fife blanc), Glydon Fife (Fife de Glydon), Risting Fife (Fife de Ristinge ?), Early red Fife (Fife rouge précoce), Wellmann’s Fife (Fife de Wellmann), Jones Fife (Fife de Jones), Bearded Fife (Fife barbu)[198].
Que ce soit le blé de Noé ou le Red Fife, ils proviennent tous les deux du même pays, l’Ukraine. Mais pas de la même région de ce grand pays, l’un (blé de Noé) vient de l’Ukraine orientale et démarre son voyage souvent au port d’Odessa pour traverser la Mer Noire, les détroits turcs et la Méditerranée afin d’accoster à Marseille. L’autre (blé Fife) vient d’Ukraine occidentale, part de Gdansk (Dantzig), traverse la Baltique et la Mer du Nord pour aboutir à édimbourg et enfin, au-delà de l’Atlantique, achève son voyage au Canada.
L’Ukraine était appelée le grenier à blé de l’Europe au xixe siècle et son drapeau en a gardé une trace puisqu’il schématise un champ de blé (jaune) sous un ciel (bleu).

Pourquoi cette origine ukrainienne ou russe à tous ces blés dits par après blé de pays. On peut facilement le comprendre sur les terres à défricher du « nouveau continent » (III.5) qu’est l’Amérique, ne connaissant pas le blé et où tout était à faire au niveau agricole. Sur « l’ancien continent », par contre, il s’agit d’une recherche quasi instinctive des paysans. Du moins lorsque l’on veut renouveler son stock de semences et pour changer de variétés, on avait toujours tendance à rechercher des graines qui venaient du nord où elles subissaient des climats plus rigoureux (III.3) et le plus au Nord, c’est la Russie et l’Ukraine.
Autre base historique de la sélection, Patrick Shirreff (*1791-†1876), il va être une pointure de la sélection semencière par criblage et croisement orienté. Sa ferme est située presque dans le Far-Nord à Mungoswell près d’édimbourg. Décrit parfois comme botaniste, P.Shirreff va promouvoir un blé à bon rendement grâce à Squarehead, un blé à tête carrée (fig.13), puisqu’il présente quatre épillets sur la couronne. Ce blé portera le nom de son sélectionneur, Blé Shirreff. Il sera souvent non barbu et soit rouge ou blanc[199].
Le Nord et l’Ouest de la France avaient des ports, qui importaient des variétés de blés anglais. Ces blés qui à la fin xixe et début xxe siècle, avaient régulièrement un rendement de 10 quintaux l’hectare en plus que les blés français[200].
Si on recherchait non plus des semences de blés du Nord du pays, mais du monde, la Russie et l’Ukraine sont les régions les plus septentrionales ou l’on cultivait le blé, et elles étaient ainsi censées procurer des blés à maturité précoce, résistant bien au froid et de meilleure qualité boulangère.
Louis Ammann, professeur à l’école d’agriculture de Paris-Grignon, dit en 1925 qu’« au premier rang des blés du monde viennent se placer les blés de Russie[201] ».
Ces blés de Noé et Red Fife seront repris, parfois avec d’autres semences russes, par les premiers sélectionneurs allemands et italiens afin d’améliorer par croisement leurs variétés locales[202]. Les sélectionneurs canadiens et des états-Unis feront de même[203].
Un point qui va différencier les blés tendres entre eux, c’est le caractère hiver ou printemps de l’époque des semailles (fig.6 dans III.3). Les blés ukrainiens et russes ont souvent la possibilité d’être semés alternativement avant ou après l’hiver. H. de Vilmorin dira de la variété de blé de Noé qu’elle est « la plus accommodante sur l’époque du semis. On peut le semer depuis le mois d’octobre jusqu’au premier avril. Quand pendant plusieurs années de suite, on le cultive comme blé de mars, le grain devient plus petit et un peu plus rouge[204]. » Le semis de printemps ne fait pas que réduire la grosseur du grain[205] mais apporte aussi un gluten plus tenace et comme il était un passage obligé en culture pour des pays exportateurs comme la Russie, l’Ukraine, le Canada et le nord des états-Unis, ils vont devenir dominants dans la production et l’exportation, ils vont donc un peu formater le marché du blé.
Cela changera la donne des « standards » du blé commercialisé, même si les blés tendres semés avant l’hiver, appelés en latin aestivum (l’époque de la récolte), ont été classés un temps par Karl Von Linné sous le vocable, triticum hibernum (l’époque du semis). Dans ce classement, le savant suédois subira les critiques de l’abbé Rozier qui considérait en 1787 qu’il fallait tenir compte de l’unité morphologique des deux blés, d’hiver ou de printemps[206].
Dans sa classification des blés, l’école russe se différenciera toujours des autres, elle fera plus attention au lien avec le lieu de culture et son climat (l’écotype), cela dès Vavilov, et plus formellement en 1935 par Flaksberger (un taxonomiste issu de famille germano-russe). Cela sans tenir compte de la morphologie. L’école russe va par exemple classer les blés français dans le même groupe : triticum aestivum Gallicum, puisqu’ils ont tous la faculté de s’adapter aux climats et terres françaises et que de plus, ils ont souvent les mêmes parents[207].
Nous avons déjà abordé (III.3) les enjeux agro-économiques de ce choix, blé d’hiver et blé de printemps. Avec la « révolution verte » vécue après la guerre 1940-45, les rendements explosent. Toutefois les blés états-uniens « Hard Red Winter » (froment rouge « résistant » d’hiver) ne font, fin du xxe siècle, qu’un rendement de 25 quintaux à l’hectare. Plus au nord des États-Unis, jouxtant la grande prairie canadienne, le « Hard Red Spring » (froment rouge « résistant » de printemps), est à peu près à un rendement de 20 quintaux à l’hectare. Il n’y a que le « Soft White Winter » (froment blanc « friable » d’hiver), cultivé à l’Ouest des montagnes Rocheuses, qui arrive à 40 quintaux à l’hectare[208]. En Russie, le rendement est légèrement inférieur à celui du Canada. L’Australie et l’Argentine ont des rendements encore moindres, avoisinant les quinze à dix-sept quintaux à l’hectare[209]. Pour comprendre la différence de rendement entre les régions tempérées d’Europe, qui sont en ce moment, à environ 70-80 quintaux de rendement moyen à l’hectare et le reste du monde, il faut dire que les climats plus humides ont plus bénéficié des évolutions dites phytosanitaires et des techniques de sélection et fertilisation dites « modernes » qui atténuent les dégâts de la verse et amoindrissent les risques de maladies fongiques[210]. « Les meilleurs rendements sont obtenus dans les parcelles qui reçoivent le plus de traitement phytosanitaire » : 53 quintaux pour un à trois traitements, 73 quintaux pour six à huit traitements et 81 quintaux pour plus de huit traitements[211]. L’Angleterre et les Pays-Bas ont des rendements encore supérieurs à la France. Dans les pays non européens, on cultive des blés de force à moindre rendement pour l’exportation. De ce fait, en France on parvient à obtenir sur 160 hectares ce que les Américains du Nord obtiennent sur 500 hectares, au détriment de la « qualité technologique » moins « hard » convenant pour le marché de la baguette française par exemple[212].
Cela sera récurrent dans le marché du blé, cette différence entre le blé de valeur panifiable, au gluten de plus en plus tenace et le blé fourrager, plus rentable à l’hectare. Prenons une métaphore pour bien l’expliquer.
Dans les races de poules, il existe les poules pondeuses, minces et légères, et les poules ou poulets de chair, qui ne pondent pas beaucoup. Comme le dit le proverbe : « On ne peut pas avoir la poule et l’œuf », il est difficile d’obtenir, dans une race, les deux propriétés (bonne ponte et beaucoup de chair) de manière pointue. Pour les semences de blés, ce sera pareil : il est difficile d’avoir à la fois, la meilleure qualité technologique sur le marché et la meilleure qualité agronomique (rendement) existante sur le marché. C’est la nature qui s’exprime comme cela. Même s’il est vrai que la « force » du froment n’est pas fonction du climat ou du sol, comme on l’a cru parfois[213], il existera toujours un clivage, rendement versus qualité (ou « force ») du froment. L’agronome Dominique Soltner reprend des propos ressassés assez régulièrement dans le milieu agricole : « La qualité ne paie pas, disent de nombreux céréaliculteurs, qui constate que la marge laissée par un blé de médiocre qualité boulangère, mais de fort rendement, est plus intéressante[214]. » Un responsable de l’association des meuniers signale que les Variétés Recommandée par la Meunerie (Vrm) sont tombées de 59,20 % des emblavements à 26,03 % de 1986 à 1989. Elles remontent régulièrement depuis. En 1998, elles atteignaient les 30,20 %, ce qui est suffisant pour les besoins de la meunerie française[215] mais pas pour l’export. Le restant étant composé d’environ 20 % pour l’aliment du bétail et autour de 50 % pour l’exportation. Cette répartition des semis était pour une large part, le résultat de la politique agricole commune de la Communauté Européenne avec son niveau d’intervention sur les prix qui sera liée à la qualité technologique depuis le début des années 1990.
Une situation semblable de choix de rentabilité à l’hectare est déjà connue en 1878 « où les blés français se signalent d’une façon fâcheuse par leur faible teneur en gluten », qui s’est abaissée de 3 à 4 % à cause de l’introduction des variétés anglaises à haut rendement[216]. C’est une situation récurrente qui s’est répété de nombreuses fois dans l’histoire commerciale du blé. Le mot de la fin sur cette discussion sur le rapport quantité/qualité de la récolte des blés revient à Raymond Calvel, « une motivation qui n’a pas changé, c’est la recherche des variétés les plus productives : le rendement d’abord, la qualité si possible[217]. »
Autre débat technologique que va vivre le blé tendre, l’introduction de l’hybride F1 qui a connu son succès sur le maïs et dans un moindre mesure sur le seigle. Nous savons déjà qu’il s’agit de la part des sélectionneurs, d’un débat d’orientation plus commercial que technique.
Dans les nouvelles obtentions de céréales, ce sera principalement une course au rendement à l’hectare pour que les vendeurs-sélectionneurs puissent séduire leurs clients-agriculteurs. Et comme depuis l’avènement de la sélection généalogique l’exercice des choix de croisement pouvaient se décider, le choix de la rentabilité va faire évoluer très vite les blés tendres après la Seconde Guerre mondiale. D’autant plus, lorsque les engrais, les pesticides et la mécanisation deviendront accessibles. Les doses décuplées d’engrais nitratés fera verser plus facilement les blés de pays à haute paille, et c’est la variété Vilmorin 27, dont le croisement date de 1910[218] qui serait un des premiers blé adapté, sans verser, avec ses hausses de doses d’ammonitrates, traité de drogues et « pétards » par Bernard Ronot[219], agriculteur bourguignon ayant vécu les deux modes de production (conventionnelle puis bio).
La corrélation entre la vente des intrants (pesticides/engrais) et les semences va alors s’établir au sein même des coopératives d’agriculteurs lors des dernières décades du xxe siècle. Après, l’inféodation aux objectifs financiers dans un environnement hyperconcurrentiel, discriminant vite les plus faibles et petits intervenants va jusqu’à proposer un kit semences/intrants. Ne laissant plus la possibilité de produire en dehors de normes économiques dominantes, jusque avalisées dans des réglementations commerciales.
À l’évidence, les sortes de céréales qui vont vivre le plus leurs « mutations sociales » sont le maïs et le blé tendre. Ce dernier n’en sortira pas indemne au niveau des protéines qu’il contient, et sa valeur nutritionnelle s’en verra amoindrie.
Voilà pourquoi certains critiques estiment que l’on fait « rewind » en promotionnant du blé de vieilles accessions de variétés-populations et que dès lors, l’intitulé blés anciens provoque l’ironie des personnes qui estiment qu’il ne faut pas recommencer ce qui a été construit. Dans ce cas de figure, on dévalue le retour vers des blés « anciens » en mesure rétro, alors que la recherche de meilleures valeurs nutritionnelles a été bien peu prise en compte jusqu’ici.
à l’issue d’un colloque réunissant les meilleurs spécialistes en 1977 (fig.14), l’objectif de la recherche en sélection a été en termes de qualité ; la bonne valeur en panification, sous-entendu du gluten, et du tenace sans fixer un plafond à ne pas dépasser et le ciblage de la valeur agronomique, sous-entendue, la rentabilité à l’hectare[220].
| fig.14. Les divers objectifs de la sélection (fin des années 1970) | ||
| Objectif | Hiérarchie des critères
de sélection |
Caractéristiques de qualité
(à titre indicatif) |
| Obtention de variétés de
bonne valeur en panification en l’état présentant une bonne régularité de rendement. |
– Bonne productivité et bonne valeur agronomique
– Bonne valeur en panification directe (sans avoir recours à des mélanges) |
Voisines de celles des cultivars « Capitole » et « Hardi »
En général : w = 140 à 160 et P/L = 0,5 à 0,6 |
| Obtention de variétés « de force » (à rythme de développement de type hiver ou alternatif) | 1.- Caractéristiques de qualités élevées (gluten fort)
2.- Productivité pas nécessairement très élevée alliée à une bonne valeur agronomique. |
Voisine de celles du cultivar « Magdalena », en général W de 250 à 300 ou supérieur |
| Obtention de variétés fourragères impanifiables productives aisément identifiables (*) | 1.- Bonne valeur agronomique alliée à une productivité élevée.
2.-Éventuellement valeur énergétique et valeur protéique améliorées pour l’alimentation animale. |
Valeur en panification indifférente.
Teneur en protéines améliorées. |
| (*) La plupart des « blés fourragers » actuels son issus de croisements spécifiques. Le problème de l’identification rapide
(au moment de la collecte en particulier), pourrait être résolu en concentrant les efforts de la sélection sur une espèce proche de blé spécifiquement fourragère, facilement reconnaissable sur le grain telle que le triticale. |
||
| D’après ROUSSET et AUTRAN, 1979. | ||
C’est encore le blé tendre qui est concerné lorsque l’on écrit que « la valeur d’utilisation a été intégrée dans les programmes d’amélioration des blés développés par les sélectionneurs européens et surtout en France ». On cite alors l’exemple de l’augmentation de la valeur W de l’alvéographe passant de 140 à 200 sur quarante ans et de l’augmentation de la dureté de l’albumen. Ensuite d’intégrer la spécialisation de cette amélioration jusque dans l’Adn, par « l’identification des gènes du grain » et les « impliqués dans la stabilité d’expression », les chercheurs spécialisés ajoutant que « la culture des blés hybrides offre sur cette question de stabilité, une intéressante question qu’il convient d’approfondir [221] ».
C’est les blés tendres et durs qui sont concernés sur leurs valeurs, meunière et semoulière. On définit celles-ci comme devant « donner dans des conditions industrielles, un rendement élevé en farine […] de pureté déterminée [222] ». Tant pis pour la valeur nutritionnelle, si la conception de la pureté n’est pas la même et a un objectif opposé.
C’est le plus souvent le blé tendre, qui est concerné lorsque l’on propose en mélange prêt à l’emploi une farine avec une formulation d’ajouts enzymatiques texturant la mie et définissant les diagrammes de travail qui devraient tous passer à la rapidité et facilité de panifier. « Easy to bread » (le pain facile), était l’intitulé marketing de certaines firmes d’avant-produits en boulangerie.
En résumé, le buvard de l’évolution industrielle, c’est le blé tendre actuel qui l’a vécu le plus souvent, voire l’a subi. Comparé aux précédentes céréales décrites, il n’existe dès lors pas beaucoup d’indications à donner pour panifier ce conventionné. Sauf si vous vous employez à décloisonner les intérêts divergents des secteurs (agricole, meunier et boulanger) allant du grain au pain, et que vous les liez afin de remplacer le tout avec un objectif tenant compte du nutritionnel et gustatif.
Dans ce cas, les recommandations vous conduiront peut-être à cette rétro-innovation qui revisite les potentiels oubliés de l’enrôlé de force qu’est devenu ces derniers temps le froment.
X.6.1. les blés sphaerococcum ou blés ronds
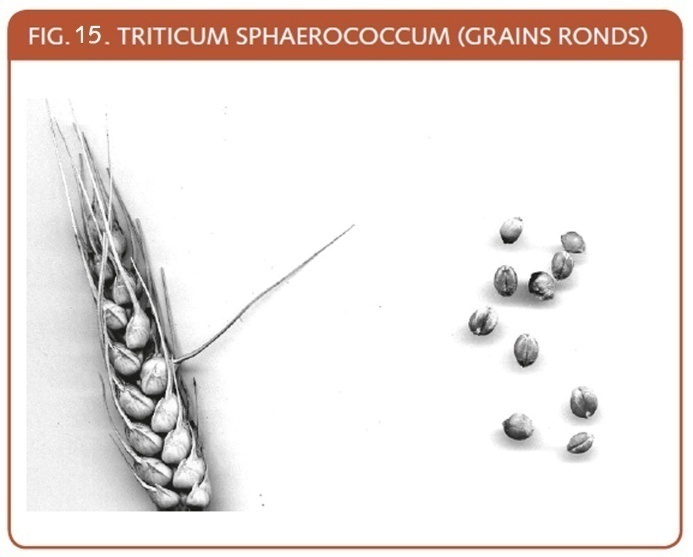
Citons encore un de ces blés qui nous en apprennent plus sur la biodiversité de l’espèce triticum aestivum. Faisons connaissance avec le triticum sphaerococcum, soit, blé sphérique puisque ces grains sont ronds (fig.15). Il s’agit d’un blé hexaploïde.
Il se trouve de manière originale en Inde et est petit sur pattes, dit nain dans le langage céréalier. C’est principalement dans le Gujarat qu’on le trouvait et de nos jours, les stations où il se localisait diminuent d’année en année[223].
Voilà encore un petit grain de blé riche en protéines. Rappelons que la variété Marquis, qui connut tant de succès début du xxe siècle, descendait du Red Fife et du blé Hard Red Calcutta. Le vécu des Saunders père et fils nous apprend ainsi qu’il ne faut pas ignorer la valeur des blés parce que lointains ou pas « de pays ».
X.7. Les seigles

On le sait peu, le seigle (fig.16) est souvent diploïde comme l’engrain. Secale est le nom italien, C’est Centeno en espagnol, Roggen en allemand, Rye en anglais et Rogge en néerlandais.
Le seigle doit sa dénomination hispanique du fait qu’il donnerait cent graines hors d’une semée.
Peu d’historiens pensent que Pline parlait du seigle pour un blé dit à cent grains, car les Romains n’appréciaient pas le seigle [224].
La vie quelque peu sentencieuse du proverbe, « gagner son pain à la sueur de son front », est bien remplie par le pain issu de la céréale gris-vert ou « au reflet bleu ». Le seigle, c’est en effet de lui qu’il s’agit, est plus précoce et rustique, a une croissance qui peut être un peu plus courte que le froment.
Il est plus résistant aux intempéries, surtout au froid hivernal, il germe encore à un ou deux degrés Celsius. Il est également bien adapté à l’acidité des sols ou aux sols plus lessivés (parce que situés en pentes) [225]. Seules les céréales avoine et orge rivalisent et dépassent parfois le seigle à ces différents niveaux ou exigences. Ces deux céréales sont cependant moins panifiables. Le seigle est et reste la deuxième espèce de céréale panifiable derrière le blé. Les neuf dixièmes du seigle récolté dans le Monde proviennent de l’Europe du Nord [226]. On y trouve du pain, où seul le seigle entre dans la composition, dans les régions ou la culture des céréales est difficile, par exemple dans les Alpes, jusqu’à 2100 mètres[227].
Il faut avoir accompagné patiemment, du semis à la récolte, les communautés villageoises vivant dans les montagnes pour bien comprendre la « vie » du pain de seigle[228]. Les meilleures terres de l’« adret » – versant ensoleillé- lui sont consacrées. Le prix du labeur, « un tour de force chaque année renouvelé », donnera le goût à ce pain. Là où les machines ne peuvent travailler, il faut suivre l’intelligence quasi codifiée et héritée des anciens, car la force des bras n’a pas le droit de se tromper. Fruit de l’obstination, désir à peine récolté, déjà ressemé, « cette nourriture irriguait à chaque fournée, chaque bouchée, les réseaux vivants que la fonction symbolique trace dans la tête et l’espace social[229] ». Une nourriture qui devient excellente par et pour son mérite !
Mais signe des temps et d’une évolution dont on ne sait pas séparer l’avantage du désavantage, le seigle n’a plus le vent en poupe. En France, il se situe en tonnage récolté après le blé tendre, l’orge, le maïs, le blé dur et même après le sorgho[230].
En Suède, depuis les années 1920, on est passé en 2010, de 350.000 ha cultivé à 25.000 ha [231]. En Allemagne, l’on cultivait deux fois plus de seigle que de froment avant la Seconde Guerre mondiale[232], il y a peu de temps, en 1987, dans une de ces régions du seigle, la Westphalie, les emblavements de seigle n’étaient que de 38 % de la sole de seigle de 1974. Cette baisse opérée sur une douzaine d’année, est toutefois compensée par une meilleure rentabilité à l’hectare qui n’a fait baisser la production allemande de seigle que d’une petite moitié[233].
S’implantant autrefois dans l’espace essarté par le feu[234], « semé dessus », s’immisçant en mélange sur les champs dans le méteil, sachant se succéder à lui-même dans les rotations de cultures, le seigle va perdre ses atouts à cause des nouvelles possibilités de culture qui profiteront au froment. D’autant que le triticale que nous verrons plus loin dans ce sous-chapitre, va aussi se proposer à la vente, fin du xxe siècle.
En France, comme des sanctuaires, les sols pauvres de région comme le Massif central avec dans son Sud-ouest, la région bien nommée « Ségala »[235], l’Armorique, les Landes et la Sologne ou les cultures d’altitude, ne vont plus « nourrir » suffisamment l’exigence financière… de nos niveaux de vie ou rentabilité horaire. On ne récolte plus assez pour ceux-ci ! En 2002, dans le pays installé sur les Alpes, la Suisse, certains cantons veulent instaurer une appellation d’origine contrôlée (Aoc) pour le pain de seigle. C’est le cas du Valais, mais l’obligation de cultiver le seigle en Valais a soulevé des contestations de la part des groupes distributeurs qui prétextent que les surfaces cultivées sont insuffisantes. C’est en 2002 que, dans un premier temps, la chaine de distribution Migros contestera et puis la Coop (autre grande surface suisse) introduira un recours contre cette demande d’agrégation d’Aoc. Pourtant la surface ensemencée de seigle avait plus que doublé, pour atteindre 150 hectares dans le canton, après l’annonce de ce simple incitant[236]. En 2010, le pain de seigle valaisan aboutit dans son travail pour l’obtention de l’Aoc[237].
Plus que la semence de froment, la semence de seigle a fait certaines concessions à la « modernité ». Dès la fin de xixe siècle, Ferdinand Von Lochow au manoir de Petkus près de Berlin, a sélectionné patiemment pour créer une variété de seigle qui va occuper dans les années 1930, jusqu’à 90% des semis de seigle en Allemagne et environ la moitié de la récolte mondiale[238]. Cela va aider à l’érosion et l’abandon des variétés locales ou populations[239].
Toujours en Allemagne, et plus récemment, de 1988 à 1991, on est passé de 5 à 70 % de graines de seigle hybrides dans la production des semences. Ce qui est très loin d’être le cas du froment. Il faut dire que le seigle a une prédilection à se croiser naturellement. Deux semis de variétés de seigle différents qui se côtoient arrivent facilement à réaliser l’envoi et la réception du pollen, vu que les glumes (enveloppes externes) sont moins enserrées sur le grain et laissent ainsi place à « l’échange pollen ». La sélection sous forme d’hybride F1 du seigle apparaît depuis la fin des années 1980 et devient importante en culture depuis 1985. Il rapporte 70 quintaux à l’hectare par rapport aux 60 quintaux des semences de lignées pures[240].
Cela ne veut pas dire que le courant allant vers les céréales anciennes n’existe pas sur le seigle en Allemagne. Dans ce chapitre, on s’arrête surtout à ce seigle ancien ou seigle primitif ( Ur Roggen ) qui n’est pas tellement connu en France. Il s’agit d’un seigle dit « sauvage », en tout cas ancien. Il porte différents noms : seigle des forêts, puisque c’est principalement cette céréale que l’on cultivait après avoir pratiqué l’essartage ou déboisement opéré par le feu ; seigle de la Saint-Jean, puisqu’on le semait aux alentours du 24 juin, date du solstice d’été ; seigle des sauterelles a aussi été employé pour la même raison de semis en juin. Seigle vivace ou seigle pérenne est une appellation plus curieuse, et les personnes plus au fait de la génétique et la botanique de la céréale domestiquée actuelle peuvent être sceptiques lorsqu’on avance que ce sont les rhizomes qui donnent une nouvelle plante, alors que pour les simples graminées des champs, la pratique de semis naturel et pérenne par les rhizomes est fréquent.
En fait, comme il était semé, bien avant la moisson, en juin, alors que les autres céréales d’hiver sont semées elles, de fin septembre à début novembre, on laissait à la fin de l’automne, les troupeaux d’élevage manger les jeunes pousses de seigle déjà hautes, qui donnait une belle verdure à brouter. L’on aurait pu croire que la plante avait été consommée, mais au printemps la graine et les rhizomes qui ont donné la plantule sont toujours dans le sol et après avoir gelé donnent des talles (tiges d’épis, VI.4 et V.9) même plus nombreuses, cela d’autant que le sol a été piétiné. Ce qui oblige la plante à se multiplier en force pour sortir du sol, c’est le phénomène bien connu du tallage, propre aux céréales. D’où la dénomination quasi scientifique « seigle multicaule », c’est-à-dire seigle à plusieurs tiges. En effet, cela peut donner des talles assez nombreuses, surtout pour les céréales anciennes.
Il est également possible, vu la forme « sauvage ou naturelle» de ce seigle, que cela occasionne un égrenage propre à la céréale « primitive » devant se semer d’elle-même. Elle laisse tomber les graines du haut de l’épi et les poils hérissés vers le haut se trouvant sur la base de l’épillet (mérithalle – fig.5 dans III) font que ce grain une fois sur terre ne sait que s’enfoncer dans le sol et dès lors s’auto-ensemencer.
Après avoir cité toutes ces appellations et leurs explications qui nous apprennent déjà beaucoup sur ce seigle ancien, parlons d’autres spécificités de celui-ci.
On se retrouve avec cet « ur-roggen » (seigle primitif ou originel), avec un seigle de deux mètres de hauteur de paille et un bon enracinement puisqu’à chaque nœud de chaque talle, des racines se fixent mieux au sol.
La récolte est de 50 % de ce que donne le seigle moderne issu à grande majorité de semences hybrides, comme nous l’avons observé avant.
Il aura des plus petites graines et par là même, une teneur en fibres plus importante en farine intégrale, cela donnera de ce fait, une couleur plus foncée à la mie du pain. On retrouve là l’étymologie de la dénomination turque du seigle : « kara bidai » qui signifie « blé de couleur noire[241] ». Et ce seigle très ancien, on le dit assez faible en résistance de germination sur pied (d’où la forte dégradation enzymatique qui en découle), ce qui fait qu’on lui attribue une saveur sucrée au point de le déclarer plus propre que d’autres farines à la fabrication de pain d’épices.
Dans sa région de prédilection, la Russie, le seigle du Grand Nord est plus autogame, écrit Vavilov[242]. Vladimir Kobyliansky, un des successeurs de Vavilov, a patiemment développé un seigle qui contient 50 % de protéines en plus que les variétés communes[243].
D’autres aspects identitaires du seigle n’ont pas manqué dans son histoire. Et comme l’identitaire risque fort d’être une réponse à la standardisation alimentaire que nous vivons et parfois subissons, passons-les en revue.
Comme une étude épidémiologique peut le révéler, là où, le pain de pur seigle constituait la base de l’alimentation, en Russie et en Pologne notamment, les troubles dus à l’épaississement du sang et autres maladies des vaisseaux sanguins étaient moins connus[244]. Le seigle apparaît comme une céréale « plus fluide ».
Plus fluide, une céréale ? Fruit sec par excellence, qu’est-ce à dire ? En fait, si l’on étudie méticuleusement les aspects du seigle et qu’on les compare aux autres céréales, on remarque immédiatement qu’avec les mêmes 15,5 % d’humidité autorisés pour une farine panifiable, soit 74,5 % de matière sèche, le pain de seigle doit comporter minimum 55 % de matière sèche, alors que le pain de froment lui, doit avoir au moins 62 % [245]. C’est normal, le seigle est cultivé dans des régions où la pluviométrie est plus forte et surtout sa technique de panification met en jeu la viscosité de sa matière, en quelque sorte son pouvoir absorbant. Ainsi cet aspect de pluie reçue va nous donner une céréale aux substances plus solubles, diffuses, perméables, donc plus « fluide ». Un coup de sonde des connaissances scientifiques actuelles du seigle va nous préciser tout cela. Le seigle contient plus de fibres solubles que le froment et notamment des pentosanes et c’est tant mieux, autant technologiquement (si on sait en profiter) qu’au niveau nutritionnel[246].
Autre spécificité du seigle, ces protéines, ne sont pas très gluten ou « kleberstoff » (« matière collante ») comme disent parfois les Allemands[247]. On peut y voir un aspect négatif professionnellement parlant surtout si l’on pense « alvéoles », mais de nouveau nutritionnellement ce n’est pas plus mal. L’amidon se dégrade aussi plus facilement dans le seigle, encore un mauvais point pour l’atelier puisque cela donne des pâtes qui lâchent. On voit parfois que l’eau ne s’unit pas bien à la farine, la pâte épure, suinte. Les responsables de cette trop forte dégradation sont les enzymes qui seront plus présentes et actives dans des épis récoltés mûrs et humides (XVI.8). De plus, le seigle a une période de « dormance » (XI.7) plus courte que le froment[248], ce qui le fragilise encore. Même si l’amidon doit se dégrader pour passer d’aliment en nutriment, lorsque l’on parle panification, ce point est plus négatif que positif. Pour freiner cette dégradation de l’amidon et ainsi préserver les faibles qualités alvéolables du seigle, la pâte de seigle a besoin d’acidification. C’est au point que parfois le mot « sauerung » (acidification) se confond dans le langage des technologues allemands avec « gärung » – (fermentation) puisque la principale fonction donnée par eux à la phase fermentation sera l’acidification. Comme il est souvent panifié en farine complète et au « sauerteig » (« pâte acide » ou mieux, « levain »), ce long temps de fermentation va ainsi rendre les sels minéraux et oligo-éléments plus assimilables par notre organisme (VII.11)[249].
Les leçons de l’histoire nutritionnelle du seigle sont quelquefois noires.
Le « Mühlenschwarzreinigung » (nettoyage noir en meunerie) vise à éliminer l’ergot de seigle. D’autres méthodes plus préventives sont employées pour éviter ces épidémies qu’a connues l’humanité[250]. L’aspect des différentes sensibilités face aux attaques cryptogamiques n’est pas sans risques pour les aliments. Elles sont importantes pour le seigle du fait du climat plus humide où il est récolté.
| fig.17. Teneur en césium 137, radioactif,
(en bécquerels /kg, par substance fraiche) en Allemagne, dans les années 1983-1987 |
||||
| Sorte de céréales | 1983 | 1985 | 1986 | 1987 |
| SEIGLE | 0,33 | 0,15 | 45,00 | 0,24 |
| FROMENT | 0,10 | 0,05 | 6,20 | 0.13 |
| Devinez l’année de l’accident nucléaire de Tchernobyl ? | ||||
| D’après SEIBEL, 1988. | ||||
Comme pour confirmer le caractère « plus fluide » ou perméable, côté réceptif et par un aspect négatif, relatons la vie du seigle lors de l’accident nucléaire de Tchernobyl en 1986. Plus que le froment, le seigle avait assimilé la radioactivité [251] (fig.17). Il a fallu résoudre le problème en augmentant le taux d’extraction de la farine.
Les céréales ont des métabolismes différents avec pour conséquence plus ou moins de teneurs en sels minéraux alimentaires et non alimentaires. Ainsi le seigle apportera, toujours comparativement au froment, plus de plomb, ce qui est pas positif, et moins de cadmium, de nickel et d’arsenic, ce qui est bienvenu[252]. Au rayon des éléments qui composent naturellement l’aliment, mais qui sont anti-nutritifs, citons l’acide phytique et la résorcine, ce deuxième élément, un tanin, étant plus spécifique au seigle.
Les critères de qualité boulangère du seigle ne sont pas comparables aux critères de qualité boulangère du froment. C’est sur les qualités de rétention d’eau et de gélification de l’amidon que se basera la valeur boulangère du seigle. Ainsi l’analyse de l’activité amylasique importera bien plus ici.
Ce n’est qu’au début des années 1970 qu’apparaîtront les standards différenciant les seigles panifiables, des seigles fourragers[253].
Les Scandinaves proposent des pains plats au seigle, ces « crisp breads » (pains croquants) ont quelque trois millimètres d’épaisseur et environ trente centimètres de diamètre, parfois troués en leur centre, ils sont composés de farine complète et souvent réalisés au levain[254].
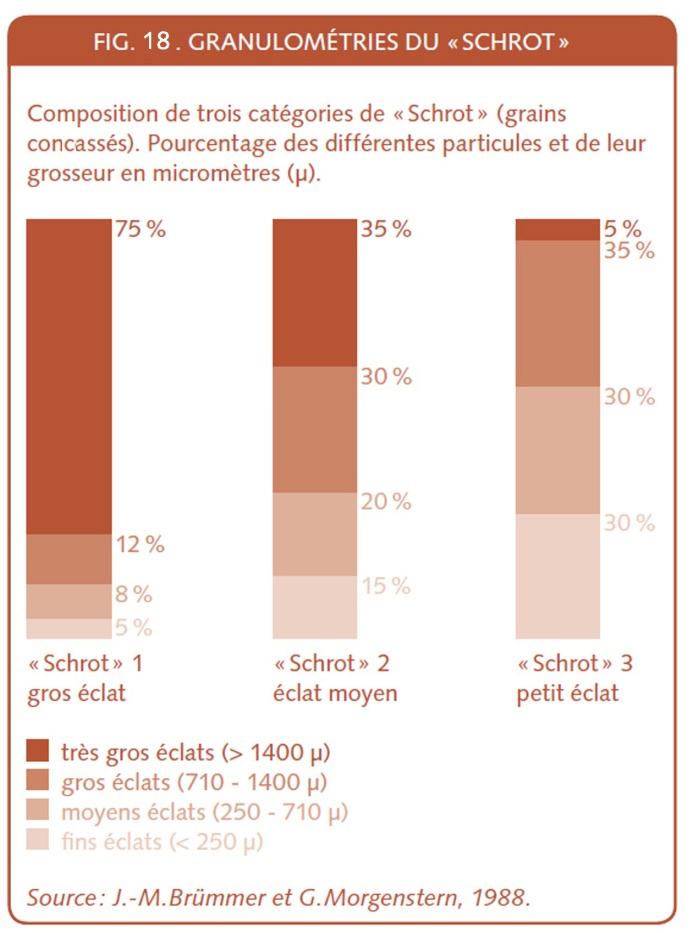
Le seigle peut avoir aussi une spécificité dans sa mouture, il est parfois employé en Allemagne sous forme de grains entiers concassés en éclats (fig.18) appelés « Schrot »[255].
Le « Schrot » est inévitablement toujours un grain complet, il en aura les avantages et les désavantages. On l’obtient en éclatant le grain au moyen d’un marteau industriel, d’un passage, soit, entre des cylindres lisses ou des meules, plus espacées.
Le pain aux grains concassés en éclats ne vise pas une mie aérée, mais plutôt la plus agglomérée possible. Pour arriver à bien assembler ce « concassage » de grains, on sollicitera fortement le recours aux pré-pâtes. D’abord le levain, bien sûr, qui entrera jusqu’à 35 à 45 % de la composition de la pâte, en poids de farine ou grains. Ce sera les grosses particules ou éclats de grains concassés (« große Schrot ») qui seront prioritairement utilisées pour composer le levain. Une autre partie de « große Schrot » sera trempée à température plutôt froide, autour de 20 °C (la « Quellstück »), faisant parfois jusqu’à 20 % de la pâte en poids de farine ou grain. Enfin, dernière « pré-pâte », la part ébouillantée (« Brühstücken »). Le « Schrot » est ici cuit jusqu’à 60 °C, puis refroidi et peut représenter 5 à 25 % de la pâte en poids de farine ou grain. La « Quellstück » et la « Brühstück » ne se cumulent généralement pas. Le choix de l’un ou l’autre est souvent fonction de l’état de la récolte. Si celle-ci n’a pu profiter de périodes sèches au bon moment, l’activité des enzymes amylases sera trop forte et dégradera trop vite le processus de panification. Dans ce cas de figure, fréquent pour le seigle, la « Quellstück » sera parfois préférée au « Brühstück » qui est déjà gélifié partiellement et de ce fait procure une attaque plus facile de l’amidon par les ferments.
En Allemagne, en technologie boulangère du seigle, on pense autant « Wasseraufnahmevermögen » (capacité d’absorption d’eau ) et « Quellungsvorgang » (« processus de gonflement ») que « Teiglockerungsmittel » qui signifie « moyen d’aérer la pâte » par l’insertion de bulles de gaz venant de la fermentation. Pour eux, le gonflement de l’amidon est aussi important, sinon plus, que l’aération au gaz carbonique avec des alvéoles. Pour terminer la pâte, lors de la pétrissée finale et de l’assemblage des pré-pâtes acidifiantes et épaississantes, l’ajout de « feinschrot » ou « mittelschrot » s’indique pour un meilleur assemblage de ces matières qui composent le spécifique « roggenschrotbrot » (pain de seigle aux grains concassés en éclats[256]).
On peut encore accentuer ces aspects foncés que permettent le seigle et l’usage du grain complet concassé avec le « pumpernickel ». Originaire de Wesphalie[257], il était historiquement issu d’une longue cuisson qui « caramélisait » la mie comme elle le fait pour la croûte[258]. C’est de nouveau la tradition orale, plus que la vérité historique avec preuve à l’appui, qui transmet l’origine du pumpernickel. Il s’agirait d’un accident ou un hasard comme souvent. Pendant la guerre de Trente Ans (1618-1648), opposant les États catholiques et protestants, des paysans westphaliens durent quitter précipitamment leurs logis pour échapper à l’envahisseur armé. La cuisson du pain avait dû être abandonnée et on avait obstrué la bouche du four pour le cacher. Le lendemain, sortant de leurs repaires, les paysans retrouvèrent leurs pains tout noirs, carbonisés. Ils le goûtèrent et l’apprécièrent. C’est ainsi que serait né ce pain très typique.
En 1775 dans l’encyclopédie de Johann Georg Krünitz, plusieurs orthographes du nom sont reprises « Bombernickel, Bumpernickel, Pompernickel, Bonprenicle, Bonpur-Nicol » sans que l’on puisse donner une explication étymologique satisfaisante du terme[259].
Par cette cuisson spécifique, les teneurs en vitamines de ce pain en souffrent d’ailleurs. Lors d’une cuisson de seize heures, la teneur en vitamine B est de 129 mg, et après vingt-huit heures, la teneur en vitamine B est diminuée de moitié[260].
| fig.19. Comparaison des caractères entre le seigle et le froment | ||
| Seigle | Froment | |
| Substance épaississante ; protéines (gluten) | 7 à 13% | 7 à 13 % |
| Substance épaississante ; pentosanes (muqueuse) | 7 à 9 % | 6 à 7 % |
| Absorption d’eau
des substances épaississantes |
+/- 6 à 8 fois | +/- 2 fois |
| Gélification de l’amidon | Tôt ( (56°C à 68°C) | Tard ( 60° à 88°C) |
| Sensibilité enzymatique | Grande | Petite |
| Danger de germination | Grand | Existant |
| Taux d’extraction à la mouture | T 1150 en D. T 120 en F | T 550 en D. T 55 en F |
| Méthode de travail de la pâte | Acide | Faiblement acide |
| D’après WEIPERT et BRÜMMER, 1988, p.91. | ||
De nos jours ce pain qui se veut résolument noir, par référence, se réalise toujours par une longue cuisson. On place les pains dans des platines entièrement fermées, afin de les cuire dans leurs vapeurs et de ne pas procurer trop de croûte. Parfois, on les cuit préalablement à plus haute température, puis s’ensuit alors une cuisson spéciale à 100 °C pouvant durer pendant vingt-quatre heures. Quelle que soit la méthode de cuisson choisie, il faut qu’elle soit longue. Dans beaucoup de recettes actuelles de pumpernickel, on incorpore du sirop de sucre de betterave (mélasse), ce qui « noircit » d’autant mieux la mie et adoucit le goût. Ce pain permet la confection de multiples hors d’œuvres, où généralement le salé et le sucré se marient bien. Le pumpernickel jouant dans le jeu du contraste, une fois l’épicé, une fois le doux, suivant les autres composants[261].
Le mélange seigle/froment entrant dans la composition des pains recevra des dénominations très différentes en France et en Allemagne. On vous laisse juger quelle est la meilleure appellation avec la fig.20.
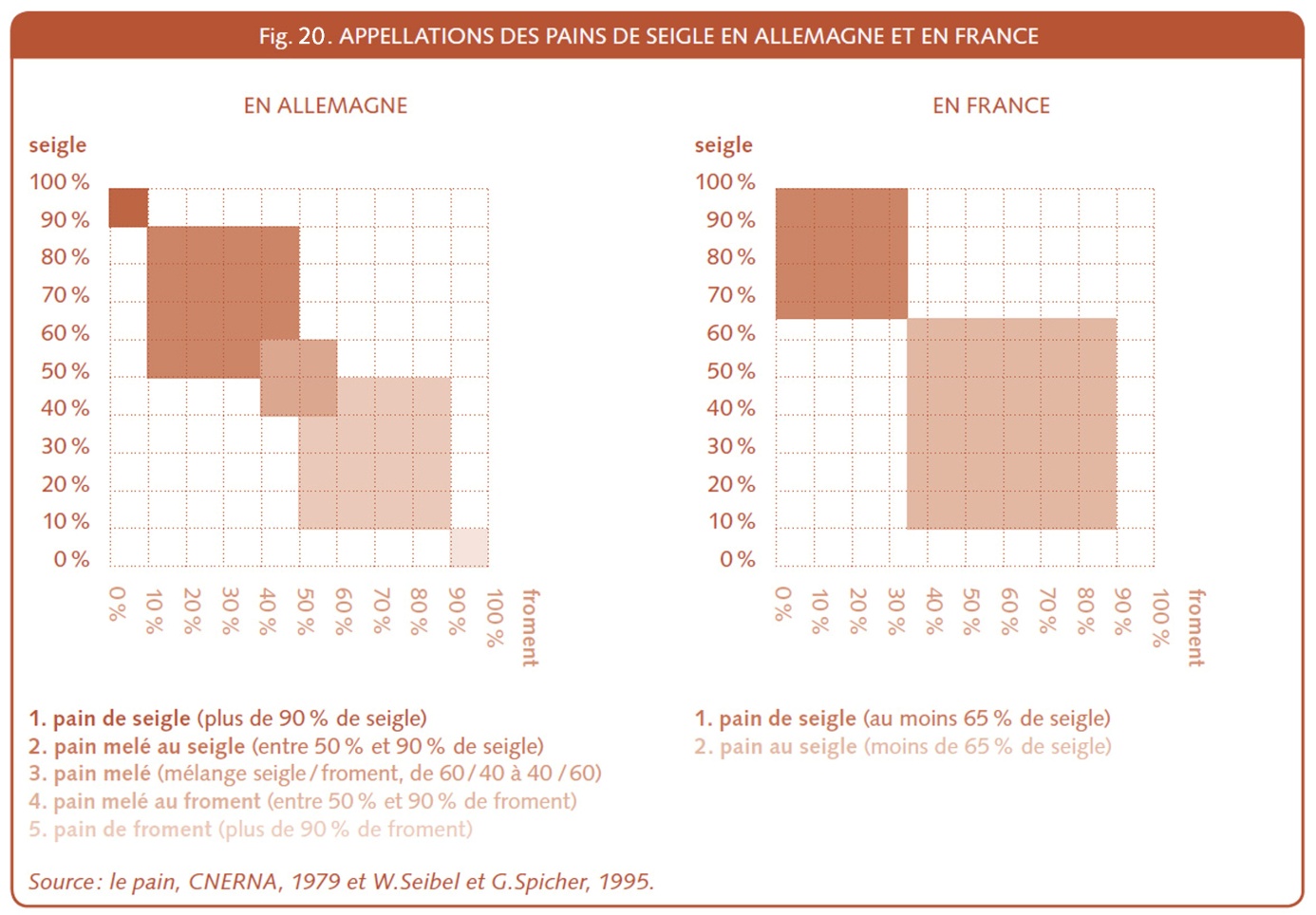
X.7.1. Les triticales
Le triticale, terme qui apparait en 1935, condense les deux appellations latines Triticum/froment et Secale/seigle, c’est un hybride interspécifique blé/seigle (X.1).
Le triticale est un rêve pour tout sélectionneur ; apporter, dans une même semence, la qualité panifiable du premier avec en plus la rusticité du second. Même en toilettant les épis, ce qui retire les organes mâles émettant le pollen et après lui avoir procuré du pollen d’une autre variété (fig.7 dans III), cela ne réussira pas si les gènes sont différents. Il faut que ces plantes soient proches. On ne peut pas croiser des éléments femelles (ovaires) d’un blé « ancien », tel le petit épeautre (diploïde ou 1 paire de 7 chromosomes) et le féconder par un élément mâle, le pollen d’une variété moderne tel « Apache » de 1998 (hexaploïde ou se retrouvent 3 paires de 7 chromosomes). C’est pourquoi certains vont jusqu’à dénommer le triticale, le « premier blé artificiel ».
Il a été observé scientifiquement pour la première fois en 1876 par le botaniste écossais Alexander Stephen Wilson. C’était l’époque ou une voie et une explication de la science s’ouvrait sur un nouveau marché, un nouveau métier, les semenciers et que ceux-ci menait du coup, un foisonnement d’expériences.
Il s’agissait d’un croisement entre un blé tendre (hexaploïde) castré, recevant du pollen de seigle (diploïde) donnant un octoploïde. Un peu après l’expérience que relate A.S.Wilson le sélectionneur Wilhem Rimpau de Braunschweig en Saxe, obtient, en 1888, après de longues recherches, un Triticosecale Rimpaui Wittmack qui comme son prédécesseur est peu satisfaisant au niveau stabilité dans la descendance. Dans les années 1920-30 c’est le Triticum secalotricum saratoviense qui est décrit au centre de recherche de Saratov en Russie, il ne correspond en termes d’hérédité génétique qu’à un blé hybride F1 d’aujourd’hui (III.9) [262].
Cette émoustillante recherche d’alliance génétique (blé-seigle) sera pratiquement mondiale, elle durera plus d’un siècle pour aboutir à ce qu’elle souhaitait. C’est finalement, dans les années 1950 à 1970, qu’un programme de recherche commun émanant du Cimmyt (III.15) et de l’université du Manitoba réussira a effectuer une bonne levée de l’hétérogénéité de la descendance. A l’époque face cette impossibilité de surmonter complètement cette barrière de l’homogénéité dans la descendance entre les deux céréales que l’on voulait mixer, cela fera dire à Norman Borlaug (III.15) « Cela me semble être inhérent à la nature, façon de dire aux scientifiques de ne pas devenir trop arrogants »[263].
Pour que ce « mariage » blé-seigle fertile se réalise, il faudra l’emploi toujours mieux maitrisé du réactif du à la colchicine, réaction découverte en 1937 et qui en génétique des plantes permet de « doubler » les chromosomes (fig.22). Cette colchicine est un alcaloïde extrait du colchique, qui « est connue pour empêcher la division cellulaire »[264].
C’est cet emploi qui sera contesté puisqu’il faut dire que dans la génétique, on joue là, avec un produit dont 1 milligramme est toxique et 4 milligrammes, mortel.
Les premières homologations officielles d’un triticale distinct, homogène et stable (D.h.s.), comme le demande les législations datent pour la Hongrie et l’Espagne de 1968 et 1969 et de manière plus marquée les années 1980 pour l’Allemagne et la France [265].
Il existera au début de la commercialisation, une fusion des chromosomes issu de blé tétraploïde ou hexaploïde avec ceux issus de seigle commercial, dénommé « triticales primaires ». Suivront les triticales dites « secondaires » résultant de croisement entre triticales primaires octoploïdes et hexaploïdes, ce qui élimine le génome D de l’égilope tauschi [266].
C’est généralement ces triticales secondaires qui se retrouvent actuellement sur le marché.
X.8. Les orges

Voilà une céréale, souvent diploïde, pas vraiment panifiable, que l’on va retrouver sous beaucoup de latitudes et altitudes. Difficile à décortiquer, Parmentier disait même que l’orge était « revêtu de deux écorces[267] ». Il est cultivé dès lors pour le fourrage, la brasserie et la distillerie. Un orge dit « brassicole » aurait la spécificité d’avoir un fort pouvoir germinatif (95 %), comme pour une qualité semence (IV.4). Quand sa capacité germinative est moindre, l’orge est déclassé en aliments pour bétails, avec une réduction du prix d’achat[268]. Le marché du malt qui en résulte est largement formaté par les multinationales de la bière et n’offre que des prix dérisoires aux producteurs, avec des incitants insignifiants pour s’engager sur une pseudo-qualité brassicole par exemple. Le retour à l’agriculteur du prix payé par le consommateur à l’achat de bières est extrêmement faible, de l’ordre du centime d’euro sur le litre de bière.
On pourra choisir de semer de l’orge d’hiver ou de printemps. L’orge d’hiver à six rangs s’appelle l’escourgeon.
Dans les belles géométries que peut-nous offrir la nature, l’alignement des barbes de l’orge est le plus remarquable par rapport aux autres céréales (fig.21).
L’orge nue est une exception puisque cette céréale est généralement vêtue. Cette dernière devra, surtout dans le cas où il est destiné au maltage, être stockée avec soin.
Existe-t-il pour la boulangerie une orge spécifique ? Tout est à faire pour le savoir.
Ces protéines, dénommées hordéines, n’ont rien à voir avec celle du froment et surtout le froment moderne. Lorsque l’orge est utilisée en panification, c’est presque par défaut, ou très tôt dans l’histoire, chez les Grecs quelques siècles av. J.-C. par exemple[269]. Il sera également présent lors d’une pénurie alimentaire momentanée ou dans des régions plutôt dédiées à l’élevage quand la culture des autres céréales y est difficile. L’orge est en effet une céréale résistante, plus encore que le seigle, spécifique des pays froids et montagneux. Sur le toit du Monde, dans l’Himalaya, le pain d’orge est présent pour cette raison et c’est même son lieu d’origine. Le pain tibétain n’est pas très levé, c’est plutôt une galette avec bien peu de mie.
À l’époque de la Convention, le décret français du 26 brumaire an II (15 novembre 1793), deux cents ans avant le décret du pain de tradition, voulait instituer en règle républicaine le pain de l’égalité. « Prônant que la richesse et la pauvreté devant disparaître, il ne sera plus composé un pain de fleur de farine pour les riches et un pain de son pour les pauvres. […] Le pain de l’égalité sera composé de trois quarts de froment et d’un quart de seigle ou d’un quart d’orge dans les lieux où on ne trouvera pas une quantité suffisante de seigle ».
La même année, un des premiers dictionnaires wallon-français, en région liégeoise, donne curieusement comme traduction de pain d’orge, une expression latine « tibi marli [270] », ce qui peut se traduire par « Pour toi Sacristain ». Ce n’était pas pour le curé en tout cas, mais bien pour un personnage d’un degré en dessous au niveau importance. Les expressions proverbiales pour l’aspect, « grossier comme un pain d’orge », et pour le goût, « mauvais comme du pain d’orge », trahissent la piètre réputation de l’orge en panification.
C’est d’ailleurs encore après la Seconde Guerre mondiale comme un produit de substitution du froment que l’on traite la farine d’orge[271]. L’Italie, très riche en pains régionaux, présente deux pains d’orge (« orzo ») dans un inventaire réalisé fin du siècle passé[272]. Un en Sardaigne et l’autre dans les Pouilles. On ne leur demande pas de trop de développement à ces pains d’orge. Soit très fines feuilles de pâte à pain cuite puis recuite pour le pain sarde et petit pain sec pour l’autre. Ce dernier porte le nom de « friselle », (de « écraser »), dans les Pouilles. C’est une sorte de pain recuit ou biscotte qui se trouve aujourd’hui rarement à la farine d’orge mais au blé dur. Il permet une longue conservation et a été façonné en anneau afin d’enfiler ceux-ci dans une ficelle et les garder suspendue, à l’abri des rongeurs. Le deuxième, est le plus connu des deux, mais l’on sait rarement qu’à l’origine c’était un pain de berger qui partait en transhumance pour plusieurs mois. Pour cette raison, ce pain devait se conserver longtemps. Le pain d’orge sarde originel porte le nom de « S’oriattu[273] ». Une fois réalisée, la pâte à pain est abaissée très finement et, à la cuisson, cette feuille éclate en deux comme le pain pita. Après un léger refroidissement, à l’aide d’un grand couteau on sépare en deux ce pain creux et on repasse au four les fines feuilles pour bien les sécher afin de bien les conserver.
Aujourd’hui le pane carasau est appelé « carta musica » par/pour les touristes, peut-être parce qu’il est aussi fin que du papier à musique ou puisqu’on fait autant de bruit en mangeant ce pain que lorsqu’on mange du pop-corn. Ce pain est maintenant présent dans les épiceries fines et restaurants en quête de typicité. Fort semblable au pane d’orzo/S’oriattu, il n’est plus composé d’orge, mais de blé dur ou tendre. Et comme souvent pour les recettes de pains régionaux anciens, le levain a été remplacé par la levure. On passe ainsi du produit servant à se sustenter au produit de diversification régionale avec attrait touristique au niveau culinaire.
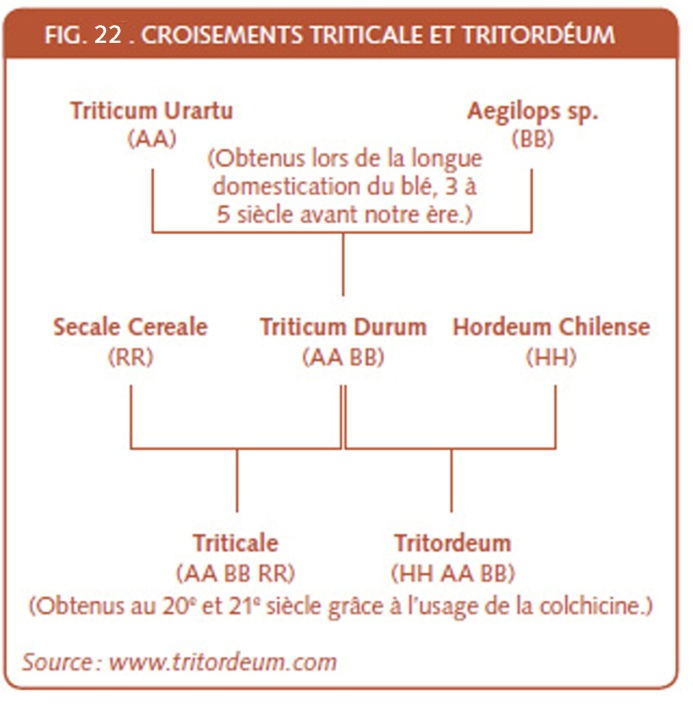
Et si c’est en termes de variation que la panification de l’orge vous intéresse, en professionnel de la pâte, sachez que les spécialistes allemands dans Speltz und Schälgetreide ( soit : Grains vêtus et grains nus), ne remplacent que 20 % de froment par l’orge pour des pains de mie où le procédé d’ébouillantage, Brühstuck, d’une partie de la pâte semble donner un bon résultat, l’orge étant riche en gommes[274] (pentosanes). La présence d’orge rend la pâte poreuse et risque de faire rougir la croûte plus vite à la cuisson. Pour des pains plus en croûte, du type baguette, les professeurs Calvel et Nuret en 1948, vont jusqu’à 30 %, mais avec des critiques sur l’aspect de la croûte (coup de lame creux et moins jetés) et aussi de l’amertume. Le professeur Calvel signale que pour l’orge, il y aura intérêt à faire des pâtes douces et froides, et de réduire la fermentation, surtout l’apprêt. Rectifier le côté granuleux de la farine d’orge par l’aspect poisseux venant de la farine de seigle était aussi une donnée intéressante fournie par le professeur Calvel dans ce qui était un de ses premiers écrits [275].
X.8.1. Le tritordeum
Comme pour répondre à une diversité demandée par les consommateurs, et venu récemment sur le marché (en 2006), voilà le tritordeum qui est une exclusivité de la firme Agrasys de Barcelone. Il a été l’aboutissement d’un long travail commencé dans les années 1970 à Cordoue. Il a démarré avec quatre-vingts lignées de blé dur et plus de cent lignées d’orge. Les premiers croisements donnèrent naissance à plus de 250 lignées et l’usage de la colchicine sera nécessaire pour superposer les chromosomes distincts. Finalement, c’est une orge sauvage, hordeum chilense, trouvée lors d’une des cinq expéditions réalisées en Amérique du Sud, qui sera le bon coup de pioche pour la création du tritordeum (fig.22).
X.9. Les avoines

Dans le dictionnaire anglais de Samuel Johnson, publié en 1755, on lit cette définition: « Avoine : un grain que les Anglais donnent à leurs chevaux, mais qui, en Écosse, est consommé par le peuple ». Avec la répartie qui les caractérise, les Écossais ont rétorqué : « Voilà pourquoi l’Angleterre a de si bons chevaux et l’Écosse des hommes aussi admirables ! »
Je ne voudrais pas poursuivre des hostilités verbales avec ces paroles qui sont comme un instantané du Royaume-Uni au xviiie siècle, mais j’apprécie ces citations parce que ma région subit un microclimat froid et que l’avoine y était la céréale la plus cultivée. Et je trouve en l’avoine comme une liaison très forte entre le terroir et les besoins des humains qui y vivent. L’avoine apportant force et chaleur et cette force et cette chaleur, nos ancêtres qui devaient défricher les forêts pour gagner en espace cultivable en avaient bien besoin.
Ainsi, lorsqu’en promenade, mon regard se pose aujourd’hui sur une prairie que nos aïeux avaient péniblement épierrée et dessouchée, et qu’elle est maintenant recouverte de sapins de Noël, j’ai un peu honte de vivre à notre époque.
Lorsqu’on arrache un bois, retourne un pré ou brûle un terrain, c’est souvent l’avoine que l’on sème en premier, voilà un concurrent du seigle pour l’essartage. Encore qu’à choisir, l’avoine a moins besoin de terres « engraissées » que le seigle.
Revenons à la manière dont l’avoine était consommée autrefois. On la mangeait en bouillie « porridge » assez sèche ou crémeuse, en galettes sèches cuites dans des fers à gaufres plats, mais pratiquement pas sous forme de pain. Le pain d’avoine est bien renseigné par l’historien du pain Max Währen au ixe et xe siècle, mais il s’agit de pain très peu levé et même déclaré de mauvais [276].
En 1846 et en 1847, les récoltes de froment furent désastreuses en Europe. E. M. Péligot signale qu’en France, le Ministère de l’Agriculture demanda au Conservatoire des Arts et Métiers d’étudier des solutions de rechange. Et notamment « d’obtenir avec la farine d’avoine, un pain plus beau et meilleur à tous égards que celui qu’on fait dans quelques contrées avec cette céréale. L’intérêt que représente la solution de cette question est d’autant plus grand, que l’on a remarqué que l’avoine est souvent plus abondante et à bas prix dans les années ou le froment est rare et cher. ». Mais les tentatives que E. M. Péligot a faite pour panifier l’avoine n’ont pas été très heureuses, écrit-il[277].
L’avoine est une céréale, qui peut-être diploïde, tétraploïde ou hexaploïde [278]. Plus d’une dizaine d’anciennes variétés, en panicules (fig.23) bien dispersées ou resserrées en grappes, sont données en 1846 dans le manuel Roret [279], dont des vêtues, soit ; blanches, brunes ou noires, et une seule nue (décorticable) à l’époque. Elles proviennent souvent du Nord de l’Europe (de Saxe, Sibérie, Pologne, Hongrie et écosse) d’après les catalogues spécialisés de la graineterie Denaiffe à Carignan dans les Ardennes françaises[280].
La variété « Panache de Roye », dénommée par dérivation « Panache du Roy », très impressionnante au niveau production, serait le fruit des pérégrinations estivales, parfois cyclistes, de Raoul Lemaire, qui la conserva et multiplia dans ses premiers champs de collection à Roye dans la Somme.
On sème l’avoine dans des terres plus chaudes et sèches en automne et humides au printemps.
Du fait de sa forte teneur en matière grasse, elle pose des problèmes de conservation qui se pratique dans des espaces frigos pour l’avoine nue.
Nous verrons plus loin la difficulté de panifier cette céréale qu’est l’avoine. Il faut la trier et si d’aventure vous deviez le séparer de l’engrain, c’est presque mission impossible puisque leurs diamètres sont proche nous confiait Patrick, paysan-boulanger.
Ensuite, il faut décortiquer, et là encore le longiligne et petit grain d’avoine nécessite des appareils ou réglages assez appropriés. S’il passe au moulin, le meunier risque de faire la moue avant de l’accepter. On sait que l’avoine est la graine qui contient le plus de matières grasses, ce qui n’est pas étonnant vu la taille de son germe. Ce gras remplit bien vite les fines rhabillures des pierres meulières et a aussi tendance à obstruer les mailles du blutoir. On imagine le surcroît d’entretien du matériel meunier que cela exige. Du coup, l’avoine doit être davantage séchée que les autres céréales si d’aventure elle passe sous la meule et dans le blutoir. On utilisait régulièrement le solde de chaleur du four après les fournées de pain pour dessécher convenablement l’avoine.
On a plutôt énuméré les contraintes de l’avoine et pas de trop les raisons qui peuvent nous porter à les surmonter. Pourtant l’avoine en vaut la peine : de meilleures valeurs d’acides aminés dans ses protéines, un taux supérieur en matières grasses de bonne valeur nutritionnelle, des fibres dites liquides, plus faciles à digérer pour les estomacs fragiles, de très bonnes teneurs en vitamines, voilà un bilan nutritif dont il faut essayer de tirer parti. Pas certain que ce soit en pain, mais comme c’est lui qui nous concerne, examinons en échange d’expérience où il y a lieu d’être attentif.
On trouvera difficilement de la farine d’avoine, mais le flocon d’avoine est lui bien présent sur le marché. Il est normalement décortiqué, aplati et cuit à la vapeur pour le stabiliser commercialement. Faire tremper ce flocon afin de le ramollir et le mélanger aux autres farines n’est pas compliqué.
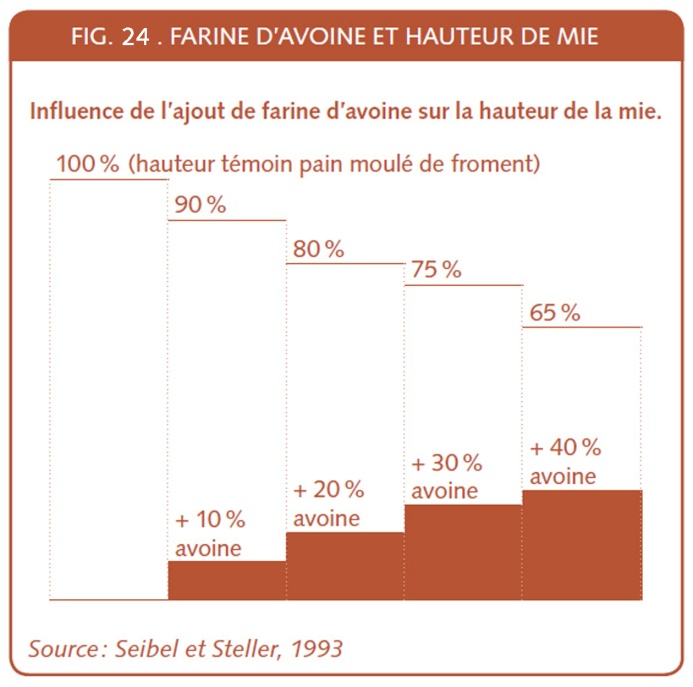
La farine d’avoine risque d’être un peu toastée si l’on utilise l’ancien procédé de séchage. Ce sont surtout le marché allemand et du nord de l’Europe qui se sont intéressés aux fibres liquides de l’avoine permettant d’améliorer le transit intestinal avec des fibres solubles, ce qui est rare en céréales et permet de moins irriter le colon (maladie de Crohn, par exemple). Un outillage s’est mit en place pour retirer et commercialiser à part, les fibres d’avoine.
Dernièrement en 2002, ces fibres d’avoine seront exploitées selon un modèle d’économie circulaire chez Fazer à Lahti en Finlande pour produire le sucre pentose « le plus durable au Monde » permettant une alternative plus saine que le sucre blanc et en recyclant comme bioénergie le résidu de la production de ce sucre alternatif[281].
Si l’avoine ne réussit pas bien en panification, c’est probablement à cause de sa teneur en matières grasses au moins trois fois supérieure à celle du blé tendre.
On remarque qu’avec une dose progressive d’ajout de farine d’avoine, la mie s’appesantit et devient plus compacte (fig 24). Il semble en effet que la matière grasse alourdit l’aspect de la mie, si elle n’est pas émulsifiée ou hydrophile, ou encore si elle est à trop longues chaînes[282], ce qui est peut-être le cas des matières grasses de l’avoine.
La solution flocons pré-trempés faisant comme un lait d’avoine est le meilleure type de remplacement de la farine d’avoine en panification. Les flocons étant de l’avoine décortiqué et aplati puis cuit à la vapeur (95°C) afin d’inactiver les lipases qui risque de faire rancir le gras de l’avoine. Ils peuvent passer entre deux cylindres chromés chauffés. Ils seront ensuite séchés et conditionnés.
Par rapport à la mie de pain de froment moulé témoin et à raison de 20% d’ajout, le flocons d’avoine est moins pénalisant dans l’effet de tassement de la mie (88% du témoin), que l’incorporation de farine ou semoule d’avoine (77% de la hauteur de mie du pain témoin). Sachez, pour ne pas vous en étonner, que la fermentation au levain de l’avoine conduit à des odeurs de pet de cheval.
Avec l’avoine, on aurait déjà pu entrer dans la partie des farines sans gluten, mais voilà tous les comités scientifiques des associations de malades cœliaques qui régissent ce point ne sont pas d’accord.
Au Nord de l’Europe, l’avoine est parfois acceptée, cela a fait l’objet d’une longue révision au niveau intolérance suite des enquêtes finlandaises et irlandaises de 1995, mais on n’ose pas trancher sur le sujet dans les congrès internationaux Prolamin (congrès des sociétés cœliaque) suite aux contradictions biochimiques et médicales[283]. Sous le prétexte de potentialité de contamination croisée apportée par le fait que l’avoine suit souvent le blé dans les rotations, les 20 ppm (0,02 gramme au kilo) qui sont la norme à ne pas dépasser pour les cœliaques risquent trop vite d’être atteints. L’interdit demeure pour cette raison chez les enfants, quant aux adultes, ils décident en fonction de leur sensibilité. En 2004, une étude suédoise d’un an sur une population cœliaque jeune consommant jusqu’à cinquante grammes d’avoine par jour n’a pas trouvé d’effets négatifs[284].
C’est la norme du Codex Alimentarius pour l’appellation « sans gluten » qui régit ceux qui doivent l’éviter, mais elle s’applique de facto, et un peu trop vite à mes yeux, aux intolérants sensibilités au gluten non cœliaques[285].
Alors si l’on est dans la position de conseil scientifique ou médical et que l’on est appelé à rassurer, il est normal que ces conseiller(e)s prennent moins de risques en n’autorisant pas l’avoine par exemple. Dans le doute, ils s’abstiennent. Noter qu’il existe de l’avoine sur le marché, certifié comme ayant moins de 0,02 gramme de gluten, me disait Pierre, boulanger sans gluten près de Theux (Bel).
Avec cette norme qui régit l’appellation de « sans gluten », il est pratiquement impossible dans un moulin et/ou une boulangerie travaillant les pains sans gluten et les autres pains (même bio, artisanale et de tradition) d’assurer que l’on ne dépasse pas ces 0,02 gramme au kilo. Avant juillet 2008, la norme était de 0,2 gramme, soit dix fois plus[286]. D’où ces communications des sociétés regroupant les malades cœliaques de ne plus faire confiance aux boulangeries artisanales pour le pain sans gluten.
Et on ne peut pas être ordonné prêtre catholique suivant l’interprétation du droit canonique faite fin des années 1980 par le préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi, le cardinal Joseph Ratzinger qui allait devenir le pape Benoit xvi en avril 2005, puisque les prêtres cœliaques ne peuvent pas communier[287]. Pour les responsables du Vatican et au moins depuis Saint Thomas d’Aquin au xiiie siècle[288] lorsque la partie farineuse passant dans le fer à cuire l’hostie n’est pas du froment, elle n’est plus une hostie pouvant être consacrée[289].
Le pain azyme consacré, (l’hostie), est en effet confectionné avec des farines riches en gluten et le seuil de 0,02 gramme est ainsi facilement atteint.
Le pain dit sans gluten est donc une option aux contraintes légiférées difficilement réalisable. Les premières enquêtes qui mettent en doute l’évolution des critères de la sélection des protéines du blé n’ont été que faiblement prises en compte.
Comme cette enquête de l’équipe de Hetty Van den Broeck[290], qui a comparé la présence d’une fraction (épitote Glia α 9) des protéines de gluten « toxiques » dans les variétés de blés modernes et anciens. Elle a été tout de suite été contre-argumentée. Notez que cette fraction protéique énoncée ici est encore différente de la présence de gluténines à haut moléculaires vu par ailleurs.
X.10. Les millets, sorghos et autres…
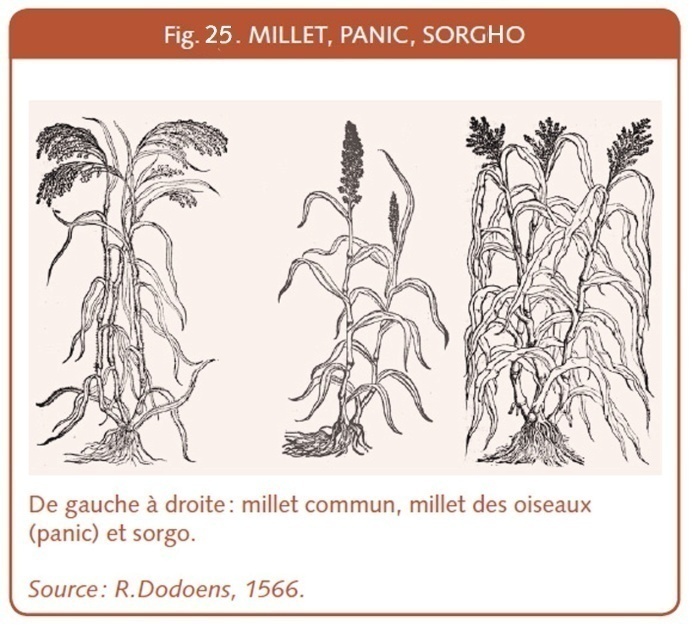
Avec le millet, on entre dans ces graines, et ici encore céréales, « autorisées » pour les sensibilités digestives qui veulent discriminer le gluten.
Comme le seigle qui est dénommé centeno en espagnol, puisqu’il donnerait, d’après la tradition populaire, cent graines pour une semence (à vérifier !). Le millet est appelé ainsi en français parce qu’une graine-semence est censée en donner mille à la récolte.
Voilà une céréale ancestrale, c’était la principale céréale de la Chine de la plaine du fleuve Jaune[291]. C’était aussi une céréale qui réussissait en Afrique. Les premiers livres d’agriculture en arabe en font déjà mention au xiie siècle[292] ce qui nous oblige à différencier, panic et millet (fig.25 et fig.26). Mais pas de panique, il ne nous faudra pas consulter trente-six dictionnaires pour trancher. L’ethnologue François Sigaut nous permet de ne pas tomber dans les mêmes difficultés qu’il a rencontré et il nous prépare la tâche[293], en précisant que le millet commun (Panicum miliaceum) est le millet blanc qui a des panicules larges. Le millet des oiseaux ou panic (Setaria italica) à une inflorescence ou la grappe de graines est plus serrée se présentant en masse plus compacte. Tout comme le sorgho en forme de chandelle, est soit dénommé gros ou petit mil en Afrique de l’Ouest et lorsqu’il est disposé en panicules larges, sorgho à balais, puisque les épis, une fois débarrassés de leurs graines et liés à leur base, peuvent avoir cette fonction utilitaire de brosser le sol.
| Fig.26. Dénomination de deux des espèces de millet, les plus connues. | ||
| En latin botanique actuel | Panicum miliaceum | Setaria italica |
| En latin classique | Milium | Panicum |
| En anglais | Common millet | Foxtail millet |
| En allemand | Rispenhirse | Kolben hirse |
| En allemand (Suisse 1917) | Zöttelhirs | Zapfehirs |
| En français (extrait du Petit Robert) | Millet commun | Millet des oiseaux |
| Millet blanc à inflorescence lâche, allongée | Millet d’Italie ou millet à grappes avec panicules serrées et épillets courts | |
| D’après SIGAUT, 1994. | ||
Puisque sorgho, mil, millet commun, millet des oiseaux ou panic, teff, fonio et même maïs seront dans l’histoire mélangés sous diverses appellations. Les dénominations seront une fois rassemblées et une fois distinctes [294]. Les Portugais ont d’ailleurs gardé de cette époque postcolombienne des caravelles, le nom de milho au maïs, puisque les plantes se ressemblaient un peu et que le maïs a supplanté le millet dans des préparations culinaires.
Maintenant prenons la recette ancestrale reprise d’un livre d’agriculture en arabe d’Ibn Al Awwan datant du xiie siècle[295]. Pour panifier le millet des oiseaux on le trempe dans l’eau chaude. Après, en mélangeant sans interruption jusqu’à évaporation complète de l’eau, on pétrit en ajoutant de l’amidon et on achève la panification (fermentation et cuisson).
D’après l’écrit en grec ancien de Discoride, une des sources écrites d’Ibn Al Awan, le pain au millet des oiseaux est moins nourrissant que celui de millet commun et la fermentation suivie de la cuisson rend le pain plus moelleux.
Dans la sphère des millets, vous avez encore le djavarisch qui est mentionné dans l’ un écrit du xiie siècle, qu’il faut interpréter comme étant le sorgho[296].
Il nous faut beaucoup de discernement et nous laisser guider par le spécialiste pour nous y retrouver d’un pays à l’autre et d’une époque à l’autre. Mais remarquons que notre millet des oiseaux est panifié dans le monde arabe du xiie siècle via l’ébouillantage et un temps de repos.
Diététiquement, nous sommes là avec des céréales pas du tout pauvre en protéines. Mais comme souvent riche en acide phytique et tanins. Une fermentation au levain plutôt que levure est vivement souhaitée pour rendre les minéraux biodisponibles[297].
Une des difficultés rencontrées avec ces millets est la conservation sans rancir[298], surtout après décorticage qui exige un remouillage conséquent (30 % pour le mil, 40 % pour le sorgho) déclenchant la dégradation enzymatique[299], si le séchage n’est pas appliqué rapidement après.
Le site www.terramillet.com créé par Martine Dugué milite pour ces céréales reprises sous le nom générique millet. Vous y obtiendrez une foule de renseignements pratiques. D’abord pour découvrir leur atout face au réchauffement de la planète. En effet, la plante existe déjà, pas besoin d’aller changer l’Adn d’autres plantes pour cela. Ensuite, les millets permettent l’agriculture locale et diversifiée dans des pays que l’on souhaite en développement au niveau de l’essentiel, l’autonomie alimentaire[300].
Pour la panification, Martine Dugué oriente plutôt vers le panic brun ou rouge, plus goûteux. L’association Terramillet travaille aussi pour relancer sa culture, là où elle avait disparu en Europe et notamment pour la France, en Anjou[301] et en Vendée[302] où souvent il faut lutter contre le fléau qui s’appelle moineaux. Ce n’est pas pour rien qu’une sorte a été appelé millet des oiseaux. Dans ce cas, comme toujours, l’importance des aires de culture limite l’étendue que la petite gente ailée peut saccager. C’est que l’on appelle « faire la part du feu », les prédateurs des passereaux et autres, du type rapace, vont aussi venir plus facilement et contrarier le chapardage[303].
Le professeur Calvel va en 1995 produire un article où il a essayé une incorporation de farine de mil à balais (sorgho) en pâte autolysée et en farine ne dépassant pas les 30 % d’incorporation par rapport au froment. Les essais s’étant réalisés dans les années 1970 avec un pétrissage intensif et un ensemencement de 2 % de levure[304].
En Allemagne où on aime la diversification, l’essai comportant de l’ébouillantage avait un petit avantage[305].
Si l’on doit utiliser des millet-sorgho de la côte de l’Afrique de l’Est, on se retrouve avec le sorgho et le pain plat dénommé kisra. C’est au Soudan qu’on fait ce pain, genre crêpe, qui sert d’accompagnement au repas.
L’injera a de par son acidification fort prononcée, est une crêpe se déguste avec une farce de légumes que l’on enroule dedans. Elle est d’origine éthiopienne, confectionnée avec de la farine de teff de la même provenance.
L’éleusine est une graminée sauvage et cultivée et est parfois classée dans le groupe un peu générique des millets comme en témoigne le surnom qu’on lui attribue de mil rouge ou mil africain. D’origine africaine, elle est cultivée au centre de celle-ci, on la retrouve en Inde également, où elle est dénommée ragi, avec des épis plus courts et des graines décorticables[306].
Le teff, est encore une petite céréale de zones arides, il faut 2 500 à 3 000 graines pour un gramme, c’est dire. C’est même trop petit que pour être attaqué par les insectes parait-il. Teff aurait comme étymologie le sens du mot, perdu. Puisque les graines sont si petites qu’il est impossible de les récupérer si elles tombent au sol[307]. C’est classé par tradition dans les familles de millet ou sorgho. La farine de teff a fait l’objet en 2007, d’un brevet déposé à l’Office européen des brevets (E.p.o) par une firme néerlandaise (HPFI) et l’état éthiopien ou le teff est connu depuis des millénaires a du déposer plainte et porter l’affaire devant les tribunaux internationaux pour récupérer ces droits[308], accordé un peu trop facilement par l’E.p.o. Cet organisme ne remplit pas de fonction régulatrice et vit grâce aux nombres de demande de propriété intellectuelle demandée.
Il faut relativiser l’apport de ces petites graines. Ce n’est pas tant qu’elles ne sont pas intéressantes au niveau nutritionnel. Elles ont même de très bonnes valeurs protéiques, vitaminiques et minérales, mais il faut de solides fermentations pour rendre ces nutriments disponibles.
Le fonio, graine ouest-africaine de très petite taille, doit être décortiquée. Et pour ne pas retourner à l’expression des « graines de la peine » vue au début de ce chapitre (X.1 et X.17), il est nécessaire de ne plus devoir par exemple se mettre à les travailler au pilon avec du sable, puis devoir par après les passer au van, afin de séparer par sassage, la graine décortiquée, le sable et les balles. Espérons que l’outillage pour faire ces opérations de décorticage et nettoyage soit de plus en plus accessible aux peuples qui veulent conserver une culture de tradition (il faut compter plus de 1 300,00 €, pour une décortiqueuse à fonio, actuellement) plutôt que de consommer du riz ou du blé d’importation et ne pas réserver ces cultures qu’à notre seule curiosité d’occidentaux recherchant des grains sans gluten.
X.11. Les maïs
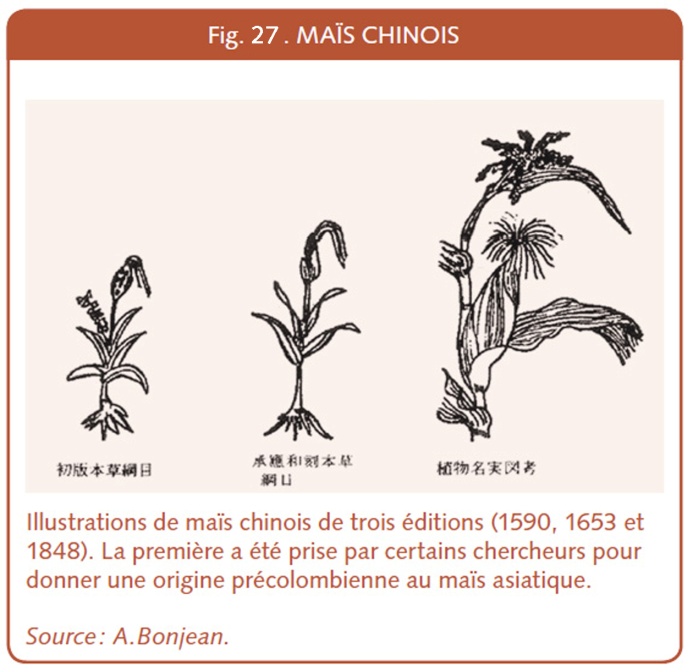
Avec ces descriptions chinoises (fig.27) datant, pour la plus vieille du xvie siècle, on comprend mieux pourquoi, lors de son apparition en Europe au xvie siècle, le maïs sera apparenté au millet et surtout au sorgho (fig.25).
Le maïs sera vite adopté en Europe et remplacera le sorgho, parce qu’on est en présence d’une plante qui produit beaucoup de matières autant dans sa rafle (nom de l’épi de maïs), qu’avec ses tiges et feuilles. Puisqu’on n’a rien sans rien, sa culture est exigeante en apports, surtout en eau. À l’époque où l’abondance n’était pas encore synonyme de rendement, le maïs va voyager rien qu’avec sa dénomination. Au début, c’est le blé d’Inde (toujours appellé ainsi au Canada français), de la voie dite des Indes par Christophe Colomb. Blé de Turquie, (qui occupe alors les Balkans), sera son nom en France et en Allemagne. En Turquie, par contre, il se dénomme parfois blé d’Égypte. L’appellation blé d’Espagne a été régulièrement employée également, vu que ce pays dans sa période de colonisation en était pratiquement le premier importateur[309].
Que faire de ce maïs qui arrivait ? Du pain ?
Avec ces cinq siècles d’existence sur le continent européen, des plats réalisés à partir de sa semoule sont entérinés comme traditionnels. Les bouillies, polenta italienne et mamaliga roumaine sont les plus connues, avec le broa portugais qui sera un peu notre repère panifiable.
Le maïs de nos jours a bien changé depuis neuf millénaires. De la téosinte qui est sa forme primitive, avec 5 à 10 grains sur deux rangs, il a actuellement quatre à cinq cents gros grains en moyenne par rafle. Parmi les premiers maïs domestiqués originaux, Vavilov va trouver des variétés appartenant au groupe Cuzco, déjà connues des Incas, avec des graines trois à quatre fois plus grosses que les maïs contemporains[310].
En tant que plante nettement allogame (se croisant et échangeant le pollen entre variétés différentes), le maïs va évoluer assez fort, par ses potentialités de fécondation croisée.
Il faut d’ailleurs veiller à respecter des distances entre semis de variétés de maïs différentes. Même si les 3/4 de l’abondant pollen émis par les soies du maïs ne vont pas plus loin que quelques mètres, cela peut aller jusqu’à dix kilomètres[311]. Si l’on veut préserver la variété paysanne du pollen d’une autre variété et notamment de maïs Ogm, on doit penser à les éloigner suffisament l’une de l’autre.
Ce sera dans un de ses pays d’origine, aux États-Unis d’Amérique, que l’essor agricole va l’embrigader vers l’hybride F1. D’abord, on va effectuer des croisements entre maïs dentés et maïs cornés qui sont distints génétiquement. Le premier situé plus vers l’Amérique du Sud, est plus farineux et moins vitreux et le second plutôt nord-américain est à l’inverse, il est d’ailleurs surnommé « Northern Flints », soit silex du Nord.
William James Beal constate en effectuant ce croisement (entre maïs denté et maïs corné) en 1880 qu’il obtient une forte vigueur en rendement, mais la première année seulement. Un peu après, un autre chercheur John Harrison Shull (surnommé Georges) observe que lorsqu’après avoir obtenu en isolation des lignées pures par criblage et séparation de culture fortement éloignée vu le risque de pollinisation croisée[312], il a, lors du recroisement de celles-ci, une forte augmentation du rendement (il parle même de 300 %) par rapport aux lignées pures. Georges Shull ne constate pas que l’effet d’hétérosis et son augmentation en rendement, mais aussi le fait qu’il n’existe pas la première année de fluctuation du phénotype, ce qui permet de rentrer dans les standards commerciaux exigés par la loi sur les semences.
Edward M. East amplifie les mêmes phénomènes d’effet d’hétérosis, il prétend que le rendement des hybrides première génération (F1) est double par rapport aux variétés-populations sur le marché. Il est vrai qu’il faut ce rendement pour compenser le coût de production des semences hybrides F1. En 1917, un autre chercheur Donald F. Jones produit des semences hybrides F1 à partir de croisement de semences de maïs très productifs augmentant le rendement de semences hybrides par rapport aux semences de maïs population.
Toute cette recherche se déroule sous des programmes d’études gouvermentales. En effet, le père Henri Catwell (« Harry ») Wallace et le fils Henry Agard Wallace, importants fermiers dans l’Iowa, deviendront l’un et l’autre les ministres de l’agriculture des états-Unis dans ces années, respectivement de 1921-1924 et de 1933-1940. Ils sont en même temps directeurs de Pioneer Hi-Bred, ex Hi-bred Corn Company. Une collusion politico-économique qui va faire qu’aux States, 90 % des semences de maïs seront hybrides dès 1945. Dans un deuxième temps, la firme de la famille Wallace est dénomée « Pioneer » en 1929 pour la distinguer des autres firmes de semences de maïs hybride F1 et faire-valoir sa prépodérance historique dans le domaine de l’hybridation. Pioneer employait pendant les vacances d’été, 40 000 lycéens pour dépaniculer son maïs et ainsi pratiquer l’hybriditation[313].
C’est encore Henry Wallace fils qui orientera Nikita Khrouchtchev vers le maïs lors de la visite du russo-ukrainien aux états-Unis en 1958 et lui déclarera : « On entend beaucoup parler d’énergie nucléaire ces temps-ci. Mais je suis convaincu que les historiens considèreront la valorisation de l’hybride comme tout aussi importante[314] ».
À son retour, le premier secrétaire du Parti communiste de l’URSS qu’il fut de 1953 à 1964 a ordonné que les terres agricoles soient plantées avec du maïs. En Russie, on se moque encore de nos jours du maïs de Khrouchtchev, d’autant qu’il voulut en cultiver même en Carélie, dans le Nord, alors que de hautes températures couplé aux nombre de bons jours l’empêchent de venir à maturité.
Les sociétés commerciales de semences américaines du Nord, de petites vont devenir géantes, comme Pioneer de la famille Wallace revendue aujourd’hui à DuPont -Corteva, Funk qui sera racheté par Ciba-Geigy, aujourd’hui intégré dans China Chemical. Ainsi que Delkalb repris par Monsanto, puis Bayer[315].
Après l’hybride F1, la semence de maïs suivra dans les années 1990, l’avènement des maïs transgéniques Bt (avec les gènes du Bacille Thurengensis intégré, pour lutter contre la pyrale), Mon 810, etc. Ils ne sont cultivés au Sud de l’Europe, qu’en Espagne et au Portugal. Le brevet avec lequel sont commercialisées les plantes Ogm scellera juridiquement l’interdiction de resemer et par conséquent l’obligation du rachat des semences chaque année.
Une semence de céréale plus instrumentalisée que celle du maïs moderne, c’est pratiquement impossible à trouver.
Il existe tellement de possibilités de consommer ce maïs que sur le marché on trouve toutes sortes de maïs. Du maïs doux tellement riche en dextrines, plutôt qu’en amidon, qu’il présente des difficultés de germination. En plus il sera parfois récolté au stade laiteux, et du coup la conservation de ce maïs, servi comme un légume, n’est pas très longue, d’où leurs emballages en atmosphère conditionné. La sélection est arrivée à produire des maïs doux, sucrés, super sucrés et hyper sucrés. Pour le maïs spécial popcorn, on utilise une variété vitreuse capable d’éclater à la cuisson. Et là encore, la sélection a fait des prouesses, puisque certaines variétés éclatent sous forme de papillons et d’autres variétés le feront sous forme de champignons. Autre variété, le maïs cireux (waxy) est une variété dont l’amidon est riche en amylopectine et ne contient presque pas d’amylose, il sera mis en avant lors de la Seconde Guerre mondiale à cause du blocus japonais sur le tapioca thaï[316]. Le maïs cireux remplacera le manioc pour la production des produits épaississants.
La graine de maïs a une fine enveloppe externe transparente très difficile de retirer par voie mécanique. On suit encore la voie ancestrale consistant à tremper les graines dans des solutions alcalines, autrefois de cendres pures et saines, aujourd’hui de la chaux alimentaire (hydroxyde de calcium).
Cela s’appelle la mixtamalisation. Le lait de chaux étant composé de deux cuillères à soupe de chaux au litre. On laisse bouillir l’eau qui recouvre les graines pendant cinq minutes, puis on laisse reposer une nuit et on égoutte le lendemain. On rince les grains sous l’eau en les frottant entre les doigts et l’enveloppe s’épluche. Le maïs épluché s’appelle de noms amérindiens mixtamal ou hominy[317]. Broyés, ces grains donneront une massa gardée fraîche ou, pour de plus longue conservation, séchée.
Le broyage du maïs est plus rarement effectué à sec, comme c’est généralement les cas avec les autres céréales. Et lorsqu’il se réalise à sec, dans le commerce, on dégerme avant pour garder une bonne durée de conservation. Le premier dégermeur à maïs n’est apparu aux États-Unis qu’en 1906. Pour la mouture dite semi-humide du maïs, le grain préalablement trempé doit atteindre 20 à 23 % d’humidité. En amidonnerie, on va même jusqu’à 45 %. Il faudra impérativement sécher le produit obtenu après mouture. Cela va permettre de mieux retirer, pour la conservation, l’important germe (12 % du grain), qui concentre 83 % de sa teneur en matière grasse[318].
La panification du maïs est déjà connue en Italie au xvie siècle[319]. Et si l’on utilise le maïs pour la panification, il est parfois utile d’ébouillanter une partie de la part de maïs introduite, surtout si elle se présente sous forme de semoule. L’atlas des produits typiques italiens consacré au pain en avait recensé sur 140, une douzaine[320] et le livre de slow-food sur l’Italie du pain, n’était pas en reste[321]. Au Portugal, le broa de milho est déjà cité au xiie siècle mais encore réalisé au sorgho. Après, comme le maïs prendra le nom du sorgho (X.10), le broa se travailera au maïs également. Généralement c’est 50 % maximum de maïs qui entre dans sa composition, le restant étant composé de farine de froment au Sud ou de seigle au Nord. Parfois, au Portugal et en Albanie, on ira jusqu’à 100 % de mais, avec une mie très dense difficile à cuire, n’y cherchez pas d’alvéoles.
Avec la recherche en panification de maïs anciens plus biodiversifiés, on se retrouve mieux positionné qu’avec le maïs conventionnel, où par exemple ce broa portugais s’est parfois réalisé avec du maïs Ogm autorisé au Portugal. En 2015, c’était le cas de 7 pains broa traditionnels sur les 16 analysés[322].
Les maïs de population portugais, italiens et espagnols vont profiter du vécu de la sélection participative et d’un des fondateurs de celle-ci, le brésilien Altair Toledo Machado. En France sur cette manière de fonctionner, Agrobio Périgord et Bio d’Aquitaine vont ressortir des maïs population paysanne qui donneront de bons goûts[323]. Laurence Dessimoulie, auteure du livre « De ceux qui sèment à la cuisine[324] », écrit : « Les saveurs [des maïs de semences paysannes] sont plus fines, plus âpres ou plus grasses, la texture plus moelleuse, et puis ils contiennent plus de nutriments. Chacune s’exprime différemment au niveau texture, goût, couleur. J’ai passé beaucoup de temps avec les paysans qui sélectionnent : eux sont à l’écoute dans le champ, et moi, c’est pareil en cuisine[325] ».
Pour la panification, il faut choisir des variétés à polenta plutôt que des variétés fourragères à ensilage. Entre la farine plus farineuse du maïs denté et la semoule du maïs corné, l’attrait principal devrait être le goût exprimé.
X.12. Les sarrasins

Ah ! Comme ces graines[326] peuvent voyager ! Nous voilà chez les Sarrasins ! Avec le blé que l’on dit noir, on retrouve l’histoire sud-européenne du Moyen Âge qui définissait toute personne de couleur comme sarrasin. En espagnol, le nom du sarrasin est trigo moro, soit blé maure ou noir, en italien grano saraceno, blé sarrasin et en Autriche ainsi qu’en Allemagne du Sud, on l’appelle Heidenkorn, soit le blé des païens. Toujours en patois allemand, dans l’Eifel et le Luxembourg, on retrouve une autre traduction de la farine de sarrasin en « Willmelh » ou « Wëllkaarmiel » soit farine sauvage.
Plus au nord de l’Europe, le sarrasin porte un autre nom qui lui vient de la ressemblance de sa graine avec la faîne, le fruit du hêtre. Le voilà appelé « Buchweizen », c’est à dire « froment du hêtre ». Même différents dialectes latins emprunteront un dérivé de cette expression. On retrouvait au nord de la France les expressions « bucaille et bucquoy » et en Wallonie la toujours connue « boukête » liégeoise[327].
Le sarrasin n’est pas une céréale (fig.28), mais fait partie des polygonacées. A la Renaissance, son appellation latine est souvent « fromentorum saracenorum »[328]. Il y a quelques siècles, elle passait encore comme céréale, puis les nouveaux classements botaniques le rangeront dans la même famille botanique que les renouées, oseille et rhubarbe.
Son temps de culture exceptionnellement court (75 à 120 jours), sa facilité de culture, son adaptation aux climats humides et froids, tout cela fait que sa présence sera éphémère ou aléatoire, comme un secours principalement aux périodes difficiles dues aux guerres et aux saisons à climat perturbant[329]. La culture de sarrasin connaît plus que d’autres cultures un important problème d’une plante adventice. C’est la datura qui peut mesurer 1,50 mètre et donne une belle fleur à calice blanche dénommée dans le langage populaire, trompette des anges.
Ne la coupez pas avec vos mains et éloignez les enfants, afin de les éduquer face au danger de cette belle fleur blanche à calice. Elle contient des substances vénéneuses utilisées à doses infimes en pharmacie et pouvant au poids corporel créer de sérieux problèmes. Les symptômes décrits début octobre 2012 par l’Agence Régional de la Santé (Ars) dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sont ceux « d’une intoxication par l’atropine. Sécheresse buccale, pupilles dilatées, troubles de la vue, tachycardie, agitation confusion, désorientation spatio-temporelle, hallucinations, paroles incohérentes ». Voilà ce qu’indiquait l’Ars dans un communiqué en fin septembre 2012, invitant les personnes qui présenteraient ces symptômes à consulter rapidement leur médecin traitant. L’enquête d’une infection était la résultante d’une plainte où dix-huit personnes ont été contaminées et a mis en cause une farine de sarrasin souillée par le datura. En 2009, lors de mêmes cas d’empoisonnement l’agriculteur s’exprime et permet de mieux comprendre afin d’éviter, c’est de l’information utile et nécessaire.
« Une graine pour 10 000 graines de sarrasin et c’est assez ! Ce que je pense et ce qu’il est fondamental de comprendre dans nos démarches, c’est premièrement qu’en bio on n’est pas à l’abri d’empoisonner nos clients et que c’est d’autant plus râlant que nous travaillons pour la santé de tous.
Et deuxièmement, quand tu es en vente directe sur un territoire réduit il suffit d’une rumeur sur un marché, d’une plainte pas forcément bien intentionnée, d’un article dans un journal, etc., pour te griller les trois quarts de ta clientèle. Du datura il y en a partout et de plus en plus, trimbalé par les moissonneuses ou autres machines de triage. La plante est très facile à reconnaitre et il nous suffit de l’arracher avec des gants, avant qu’elle graine ».
Par contre la graine peut facilement passer entre les mailles. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter le site de l’Afssa.
Comme le sarrasin est proche des fleurs et pas de la même famille des graminées, sa culture ne supporte pas les herbicides. Le semis à la volée se fait à 200 grammes à l’are en lignes à 30-60 cm. Au semoir à céréales en ligne à vingt cm. Avec les autres graines/céréales (hormis le froment), l’évolution de l’agriculture lui fera marquer un déclin qui tombera au plus bas vers les années 1970[330]. Autrefois, il s’était développé en corollaire avec la production de miel[331].
Si l’on connaît bien la crêperie bretonne avec son blé noir en France, cela nous permet de comprendre cette faculté qu’a la farine de sarrasin de s’aplatir comme une fine dentelle sur le billig (poele à crêpes en breton)[332]. Des « buckwheat cakes » (crêpes au sarrasin) arrosés de sirop d’érable (« Vermont sirup ») étaient une des composantes des déjeuners des pionniers américains[333].
En Ardenne belge on mentionne des « berdelles », crêpes de sarrasin comme l’ordinaire dans la ration, au xixe siècle[334].
| fig.29. Deux types de graines de sarrasin bien distinctes | |
| Fagopyrum esculentum (soit faîne à manger) | Fagopyrum tataricum (soit faîne tartare) |
| Sarrasin commun (dit blé noir) | Sarrasin de Tartarie |
| De couleur noir à grise suivant le blutage | De couleur beige-verte, kaki |
| -graines triangulaires avec des faces « lisses »
– sensible au gel – nécessite une fécondation croisée par pollinisation , allogame |
-graines comportant une face avec rainure centrale
-résistante au gel , culture en altitude possible -s’autoféconde (autogame) -goût plus amer -considérée en Bretagne comme invasive |
| D’après une fiche réalisée dans le cadre d’un projet de recherche participative, Sarrasin du pays (Breizh-Bretagne) 2013-2014. | |
Pas de mie facile avec lui. De par le monde, on en fait surtout non seulement des crêpes, mais aussi des pâtes et on cuisine la farine ou les grains décortiqués comme le riz, soit en bouillie ou en plat unique. Cela donne du « tsampa » au Tibet, du « kasha » dans les pays slaves, du « soba » en Extrême-Orient[335], des « blinis » en Russie[336]. C’est en Chine que l’on produit les deux tiers du sarrasin cultivé dans le monde. Les 80 % du tiers restant proviennent de la Russie et de ses anciens pays « satellites[337] ». C’est en Chine et au Japon que l’on consomme le plus de sarrasin sous forme de soba. Comme pour les crêperies de Bretagne, il existe dans ces pays, des restaurants spécialisés, des bars à soba et des vendeurs ambulants de plats à soba [338].
S’il existe plus de 2 500 variétés de sarrasin[339], on fait généralement une différence entre les variétés dominantes dites « Silver » en anglais ou « Silber » en allemand, soit « argentées », procurant la couleur noire, et les variétés « tartare ». Bizarrement, les Néerlandais appellent la variété tartare « franse boekweit », sarrasin français. Dernière variété, le sarrasin « de Chine » qui serait, d’après certains auteurs, la seule facilement décorticable. Ces dernières variétés résistent encore mieux au froid et sont considérées comme les variétés originales voire comme des mauvaises herbes, c’est selon.
Ce qui différencie une variété tartare des blés noirs, c’est sa couleur châtain clair ou kaki donnant une couleur presque « habit militaire » à la pâte. Toutefois, le sarrasin tartare est considéré comme invasif en Bretagne, d’abord parce qu’il s’auto-féconde, il est autogame, alors que le sarrasin argenté attend, notamment des abeilles, une fécondation croisée.
Adam Maurizio écrit qu’il a vu en Galicie (Ukraine occidentale) bien des champs de sarrasin ordinaire si encombrés de sarrasin de Tartarie, qu’on pouvait se demander lequel des deux on avait voulu cultiver[340]. C’est clair, la variété tartare risque de coloniser les cultures d’année en année et d’autant qu’elle résiste bien au gel contrairement à la variété argentée.
Cette distinction entre variété argentée et tartare se révèle aussi dans les régions où on les cultive encore en Europe pour préserver une identité culturelle dans les deux sens du terme. Pour ces régions européennes qui cultivent un peu, mais résolument le sarrasin, on fait presque le tour des Alpes. Du bouriol d’Auvergne à toutes sortes de spécialités de l’adja, (« blé noir » en slovène), en passant par les crozets de Savoie, par les pizzocheri, la polenta et le sterz du sud de la Suisse, de la Carintie autrichienne et du Sud-Tyrol italien.
Voilà l’aire montagnarde du sarrasin. D’autres régions d’Europe le produisent également,
on a déjà parlé de la Russie, mais c’est aussi du fait d’une production spécifique ; les crêpes en Bretagne, un projet pilote de diversification agricole en ex-Allemagne de l’Est[341] ou de préservation de tradition dans l’Islek luxembourgeois. L’association Beogran, à Reuler au Grand-Duché du Luxembourg, distribue farine et graines de sarrasin tartare.
De toutes ces régions européennes, c’est en Slovénie que l’adja est le mieux reconnu et valorisé[342].
C’est à Ljubljana et à Tsukuba au Japon que se trouvent les banques de gènes des semences de sarrasin[343]. Celui que l’on considère comme le spécialiste mondial du sarrasin, Ivan Kreft, est professeur de biotechnologie à l’Université de Ljubljana et dirige une revue internationale (Fagopyrum) consacrée au sarrasin. Il fut appelé par les Japonais et permit la culture du sarrasin en Tasmanie (île au sud de l’Australie). Les Japonais recherchaient d’autres endroits que leurs étroites îles pour cultiver le sarrasin dont ils avaient besoin. Mais leurs variétés ne réussirent pas en Tasmanie. Une coopération avec l’équipe du professeur Kreft fut couronnée de succès après huit ans d’efforts. Quand l’île exporta sa première livraison au Japon, le Premier ministre tasmanien rendit hommage aux Slovènes[344].
La mouture du sarrasin pose un petit problème au meunier, surtout pour les réglages en mouture sur cylindres[345]. Sa forme pyramidale avec ses trois arêtes est bien différente des graines ovales et arrondies des céréales. Le décorticage passe par un pré-trempage de quatre heures en eau salée pour éliminer tout ce qui surnage. Puis on le cuit à la vapeur jusqu’à ce que l’enveloppe éclate sous les doigts. Après un séchage court au soleil, le grain est frotté et vanné. Les réglages sont difficiles sur cylindres et plus faciles sur meules. Le retrait de ses enveloppes sera nécessaire si on veut lui enlever de l’amertume. Comme sa balle a trois couches superposées, cela fera partie des difficultés de séparation et de mouture[346]. Résultat, un rendement en farine largement inférieur au froment, 10 à 25 % de moins. Alors que son rendement agricole est déjà faible, c’est-à-dire 0,8 à 1,4 quintaux l’hectare[347] dans les meilleurs des cas. Si les variétés argentées ont dominé dans les choix de semis et dans la sélection, c’est aussi parce que les variétés tartares ont un rendement encore moindre en farine[348]. Tout cela pourrait expliquer, chiffres rapides en tête, les raisons du déclin économique et le besoin de grande âme ou de nostalgie pour préserver sa culture[349].
Un autre trait de caractère (il n’en manque pas) est son identité gustative bien typée et facilement reconnaissable. Âpre, fortement ou légèrement amer (on l’augmente avec un taux d’extraction bas), au goût minéralisé, voire terreux. Dans les régions sauvages âpres à la culture et préservées par la même occasion dans leur aspect naturel, ce goût du sarrasin peut aisément rapprocher la nourriture de l’âme du pays. En Scandinavie, dans certains pains, c’est pour une alimentation plus saine qu’on le choisit[350].
Un pain plat croustillant comportant un tiers de farine de sarrasin est fabriqué en Norvège de manière traditionnelle[351]. Sa valeur gustative et nutritive se préserve mieux si on utilise la farine fraîchement moulue[352]. Les sels minéraux et oligo-éléments les mieux représentés par rapport au froment sont le potassium, le cuivre, le sélénium et le zinc, ce dernier du fait qu’il est deux fois plus assimilable que dans le froment (VII.10). Ces 10 à 20 % de protéines (suivant les variétés) sont absentes de gluten. On peut en tirer deux avantages. Le premier, une protéine de bon choix nutritionnel, comparable aux protéines de l’œuf[353]. Après l’orge, c’est le sarrasin qui est la meilleure graine étudiée ici dans la valeur nutritive de ses protéines (VII.7). Le deuxième avantage est le fait de permettre aux intolérants au gluten d’y trouver une matière première de choix.
Coté désavantages nutritifs, la présence d’inhibiteurs d’enzymes (des tanins), d’acide phytique et des substances colorantes issues des enveloppes qui peuvent créer des réactions. Tout cela nécessite une réflexion guidant vers une bonne fermentation de la part de toute personne préparant le sarrasin pour atténuer ces inconvénients.
On sait également que le levain de sarrasin est plus facilement contaminé par les moisissures, il nécessite des rafraîchis plus fréquents.
Ce n’est pas en panification que l’on va trouver le plus de valorisation du sarrasin. Si l’on se lance dans l’aventure quand même, il est utile de connaître l’expérience en la matière.
En France, le pain « floron » lancé à l’instigation de la fédération bretonne de la boulangerie peut ne contenir que 10 % de sarrasin. Grace à un pochoir, une découpe farinée du fleuron l’identifie.
Le Limousin a aussi un pain de sarrasin traditionnel[354]. Dans des boulangeries de renom de Paris, chez Éric Kayser, une baguette dite « paline » incorpore près de 35 % de farine de sarrasin[355], chez Frédéric Lalos, c’est 10 % de sarrasin en mélange à 10 % de seigle qui font la recette de son pain de sarrasin[356]. Les essais de panification allemande[357] proposent 20 à 30 % de farine de sarrasin à compléter par du froment de force selon eux.
Les Allemands, qui acceptent traditionnellement des mies de pain plus compactes, utilisent autant la semoule que le grain décortiqué qu’ils trempent ou ébouillantent préalablement. Ce qui améliore la structure et la conservation de la fraîcheur[358].
En Autriche, un « Bauernbrot » (pain fermier) au levain est composé de sarrasin, de froment, de mélasse et parfumé de graines de cumin. En Pologne, c’est du saindoux qui est ajouté au mélange froment/sarrasin[359].
Personnellement, je trouve agréable de m’adapter à l’identité technologique du sarrasin en panifiant des produits sur base de levain et généralement riches en croûte, une petite flûte comme un gressin ou une galette comme un petit pain plat scandinave, knackebrød, où je rajoute des noix, des noisettes broyées ou différentes sortes de graines.
En Europe, c’est en Slovénie que l’on incorpore le plus de sarrasin dans la pâte à pain[360]. Dans ce pays, ce sont les traditions alimentaires qui font produire les plus beaux pains de sarrasin. D’aspects festifs et rappelant le terroir dans son intimité familiale célébrée dans les fêtes de fin d’année, la description de pains slovènes va nous mettre le terroir à la bouche.
Le spécialiste Ivan Kreft donne la recette d’un pain à la levure composé à parts égales de farine de sarrasin et de farine de froment, auquel on ajoute 20 % de noix ou noisettes grillées au kilo de farine[361]. Il propose aussi un pain au sarrasin où trois abaisses de pâtes de couleurs différentes sont roulées l’une sur l’autre en boudin. Elles sont ensuite cuites sur un moule carré. Une pâte sera composée de farine blanche, l’autre de farine de sarrasin et la troisième de farine blanche de froment additionnée de farine de maïs.
X.13.1. Les quinoas.
On quitte encore la famille des céréales avec ces graines présentes sur l’Altiplano sud-américain.
C’est une graine qui pousse sur une plante de la famille des épinards (chénopodes).
Connue des civilisations incas dans les Andes, elle fut délaissée par les conquistadores espagnols et sauvegardée en culture de haute altitude dans l’Altiplano et près des lacs salés de la Cordillère des Andes. Certaines variétés sont même cultivées à 3 000 mètres d’altitude[362].
Dans la langue de l’endroit, le quechua, on l’appelle « chisiya mama », c’est-à-dire « mère de tous les grains[363] ». Elle est intéressante au niveau de sa teneur en protéines (16 à 18 %) avec même des pointes à 23 % dans certaines variétés. Toutefois, si ces protéines ont une bonne qualité nutritive, elles ne contiennent pas de gluten et pour cette raison le quinoa se consomme plutôt cuisiné comme le riz.
Dans notre époque de malbouffe, où le « sans » plutôt que le « avec » envahit nos critères de choix d’aliments, on se tourne vers de nouvelles graines qui n’ont pas encore leur réputation détériorée par une politique de rejet du plus petit aspect anti-nutritif.
Justement les éléments anti-nutritifs naturels, le quinoa en a deux dans sa composition, la saponine et l’acide phytique.
La saponine fait que le quinoa doit être lavé avant son utilisation alimentaire.
L’usage de l’eau de rinçage du quinoa comme eau savonnée pour la lessive est encore très fréquent en Bolivie et au Pérou par exemple. Des sélectionneurs ayant réussi à obtenir une variété sans saponine (la dulce) furent déçus que les agriculteurs sud-américains ne l’adoptent pas. Il faut dire que ceux-ci n’avaient aucune critique sur sa culture, mais comme les oiseaux que la saponine rebutait ont apprécié ces graines « sans savon », cela avait été beaucoup plus mangé sur pied !
En Amérique du Nord, Nestlé a investi pour créer de nouvelles variétés plus propices aux cultures intensives, avec de gros grains, de couleur uniforme et une teneur réduite en saponine[364], ce sont ces variétés dites dulce qui sont souvent choisies en Europe, lorsque certains se lancent dans la culture de quinoa.
L’acide phytique est présent en grande quantité et une étude de valorisation du quinoa en panification mettait en exergue le bienfait d’une longue fermentation au levain.
Au milieu des années 1970, le gouvernement bolivien avait obligé les boulangers de mettre 5 % de farine de quinoa dans le pain pour réduire d’autant les céréales importées. Les boulangers refusèrent et même certains firent grève.
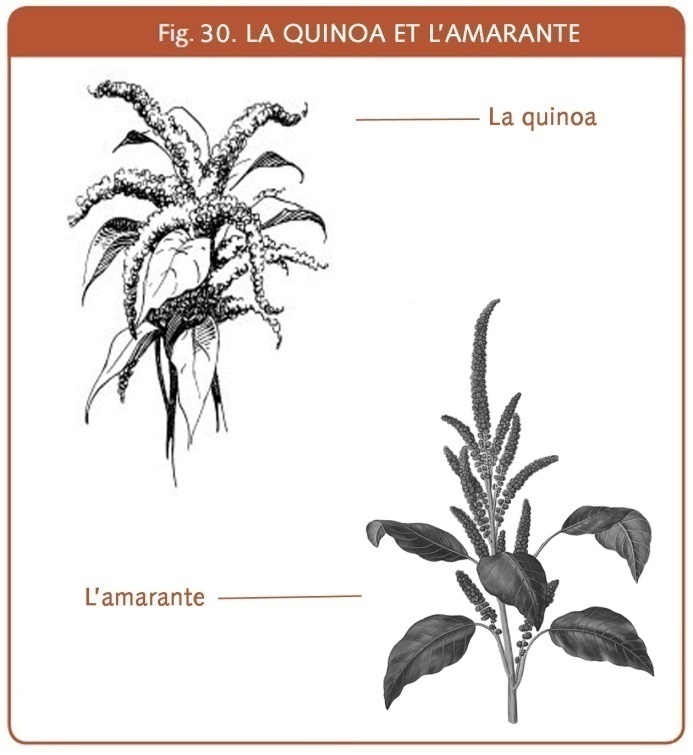
L’Anapqui est une association bolivienne de production qui commercialise en s’engageant dans la certification bio en 1997 puis en 2006 dans l’équitable[365].
Nous avons parlé de la qualité moussante du levain au quinoa sur l’action des sucres pentoses. Lors de l’élaboration de petites miches au quinoa de 65 grammes (appelées « pistolets » en Belgique), pour des petits déjeuners « commerce équitable », la recette s’effectuait avec un pré-trempage de farine et/ou de graines de quinoa avec la même quantité d’eau que de farine ou graines lavées accompagnées de 20 % de levain naturel et épicées légèrement de graines de coriandre fraîchement moulue. Après que cette préparation avait passé une nuit et pour ne pas trop ralentir la fermentation, ce n’est qu’après qu’on y ajoutais de la cannelle.
La confection de la pâte suivait avec un peu de sel et un faible ensemencement de levure à régler avec les quantités travaillées suivant le principe que l’effet de masse et une durée importante de fermentation permettent de réduire l’ensemencement.
X.13.2. Les amarantes
La marante, vous avez sûrement envie de travailler avec elle.
Bon ! C’est navrant, mais je vais plutôt vous narrer en professionnel les propriétés d’une plante intéressante que l’on voit de plus en plus dans les biscuits et même en panification.
Vous avez déjà probablement déjà vu l’amarante, que l’on confond parfois avec l’ambroisie ou l’armoise.
Dans le langage populaire, elle porte parfois le nom de « queue de renard » et entre jardiniers, on la considère facilement comme plante invasive.
Faisons un peu sa connaissance en remontant dans le temps. Par l’installation de l’agriculture dans l’industrialisation, les espèces à germination rapide, à forte rentabilité agronomique comme le blé, le maïs ou le riz seront privilégiées, car le marché n’a pas le temps d’attendre, il faut du rendement.
Constatant cela, un chercheur des U.s.a., John Robinson, fait un inventaire des plantes traditionnelles oubliées pour avoir dans le bol alimentaire un meilleur apport de nutriments par une plus grande diversification des cultures. C’est cela qui l’amène judicieusement à l’amarante et, pour promouvoir cette culture, il s’adresse aux chercheurs d’alternatives agricoles qui se regroupent autour d’un des pionniers de l’agriculture biologique aux États-Unis, Robert Rodale. Celui-ci effectua un travail de fondateur au niveau de l’agroécologie depuis les années 1970.
Pour comprendre pourquoi cette plante fut jetée aux oubliettes, il faut se remettre dans le contexte du xvie siècle, lors de la « découverte » de l’Amérique par l’Espagne, ce royaume très catholique qui entreprit de christianiser de force les peuples conquis. Or il se trouve que l’amarante était utilisée en farine de graines ébouillantées puis séchées, pour confectionner des figurines en pâte utilisées dans les rituels aztèques. Ce fut l’occasion d’une lutte féroce contre les cultes indigènes et de destruction des idoles, lieux et objets de culte catalogué comme païen. La culture de l’amarante fut interdite et les mesures de rétorsion de l’époque allaient jusqu’à couper les mains des indigènes qui cultivaient encore l’amarante, c’était une lutte religieuse, une des pires et des plus cruelles. Certains prêtres de l’époque, très « zélateurs des œuvres » se vantaient d’avoir détruit 20 000 idoles et 5 000 lieux de culte.
Aujourd’hui, en reconsidérant l’amarante, on jette parfois un autre regard sur l’histoire. Une ethnologue, Martine Pédron, peut vous apporter une approche historique plus valorisante de toutes ces plantes alimentaires venues d’Amérique[366].
Plus au sud en Amérique, chez les Incas et les civilisations des Andes, on fera de la bière avec le maïs (la chicha), mais aussi avec l’amarante, plante qui s’appelle en quechua « kiwicha ».
Pour parler plus technique, voyons maintenant comment l’amarante est utilisée, valorisée et transformée en alimentation.
La petite taille de la graine fait qu’on l’ébouillante et la broie de la même façon que le maïs (mais sans lait de chaux) puis on la réduit en farine pour faire notamment des tamales ou tortillas. On peut aussi l’utiliser en farine, non précuite si j’ose dire, ou en graines entières.
L’amarante ne possède pas de saponine ce qui lui donne un avantage vis-à-vis de l’autre pseudo-céréale sud-américaine, la quinoa.
Elle entre de plus en plus dans la confection de recherche de santé, car John Robinson, expert en nutrition de l’Université du Michigan qui a longuement étudié l’amarante au début des années 1970, en a conclu que c’était « l’une des trente espèces alimentaires offrant les plus grandes promesses pour l’amélioration de l’alimentation humaine ». Il ne s’était pas trompé au niveau de sa valeur alimentaire, plus de protéines, plus de sels minéraux et d’oligo-éléments (potassium, calcium, magnésium et phosphore). Ces protéines sont de meilleure qualité nutritionnelle, avec un coefficient d’efficacité protéique supérieur au blé de 25 %, l’amarante contient plus de lysine, un des acides aminé limitant des céréales.
Pour le pain, des essais allemands sur pains complets avec éclats de grains (schrot) ont montré[367] que l’introduction de 15 % ne cause pas de problème, 20 à 25 % panifié en moules (platines) est encore raisonnable et 40 % semble être le maximum aux yeux des chercheurs allemands en panification qui acceptent des mies denses. Ces essais montrent clairement que la farine tasse plus la mie alors que les graines, qui de par leur petite taille n’abaissent que peu le volume. Les graines ébouillantées semblent donner de bons résultats, ce qui confirme la tradition des natifs latino-américains qui ont le plus de vécu avec cette plante.
X.14. Les riz.
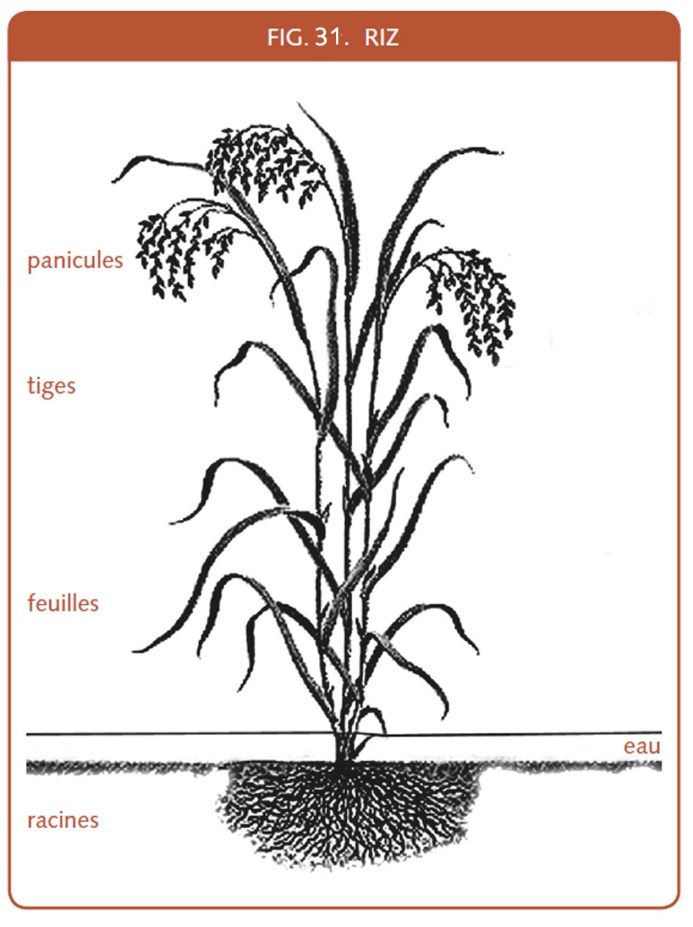
Nous voilà avec la céréale la plus cuisinée et la moins panifiée. Elle le devient un peu plus par la demande de pains sans gluten. Elle se marie alors souvent à la farine de sarrasin qui, dans le mélange, modérera le côté fade de cette farine de riz blanc. Il faut dire que la poudreuse blanche de riz est proche de l’insipide, en quelque sorte, elle « dilue » le goût.
L’ancêtre commun à tous les riz sauvages ou primitif est asiatique. « Un rhizome et de grosses racines contenant des réserves nutritives lui permette de » revivre » chaque année à partir de ses organes souterrains »[368]. C’est alors une plante vivace, elle repousse si on la coupe à la tige.
Il y a deux à trois millions d’années, avec le geste agricole qui modifie la plante riz (fig.31), elle n’a plus ces capacités dans son rhizome.
Elle ne vit qu’une saison, ce qui nécessite un repiquage annuel des plants issus d’un pépinière ensemencée[369]. Sous certains climats, elle peut donner deux récoltes sur l’année, ce qu’une révolution agricole bien conduite lors du règne de la dynastie Song au xie siècle a permit[370].
Comme pour le blé et le maïs, le riz va vivre des mutations lors de sa longue domestication avec les paysans qui repèrent les désavantages et avantages de certaines formes de vie de la plante. On peut chiffrer à 8 000 ans le temps de cet apprivoisement, où l’on ne va pas garder l’égrenage spontané, mais conserver l’aspect non décorticable, passer, par le blutage, de la couleur brune à blanche et repiquer les plants près des habitations dans des rizières. Plante tropicale et de pays de mousson, le riz ne supporte pas bien des températures de l’eau inférieure à 14 °C.
Le riz dit d’agriculture pluviale est cultivé plus au sec et ne représente que 12 % des récoltes mondiales. On le cultive principalement en Afrique de l’Ouest[371] où il a été adopté depuis 3.500 ans dans le delta du Niger.
Les formes de culture irriguées et inondées du riz sont une tout autre pratique agricole qui doit conjuguer la présence sur la terre, de l’eau et de la chaleur (fig.31). C’est un autre écosystème où tantôt l’irrigation, tantôt le drainage et le curage pour entretenir les canaux, permet un minutieux partage de l’eau, captée dans des parcelles entourées de bourrelets de terre. C’est pourquoi il est difficile ici de s’étendre plus sur le sujet.
Contentons-nous de repérer les riz qui seraient le plus intéressants à entrer dans la panification. On connait tous le riz cuit dans une atmosphère hermétique, dénommé : riz incollable, (à consommer en période d’examen ;-)), qui est du riz indica étuvé. Les promoteurs de pains au riz de la boulangerie sans gluten à Paris ont versé leur dévolu sur un riz propre au risotto (plutôt mi long) cultivé dans la plaine du Pô[372] dont l’irrigation fut dessinée par le génial Léonard De Vinci et encore admirée en 1926 par Vavilov[373]. La réflexion sur la structure de l’amidon de riz peut amener à préférer le riz, plus coûteux parce moins rentable à l’hectare, et dit à tort glutineux. Appellation fallacieuse puisque ce riz ne contient pas de gluten. Il devrait s’appeler riz gluant, riz collant ou riz cireux, waxy en anglais. Celui-ci comporte une teneur en amylopectine assez dominante. Ce riz collant est un riz japonica qui permet de confectionner les sushis. Au pays du Soleil levant, il existe une large palette de goût que l’on attribue à la qualité de l’eau. Un des riz collants les plus appréciés – le Kohihikari – atteint les 28 euros au kilo[374].
Le riz subira une uniformatisation en nivelant, comme souvent, la qualité gustative et nutritionnelle par le bas. Cela enclenchera de nos jours une recherche de biodiversité et quelquefois un retour vers des riz complets, dits cargo – avec les enveloppes (son). Le riz paddy étant celui qui a encore son indigeste balle paillée qu’il faut décortiquer.
Si l’on se penche sur l’aspect goût, on pense aux riz dits parfumés, pour les plus connus, le basmati indien ou le jasmin thaïlandais, dans leurs versions originales, révélateur de terroir. Pour les aspects nutritifs, les riz noirs, pourpres ou rouges plus riches en vitamines et oligo-éléments peuvent prendre de l’importance. Du même coup, consommés complet, ils permettent de lutter contre la maladie du béri-béri (qui signifie, « je ne peux pas, je ne peux pas » en singhalais), du fait que les symptômes de cette carence sont la fatigue et des troubles nerveux. C’est en introduisant le riz consommé blanc que cette maladie apparut. Ce dont Christiaan Eijkman s’aperçut en expérimentant sur les poules en 1894 et que le japonais Takaki Kanehiro avait observé 10 ans[375] avant le hollandais basé à Djakarta (ex-Batavia).
L’hybridation et l’intrusion de la génétique sont de plus en plus à l’ordre du jour, surtout en Chine qui a l’initiative sur les aspects de variétés semi-naines à plus grande rentabilité. Le chercheur chinois Yuan Longping va créer le riz hybride en 1973 qui va par la suite tripler le rendement des rizières, aidé en cela par une armada de soins de produits dits phytosanitaires qui seront remis en question. Là aussi la recherche s’intéresse aux 140.000 variétés traditionnelles aux gènes inédits et les sortent des congélateurs[376]
Le riz doré dont on a parlé (III.11) est aujourd’hui retravaillé par l’Irri, le centre de recherche mondial sur le riz installé aux Philippines et présente des teneurs en provitamine A, plus de 20 fois supérieur au premier riz doré[377], il faut savoir que le riz est au naturel très faible en teneurs de pro-vitamine A, luttant contre le rachitisme.
Dans les tests de méthode de panification du riz en Allemagne[378], on remarque que l’ébouillantage présente un petit avantage de volume et surtout de conservation du pain cuit.
X.15. Les racines (patates, manioc,…)
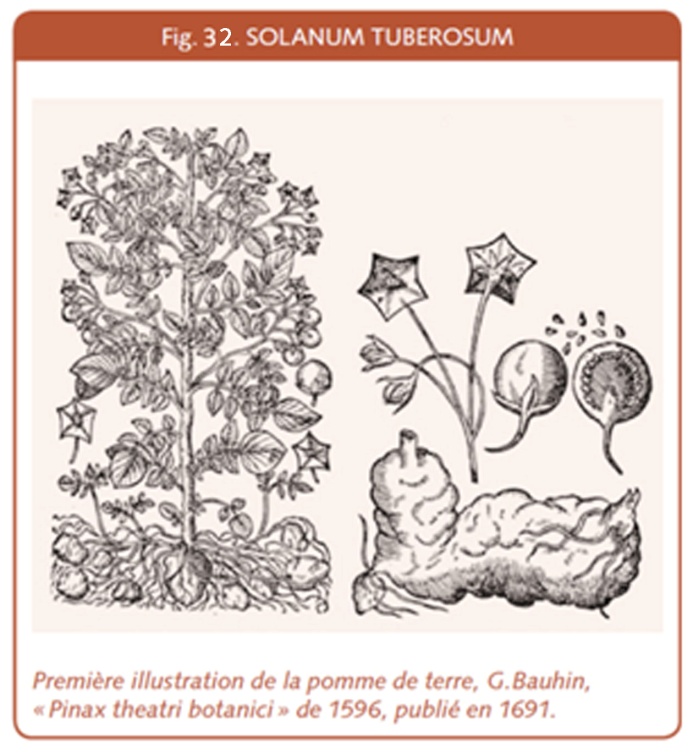
Antoine – Augustin Parmentier a son nom trop lié à la pomme de terre (fig.32), certains en France appelleront même ce légume-racine « la parmentière ».
Cette amplification vient d’auteurs vouant une cascade d’éloges au chercheur qu’a été Antoine Parmentier.
En fait les « ajes » – peut être des topinambours – comme les appelait Christophe Colomb (1451-1506) qui les a importés en premier, sont connues bien avant le xviiie siècle, dès 1601, notamment par Charles de l’Écluse (1526-1609) né à Arras, en Picardie, qui les mentionne et Olivier de Serres qui, dans son domaine de Pradel en Ardèche, décrit des « cartoufles » – peut-être aussi des topinambours.
Grace à la bibliographie que lui consacre Anne Muratori-Philip, nous allons en apprendre plus sur Parmentier[379]. C’est en Picardie, à Montdidier, qu’Antoine-Augustin Parmentier est né le 12 août 1737.
Dès ses quatorze ans, il deviendra commis chez l’apothicaire de cette ville. Cinq ans plus tard, c’est à Paris qu’il approfondit la science des remèdes, puis un an après (en 1758), il s’engage à l’armée comme pharmacien. Un vécu dans la guerre de 7 ans en Saxe contre la Prusse le fera prisonnier à cinq reprises. À l’époque, on libère en premier les pharmaciens-brancardiers, par échange de détenus. On écrit souvent que c’est là, du côté d’Hanovre que le picard découvre la « kartoffel », un nom dérivé du latin signifiant « petite truffe » qui donnera tartoufle ou cartoufle dans certaines langues.
De retour en France, c’est à l’Hôtel Royal des Invalides (édifié en 1670 par Louis XIV), que Parmentier sera actif en 1766 en étant le premier à obtenir par concours, la place de pharmacien grâce à l’application d’une maxime d’un administrateur intègre (Chamousset): « Rien à la faveur, tout au mérite ».
Il ne quittera « les invalides », qu’en pleine révolution (1792). Une ville dans la ville cette institution, 3 000 invalides de guerre et 500 personnes à leur service.
Dans un monde qui n’a de cesse d’explorer (c’est l’époque de l’encyclopédie), les recherches sont suscitées par l’État et Parmentier est au service de celui-ci.
Assez vite il oriente ses recherches, qui « n’ont d’autre but que le progrès de l’art et le bien général. La nourriture du peuple est ma sollicitude, mon vœu c’est d’en améliorer la qualité et d’en diminuer le prix. » Lors du retour à Montdidier au décès de sa mère (1776), le temps de mettre de l’ordre dans la succession, il approfondit l’art de faire du pain, même de pomme de terre. à moins de 25 kilomètres de Montdidier, la famille Dottin cultivait déjà en 1766, la pomme de terre à Villers le Bretonneux[380].
En 1777, il publie Avis aux bonnes ménagères des villes et des campagnes sur la meilleure manière de faire le pain[381], et un an plus tard, plus professionnel Le parfait boulanger ou traité complet sur la fabrication et le commerce du pain. Ces deux derniers livres auront beaucoup de succès.
Ce qui l’autorisera dans la foulée en 1780, à ouvrir, rue de la Truanderie près des halles, l’école de la Boulangerie en compagnie de son ami de toujours, aussi altruiste que lui, Antoine Alexis Cadet de Vaux. Encore un an plus tard, en 1779, il écrit pratiquement un plaidoyer « afin d’enrichir la liste des subsistances » dans une publication où il veut convertir « ces racines en pain » sans mélange de farine[382].
Cadet de Vaux, orphelin de père à 2 ans, fut confié à une famille de boulangers de Vaux sur Seine, d’où Cadet de Vaux. Ce dernier prit un peu plus en charge que Parmentier les cours pratiques avec l’intendant Jean-Baptiste Brocq, responsable boulanger de l’Hôtel Royal des Invalides avec qui Parmentier passa des centaines d’heures d’observation.
Les recherches d’A.A. Parmentier s’orientèrent assez fort vers la culture des pommes de terre et pas seulement en substitution du blé, mais aussi en l’intégrant dans des process de panification[383]. Il accueillera Benjamin Franklin (un des pères fondateurs des États-Unis d’Amérique en poste diplomatique à Paris) à qui il a montré ces diverses réalisations avec les pommes de terre[384].
Il fabrique même des gâteaux de pomme de terre qui intriguèrent les pâtissiers de Paris. Ceux-ci lui demandèrent son secret moyennant finance. Amusé, Parmentier donna la recette sans contrepartie et les pâtissiers de s’exclamer « Cet homme-là ne sera jamais riche, il n’entend point ses intérêts. » Il déclarera également : « je ne suis dans aucune entreprise et ne fais aucun commerce ; je ne sollicite ni place, ni pension ; je n’ai point d’hypothèse à établir ou a défendre ; … ». Ce qui lui permettra de rester en poste malgré « les orages de la révolution », il parcourra ce qui est devenu les divers départements français et entreprit également beaucoup d’écrits sur le maïs. Ses derniers travaux se focalisant sur le sucre de raisin comme substitut du sucre de canne n’aboutiront pas, il sera déçu par le pouvoir, Napoléon préférant les travaux de Benjamin Delessert et le sucre venant de la betterave.
Sur les 189 travaux que Parmentier a publiés, 46 sont dédiés à la filière pain.
On le dira pour la postérité, précurseur de la chimie alimentaire, de la bromatologie (science de l’analyse des aliments), de l’agrobiologie, de l’œnologie (l’art et la connaissance du vin) et de l’ampélographie (discipline étudiant la vigne), de l’hygiène alimentaire. On le traitera plus simplement d’humaniste.
Voici ses recettes de pain à la pomme de terre qui sont toujours valable de nos jours, ou les fécules et flocons ne donneront pas le même résultat que la purée de pomme de terre bien cuite. D’abord les recettes extraites des livres[385] de 1777 et 1778 : « Prenez la quantité que vous voudrez employer de pomme de terre, faites-les cuire dans l’eau, ôtez-en la peau, écrasez-la ensuite avec un rouleau de bois de manière a ce qu’il ne reste aucun grumeau et qu’il en résulte une pâte unie, tenace et visqueuse. Ajoutez à cette pâte le levain préparé la veille, suivant la méthode qui a été déjà exposée et toute la farine destinée à rentrer dans la pâte en sorte qu’il ait moitié pulpe de pomme de terre et moitié farine. Pétrissez bien le tout avec l’eau nécessaire. Quand la pâte est suffisamment apprêtée, enfournez-la en observant que le four ne soit pas autant chauffé que de coutume, de ne pas fermer aussitôt la porte et d’y laisser cuire plus longtemps sans cela l’intérieur sera humide et pas assez cuit ».
« Plusieurs expériences, faites successivement et en différents endroits, se réunissent à prouver que l’on doit mettre 8 livres de pommes de terre sur 9 de farine.
On jette les pommes de terre dans l’eau, on leur fait faire quelques bouillons sur le feu jusqu’à ce qu’elles se pèlent aisément. On les en tire, on les pèle & on les met dans un chaudron avec une quantité d’eau suffisante pour les bien cuire & les réduire en purée. On les remue bien pendant la cuisson pour les empêcher de bruler, lorsque la purée parait cuite, on la passe dans un passe-pois, afin d’écraser tout ce qui pourrait ne l’avoir point été pendant la cuisson. Plus la purée est épaisse, moins il entre de farine : ainsi on y mettra le moins d’eau que l’on pourra. La purée étant ainsi passée, on la tient chaudement, on y ajoute la farine et le levain et on pétrit la pâte à force de bras, sans quoi le pain est attachant, et il ne vaut rien. On chauffe le four un peu plus qu’à l’ordinaire & surtout il faut avoir attention de ne pas faire les pains que de 7 à 8 livres de poids. Lorsqu’ils sont plus grands, le milieu du pain cuit difficilement, et la croute se détache. Cette nature de pain est meilleure lorsqu’il est attendu plusieurs jours. Tout chaud, il est toujours un peu collant & n’est pas aussi bon. D’ailleurs, il est probable qu’à l’égard de ce pain, sa bonté dépend beaucoup de la façon de le faire et de l’intelligence de celui qui le fait. On éprouve la même différence pour celui de pur froment. Il ne faut utiliser que du blé qui soit bien sec. La farine humide se lie difficilement avec les pommes de terre ».
Dans le livre de 1779 plus spécifiquement dédié au pain de pomme de terre sans ajout de farines[386], il développe une recette, 100 % patates plus complexe à réaliser où la moitié de la pâte est composée de la pulpe cuite et réduite en purée sans grumeaux. Celle-ci est liée grâce à l’autre moitié composée de l’amidon de pomme de terre. Enfin le tout fermenté à l’aide d’un levain confectionné de pomme de terre également.
A l’époque, pour obtenir l’amidon de pomme de terre, le procédé est fastidieux. Il extrait en passant par la râpe puis laisse tremper ces fines tranches dans l’eau, les presse pour en extraire le jus. Il laisse ensuite décanter celui-ci pour séparer l’amidon de l’eau, puis finit par le séchage de cette masse obtenue. Avec l’amidon de pomme de terre, nous avons la moitié des ingrédients qui seront issue de pommes de terre rondes, grises et farineuses, les variétés rouges ont, dit-il, plus de viscosité et conviennent mieux pour l’autre moitié des ingrédients où la racine sera réduite en purée. Il faut dire que Parmentier disposait à l’époque d’une collection de pommes de terre importées du Nouveau-Monde et que l’académie d’agriculture transmettra après sa mort en 1813, cette collection au fils de son ami, Philippe-André de Vilmorin[387].
Pour composer le levain de pomme de terre, on prend 250 gr. d’amidon de pomme de terre, et 250 gr. de purée et y mélange 125 gr. d’eau chaude, laisse reposer pendant 48 heures, on renouvelle cette opération chaque jour et ce pendant 6 jours pour obtenir un levain qui puisse agir comme un levain-chef.
Dans les remarques écrites par Parmentier, il précise que ce levain-chef n’acquiert au bout des 6 jours qu’une activité faible et qu’elle obtient sa pleine maturité qu’après plusieurs panifications avec ce levain-chef, que l’on retire à chaque journée de panification de la pâte du jour avant de la cuire.
Pour faire la pâte, on la réalise sur deux rafraîchis, un le soir et le second le matin suivant, et il faut que le deuxième levain prenne la moitié de la pâte avec une hydratation d’à peine 20 %, vu la viscosité de la purée contenant encore beaucoup d’eau. À cause de la fadeur des pommes de terre épluchées, et par le fait que « la fermentation ne relève pas suffisamment » le goût, Parmentier ajoute ± 4 grammes au kilo d’amidon, de sel, (0,4 %) ce qui est assez semblable que pour le pain de froment tamisé à son époque ou l’on salait nettement moins. Il vaut mieux dit-il, utiliser l’incorporation de la purée « proche de l’état bouillant », « ce qui concourt à sa formation ». À peine finie d’être pétrie, on divise la pâte et la met en pannetons bien farinés.
On laisse alors fermenter bien couvert pendant 6 heures, car « il faut deux fois plus de temps que le froment ». Le pain de pomme de terre « demande une fermentation et une cuisson lente »
L’apprêt idéal de la pâte de pomme de terre est dit par l’auteur « lent et peu avancé », en prenant soin de maintenir une croute molle.
On doit observer à l’apprêt, « un gonflement, des petites crevasses et un peu d’élasticité à la superficie ». Au final « le pain de pomme de terre a un goût herbacé et sauvage » qui lui appartient.
Monsieur le Chevalier Mustel qui est pour Parmentier « le premier apôtre des pommes de terre en France » le renseignait sur deux qualités exceptionnelles du pain de pomme de terre, qui gardait après un voyage en mer de dix mois, une certaine fraicheur et était encore consommable. L’autre qualité est que si on en met pour moitié dans les pains d’orge, de sarrasin et de maïs, « le pain est plus blanc, moins rude et plus sain[388] ».
Un ardéchois, Monsieur Mouline a lancé en 1892, un pain de patate toastée. Après avoir épluché puis pressé de leur eau, la pulpe de pomme de terre, il fait torréfié celle-ci au four. Elle ira de cette façon jusqu’à blondir. En l’incorporant à raison de 50%, il obtenait un pain dit « très digeste » et qui a eu son succès[389]
Une idée de Patrick, normand et inventif, pour décorer les pains de patate, des pommes de terre râpée ou en fines lamelles sur la croûte.
Pour continuer sur un registre proche, évoquons le pain Kriegs und Kartoffel brot, soit, pain de guerre à la pomme de terre, largement prononcé en français plutôt qu’écrit : pain K.K..
Voici la recette de pain de la guerre allemand de 1914-18. Pour 10 pains avec 20 livres de farine et 20 livres de pommes de terre épluchées et cuites.
Un article de la page du journal du « Jauer » généreusement envoyé par M. Jean-Claude Vermeire nous annonce une nouvelle recette pour la préparation d’un pain de guerre qui, partout où elle a été utilisée, n’a donné que des satisfactions. Il faut pratiquer comme suit. « Mélanger et pétrir 4 livres de levain naturel avec 6 litres d’eau chaude et environ 5 livres d’une farine de seigle.
Parsemer sur le dessus un peu de farine et laisser le pâton dans un endroit bien chauffé par un poêle jusqu’au lendemain matin pour que la pâte pousse. Bien fermer la pièce où est la pâte.
Le lendemain matin, verser sur cette pâte 20 livres de pommes de terre que l’on a cuites et épluchées la veille et ensuite écrasées ou râpées.
Environ 13 livres de farine locale pesées par-dessus. Verser environ ½ litre d’eau chaude, éventuellement un peu de farine, la pâte ne doit pas être trop molle sinon elle colle. On peut mettre volontiers du sel et 4 cuillères à soupe de cumin. On pétrit avec les mains environ ¾ d’heure jusqu’à ce que la pâte se décolle.
Fleurer celle-ci avec de la farine couvrir et laisser pousser au coin du poêle pendant 2 heures.
Entre-temps, on prépare une grande planche préalablement fleurée à la farine.
Ensuite, on coupe à l’aide d’une assiette métallique des pâtons de la grosseur d’une assiette à moitié pleine. Sur la planche farinée, façonner les pâtons en formes de boule. Si la pâte se déchire avec des plis sur le dessus, repétrir de façon à ce que la surface soit lisse.
Toujours avoir de la farine sur la planche ainsi la pâte ne colle pas. Quand la pâte est lisse sur le dessus, déposez-la dans les plats, placez au chaud ½ heure et laissez pousser.
Alors, badigeonner les boules avec de l’eau chaude et les enfourner, le four doit être chauffé de manière appropriée.
On calcule 2 livres de farine par pain, sitôt que l’on a utilisé 20 livres de farine. 20 livres de pommes de terre cuites et épluchées = 24 livres = 131 grosses pommes de terre crues et non épluchées ». La recette a été traduite pour le Crebesc par le Compagnon pâtissier Jean-Christophe Duc, Bourguignon la confiance, en Allemagne depuis de nombreuses années.
Il faut soigner la cuisson du pain qui est difficile puisque les parties d’amidon déjà gélifiées auront du mal à extraire l’eau contenue, ce qui donne par la même occasion, une meilleure teneur en humidité du pain sur la longueur, mais avec risques d’attaques de moisissures.
Il faut plutôt choisir des pommes de terre farineuses que les pommes de terre fermes et comme il y a beaucoup de sortes et espèces, signalons que la patate douce (Ipomoea batatas) passe bien aussi dans les mélanges avec le blé, apportant couleur jaune et saveur sucrée.
Selon les cas, l’avantage ou désavantage, que l’on trouve dans l’apport de féculent venant des racines, est le faible apport de protéines, (1 % à 2 %) et la grande teneur en eau, (65 % à 75 %).
Une précaution, ces légumes racines peuvent produire des toxines. Pour la pomme de terre, on pense à la solanine. C’est inoffensif à faible dose pour l’humain, mais peut entrainer des problèmes neurologiques, pas au point d’être mortel et que si l’on en consomme en excès. De toute façon, les pommes de terre vertes et dures à l’intérieur sont à éliminer pour le goût. Ce sont de mauvaises conditions de stockage, ainsi que des délais trop longs entre les opérations d’épluchage, de tranchage et de cuisson, qui sont très favorables à la synthèse de la solanine.
Le pain de cassave (appellation utilisée pour le pain à la farine de manioc) est bien détaillé au xviiie siècle par Malouin[390] et cité par Parmentier[391]. On peut toutefois se poser la question s’il est vraiment un pain ou une galette ?
Le manioc (fig.33) vient aussi du Nouveau Continent, où il est parfois dénommé « Yuca », et s’adaptera bien en Afrique.
Pour le manioc il faut éviter l’acide cyanhydrique dit aussi cyanure d’hydrogène ou acide prussique. Cette racine peut en contenir de manière naturelle. Si l’on évite les insecticides et rodenticides qui contiennent du cyanure, il faut d’autant plus s’abstenir d’en produire, puisque même naturel, c’est un liquide qui a un point d’ébullition bas (+ de 26,5 °C), et est très volatil, incolore et inflammable. Son odeur caractéristique d’amandes amères (qui en contiennent aussi) est bien connue, mais 20 à 40 % de la population sont insensibles à cette odeur.
Il faut dès lors privilégier l’emploi du manioc doux à peau fine, chaire blanche et feuilles vert clair et tiges entièrement vertes. Il faudra éviter le manioc amer à peau plus épaisse, au point de donner des difficultés d’épluchage, à chaire un peu rosée devenant jaune à la cuisson, à feuilles plus étroites vertes foncées et tiges rouges. Ensuite n’utiliser cette farine qu’après épluchage, ébouillantage ou rouissage et fermentation. Il est clair que ces informations peuvent et même doivent inquiéter. Pourvu qu’on le dise et vive positivement en allant vers la quiétude. Nous aurions moins d’appréhension, si autour et proche de nous une foule de personnes qui les utilisent sans crainte serait présente et existait toute une culture reçue depuis des temps immémoriaux sur ces graines ou racines qui nous sont étrangères. Testé sur des siècles de vécu, ce qui peut être parfois être d’un bon apport à l’analyse experte afin de ne pas nous prendre pour des cobayes[392].
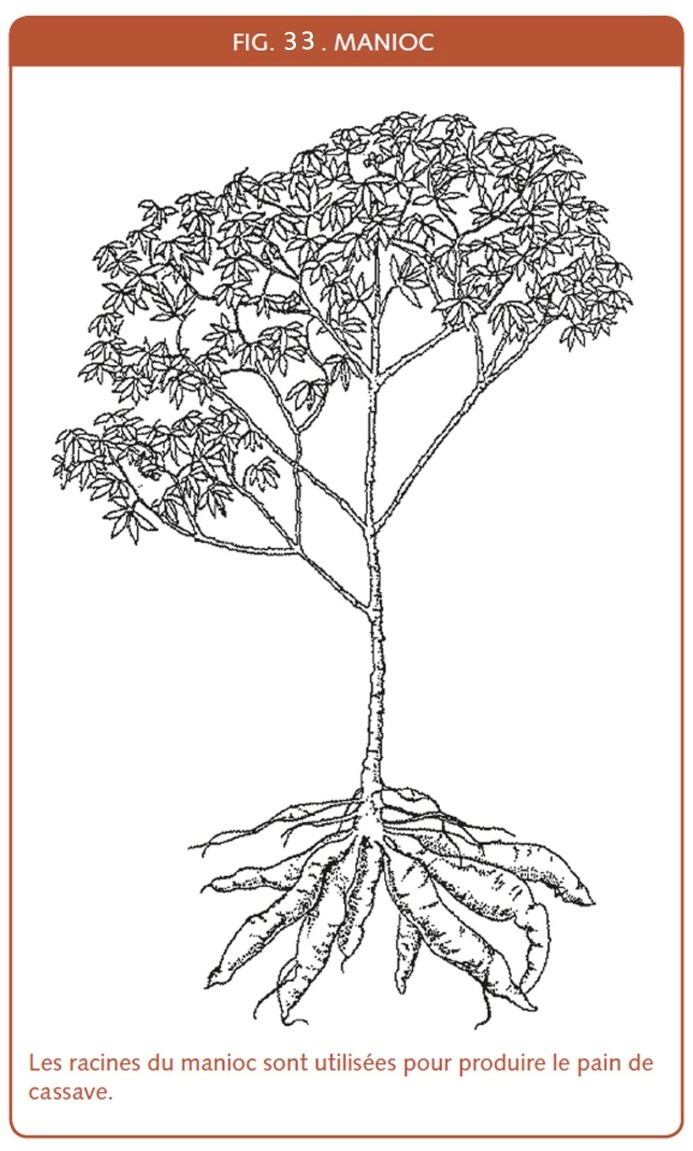
Le pain de manioc a été en 2015, l’objet d’une attention toute particulière de l’état nigérian, avec un aide financière conséquente pour former les boulangers à la panification du manioc, pour favoriser l’agriculture nigérianne et surtout faire baisser l’importation de farine de blé qui pèse sur la balance commerciale de l’état fédéral du Nigéria. En 2018, l’association des boulangers finançant en partie l’initiative par l’imposition d’une taxe, dénonçait l’échec du Fonds de développement du pain de manioc (Fcdc)- Cassava Bread Development Fund et appelait à l’arrêt de l’initiative[393].
Autres tubercules, les ignames sont pratiquement des frères des manioc et pomme de terre.
Leur composition est voisine de celle des amidons de racine : environ 25 % d’amidon (du total, humidité comprise), mais un peu plus de protéines (environ 7 %, quatre fois plus que le manioc). Ils sont très pauvres en matières grasses et en minéraux, et assez riches en vitamine C. Cette plante a été découverte par Christophe Colomb alors qu’il faisait escale à Cuba. L’igname n’a pas réellement de terre d’origine. Par contre, ses terres d’adoption sont nombreuses, Inde, Afrique… Sur 600 variétés d’ignames, 6 seulement sont comestibles. La plus populaire, l’igname blanche, représente 90 % de la production. Les feuilles de l’igname poussent comme un haricot grimpant, longue liane qui s’enroule autour de rames. La racine tubéreuse et comestible est récoltée après plusieurs années de développement. Ce légume présente une peau dure, épaisse et légèrement velue ou rugueuse[394]. En l’épluchant, évitez que l’igname soit en contact avec votre peau, au risque de démangeaisons. Sa chair est farineuse, un peu sèche, au goût douceâtre.
J’en connais qui l’ont employé en panification, pour démarrer un nouveau levain-chef puisque comme le seigle qui fermente plus vite que le froment, ici dans les fécules issues de racines, cela semble être plus performant encore avec l’igname de Chine. C’est celle qui portera le nom de « licht yam » en allemand, soit « racine de lumière » puisque régulièrement employée par les biodynamistes en aide pour starter la fermentation.
Il nous faut le sécher pour bien le conserver ce levain d’igname.
Il n’est pas interdit de penser que le topinambour aurait aussi de bons offices de ce côté-là, mais que c’est difficile à éplucher ce tubercule !
X.16. Les Sojas et autres légumineuses
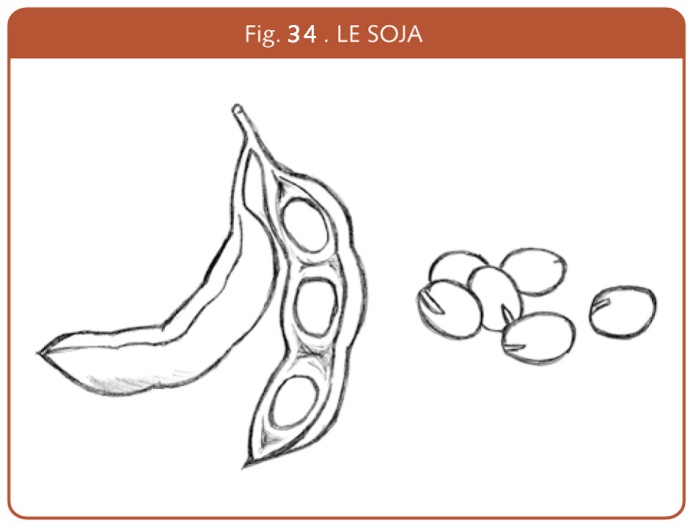
Ici on passe de la quasi-absence de protéines avec les féculents-racines, à la pléthore de protéines des légumineuses, mais pas gluten pour deux sous. On passe aussi d’un savoir-faire américain et africain à un savoir-faire d’extrême-Orient. De toutes les légumineuses, le soja (fig.34) est celle qui a la meilleure réputation dans sa faculté de capter l’azote de l’air afin de le fixer en protéines dans la plante grâce aux nodosités porteuses de son petit monde racinaire qui transfèrent les éléments atmosphérique dans la plante (fig.4 dans V).
Quand on parle pain et légumineuses entre praticiens de la pâte, souvent on ne pense soja qu’en termes de lécithine et on ne pense farine de fèves qu’en termes d’adjuvant également. La farine de fève ne peut être ajoutée à la farine pour faire du pain dit de blé tendre qu’en raison de 2 %, et la farine de soja ne peut dépasser les 0,5 %[395]. Est-ce à dire que l’on ne peut pas mettre plus de soja pour faire du pain plus protéiné ? Non ! Mais alors de quoi s’agit-il ? Tout simplement l’ajout d’une farine de légumineuses a été très fréquent dans les années 1960 et en même temps le pétrissage intensif sévissait pour obtenir un pain bien blanc et bien développé. Fini les périodes de pain noir lié à la guerre, bonjour le pain plus blanc que blanc, signe de délivrance face aux contraintes alimentaires et de rationnement. Seulement, voilà, ce type de pain blanc n’a pas été le meilleur en termes de goût. Et l’on s’est assez vite interrogé sur le pourquoi de ce goût fade et dénaturé. Se penchant sur le problème de ce type de pain, plusieurs chercheurs remarqueront que l’intensification du pétrissage effectué avec des ajouts de farine de fève oxydait beaucoup la pâte, puisque les farines de légumineuses ont une grande teneur en enzyme oxydante (la lipoxygénase). La farine de fèves en contient cent fois plus que la farine de blé et la farine de soja trois fois plus que la farine de fèves.
| fig.35. Compositions des farines de soja et de fève | ||
| Farine de soja | Farine de fève | |
| Protides / M.S. ( N X 6,25) | 42-44 % | 34 % |
| Lipides / M.S. | 22-24 % | 1,5 % |
| Glucides | 22-25 % | 60 % |
| Cellulose | 2,5-3 % | 1 % |
| Matières minérales | 5 % | 3,5 % |
| Activité lipoxygénase (ULPX/g *) | 400-500 | 150-200 |
| *Unité de l’activité enzymatique de la LiPoXygénase (LPX en abrégé). | ||
| D’après ROUSSEL, 1998 a. | ||
Cette enzyme va entrainer des réactions oxydantes surtout avec l’apport d’oxygène généré par le pétrissage rapide et long[396].
La formation de gaz dit hexanal est alors dénoncée et l’on a réagi avec des pieds de plomb de la part des meuniers et des fournisseurs de matériels et d’ingrédients face à ces critiques.
Néanmoins, la farine de fèves à raison de 2 % verra son emploi en boulangerie diminuer progressivement dans les décades qui suivront[397] avec comme étendard de cette campagne anti-farine de fève, les propos du professeur Calvel.
On est avec ces éclairages plutôt dans un mauvais usage technologique que dans une évaluation nutritive.
La lécithine de soja agit plus comme comme émulsifiant dans la pâte.
L’extraction de la lécithine du soja se réalise par des solvants ; elle est purifié par des précipitations à l’aide de sels[398] et malheureusement les choix industriels vont vers des auxiliaires technologiques les plus rentables en rendement et pas forcément en relevant le côté nutritif. C’est la valeur protéique qui sera recherchée dans le soja, traité de viande ou lait végétal, lorsqu’il se mêle de se substituer utilement à ces aliments carnés.
Au niveau variétal, ce sera l’acclimatation de cet « or jaune de Mandchourie » qui fera que les choix se porteront sur des variétés précoces plutôt que tardives en Europe et Amérique du Nord[399] et aussi de variétés avec des tiges à hauteur facilement récoltables mécaniquement.
Comme le soja est dans les plantes les plus cultivées, il intéressera les entreprises de l’industrie alimentaire, d’où une difficulté de séparer le soja OGM (70 % du marché[400]), avec le soja non OGM. C’est généralement la résistance à l’herbicide, par exemple Roundup ready ( Rr ) qui est intégrée dans les gènes.
Pour la panification, je pense que la forte teneur en acide phytique du soja nécessite une bonne fermentation au levain.
On se sent confirmé dans ce choix de longue fermentation au vu de l’emploi que l’on a du soja en Extrême-Orient. Les produits alimentaires traditionnels asiatiques qui en dérivent sont tous fermentés, la sauce shoyu a 45 h. de fermentation pour le koji, qui sera suivi de salage, maturation à l’aide de bacilles et levures puis pressage. Le tempeh subit 24 h. de maturation après ensemencement de moisissures appropriées. Le tofu est un lent caillage du lait de soja avec le ferment local. Enfin le miso vit une fermentation de quelques semaines minimum jusqu’à trois ans.
La farine de soja contient aussi une purine (la trypsine), un élément anti-nutritionnel naturel, qui sera neutralisée thermiquement. Un léger grillage ou toastage suffit pour l’éliminer[401]. Mais pour une bonne valeur nutritionnelle, il faut favoriser, vu la haute teneur d’excellents lipides (17 à 20 %), une bonne conservation, en tout cas éviter la baisse de la valeur nutritionnelle par la délipidation de la farine. En effet, la farine de soja pouvant provenir soit, de la graine moulue, soit, de la mouture du résidu tourteau résultant de l’extraction de l’huile.
La graine bien nettoyée devra être décortiquée à sec puis moulue pour donner une farine jaune clair. La mouture en mélange avec d’autres légumineuses ou le maïs peut également se pratiquer. C’est de préférence le soja jaune qui passe au moulin. Le procédé de l’agronome français Rouest allait jusqu’à tremper la graine de soja pendant 36 heures jusqu’au début de germination puis sécher sans grillage prononcé. Ce procédé lui permettait de conserver la farine sans rancir pendant plusieurs mois.
Une incorporation de 40 % de farine de soja est donnée comme maximale, il serait dans ce cas intéressant que ce soit la farine de soja qui fasse partie des levains précédant la pâte. Un pourcentage de 10 à 25 % semble la limite pour garder une mie souple et aérée. Un ajout de 5 % permet déjà une meilleure longévité de la fraîcheur par la teneur d’une matière grasse à propriété émulsifiante réduisant le rassissement, selon certains[402].
D’autres personnes panifiant le soja poussent plus loin et vont même jusqu’à dire que le pain au soja mérite mieux le nom de pain complet que le pain contenant le son, puisqu’ici, il possède un meilleur équilibre nutritionnel, du fait de sa meilleure teneur en acides aminés essentiels (VII.7.).
Beaucoup d’iniatives commerciales de pain de soja entre les deux guerres mondiales n’ont pas toujours connu l’assentiment des consommateurs.
Pour les régimes anti-diabétiques strictes, le pain de pure farine soja, a dit-on une nuance de pain d’épice et une croute épaisse et il reste aussi une spécialité de magasin diététique.
Vers les années 1980-1990, on a dévelloppé des variétés de pois jaunes à moindre teneurs en facteurs anti-nutritionnels (acide phytique, tanins, lectines) et ouvert une nouvelle filière alimentaire, nécessitant avant broyage, un dépelliculage (retrait de la fine enveloppe). Les farines de protéagineux comportant trop de matières grasses risquant le rancissement, ne pourront pas profiter de la méthode moderne de turboséparation[403]qui oxyde, (et ainsi rancisse), plus vite. L’alternative des farines de légumes secs prendra probablement un nouvel essort prochainement, puisque les consommateurs et la recherche d’un meilleur équilibre alimentaire seront demandeurs de plus en plus des protéines « végétariennes » dans le bol alimentaire. En effet, certaines farines de pois et fèves atteignent jusqu’à 50 % de protéines.
La farine de pois chiches, elle, s’obtient après trempage de plusieurs heures. En cuisine on les saupoudrent de bicarbonate de soude pendant 30 minutes pour améliorer sa digestibilité, puis après un bon rinçage, cuisent à l’eau pendant plus d’une heure. C’est les prémices de procédé dit par voie humide qui est renseigné là, il permet par décantation, floculation, séparation par solvants, filtration, suivi de séchage, de procurer des produits intermédiaires de différents composants ou fractions des légumes secs[404]. On peut aussi utiliser la mouture par voie sèche, qui, si elle n’échauffe pas de trop, conserve mieux les aspects nutritifs. La farine, dite de cicerette, est la mouture de pois chiches décortiqués, pour lui éviter l’amertume et le caractère astringent de son enveloppe[405]. Cette farine sera égouttée, séchée, décortiquée, moulue puis blutée pour éliminer les téguments et parfois toastée. L’utilisation de flocons de pois chiches qui résulte d’un concassage suivi d’une cuisson à la vapeur peut apporter une autre solution. Le pois chiche cumule dans son contenu les teneurs en facteurs anti-nutritionnels (inhibiteurs d’enzymes, tanins, acide phytique et saponines). Les fermentations et trempages en deviennent importants pour ces raisons[406].
La farine de lentille verte, plus petite légumineuse, en sera plus délicate et fragile au séchage après les trempages, dégermages et dépelliculages nécessaires.
Plus digeste que le pois chiche, la farine de lentilles vertes riche en lipides risque dès lors de rancir, si la conservation ne se réalise pas au frais et à l’abri de l’oxydation[407].
X.17. Les farines de graminées « sauvages »

Là, on risque de faire plus de l’historique des famines ou de l’ivraie (ray-grass), dont on entend dans la croyance populaire qu’il faut la séparer du blé.
L’ivraie se « dépoisonne » en la faisant fermenter dans l’eau. C’est écrit dans un témoignage de 1648, et c’est vraiment pour tuer la faim[408] qu’on la consomme.
On peut tout aussi bien faire de ce sous-chapitre, un cours ou kit de survie en milieu naturel, qu’un plat permettant de soulever la curiosité dans un restaurant haut de gamme. La consommation en farine de petites graines a déjà été évoquée (X.1, X.12 et XII.5). Bien évidemment les céréales font partie des graminées (poacées) et ces dernières contiennent toutes, des graines avec amandes farineuses (fig.36).

On retrouve des consommations d’herbes graminées ou d’aliments farineux sous forme de cueillettes-ramassages plutôt que de cultures[409]. Assez curieusement, les égilopes, ne sont pas renseignées dans les ressources alimentaires des chasseurs-cueilleurs, ni par Adam Maurizio[410], ni par Jack Harlan[411], alors qu’elles entrent dans la généalogie du blé. Elles sont considérée au xvie siècle comme « peste du blé » [412] et certaines (Aegilops ovata – fig.37) par leurs formes sont dénommées en néerlandais Geitenoog, soit oeil de chèvre[413],
Les espèces sauvages des graminées domestiquées puis cultivées existent encore, la folle avoine est la plus connue parce que devenue adventice des cultures. Le riz sauvage (zizanie des marais) du bord des grands lacs nord-américains qui était récolté par les natifs américains a fait l’objet de sauvegarde.
Le brome (qui est le nom grec de l’avoine) et les autres graminées de nos prairies apportaient les glucides, lipides et protides aux populations nomades qui savaient les reconnaître. Ce fut le cas du brome mango et du brome secalinus en Amérique du Sud[414] qui seront supplantés par les céréales européennes. De nos jours, fétuque, dactyle, ray-grass et autres font l’objet de sélection aussi « attentionnée » que leurs frères et sœurs dites de grandes cultures.
Jean-Pierre Collaert nous fait encore découvrir ce qu’il appelle avec un point d’interrogation des « laissées pour compte », discriminées parfois de nos jours en termes de plantes invasives ou adventices. Le bourgou, qui a un habitat assez semblable au riz sauvage, le drinn présent dans les oasis qui se contente de peu d’eau, l’afezu encore plus spécifique aux zones arides avec des racines allant à jusqu’à trois mètres de profondeur, le cram-cram, 9 % de lipides et 21 % de protéines, mais il est épineux. La larme de Job est dénommée ainsi puisque la graine prend la forme d’une goutte pendante est présente dans l’Est asiatique, elle est également utilisée en bijouterie populaire[415].
Julien qui s’intéresse à tout ce qui touche les livres de Paul-Jacques Malouin relevait la présence de la manne (fig.36) dans le livre de celui-ci. Ce qui l’intrigua au point d’investiguer sur celle-ci. « Au détour de la lecture de L’Art du Boulanger, je suis tombé sur un article intriguant, que j’avais survolé puis oublié en première lecture ».
L’auteur évoque un grain miraculeux, celui-là même que, d’après la Bible, les Juifs reçurent de Dieu pour se nourrir pendant l’Exode.
Il y a encore à ce jour une poignée d’hypothèses concurrentes concernant l’identité possible de ce végétal qui serait (d’après la bible) tombé en pluie avant de disparaître au lever du soleil. Quoi qu’il en soit, Malouin précise bien qu’il a en tête une famille de graminées que l’on trouve un peu partout en Europe, celle des glycéries. Les plantes les plus courantes étant glyceria fluitans, glycérie flottante, ou plus simplement herbe flottante, et glyceria maxima, qui comme son nom l’indique est plus grande que fluitans, (2-3 m contre 1-1,5 m). Sa graine est « une espèce de petit riz presque rond », auquel on trouve un goût légèrement sucré, plus délicat que celui du riz. On peut en faire un pain de manne, qui est en fait une sorte de galette asséchée plus qu’un véritable pain levé[416]. Une étude de 1905 nous donne cette composition du fruit de fluitans : eau 13,5 %, protéines 9,69 %, lipides 0,43 %, glucides 75,06 %, fibres ligneuses 0,21 % et cendres 0,61 %. On remarque la forte teneur en glucides qui explique le goût sucré de la manne. En Pologne, elle est déjà prisée par les nobles au Moyen Âge, avec un prix situé entre ceux de la viande et des épices importées[417]. Elle a longtemps fait partie du tribut exigé par les propriétaires terriens, au même titre que le seigle, le blé, les glands, les noisettes, les faînes, etc.
Malouin détaille la récolte : on utilise un tamis plat, « qu’on pousse contre les sommités des herbes, ensuite l’on prend ce qui est tombé dans le tamis : on le frotte entre les deux mains ; puis on le vanne, pour en faire sortir les pailles les plus légères. Enfin on crible, et la manne grain passe nette aussi ; elle est blanche, et ressemble à du millet ». La récolte nécessite un labeur patient : il faut plus d’une journée de travail pour en obtenir un seul kilo. Mais comme les grains atteignent leur maturité en juin, la manne est le moyen pour les paysans de moins souffrir de la disette qui précède souvent les récoltes de seigle et de blé. Une légende tenace veut que la récolte ne puisse se faire qu’avant le lever du soleil, au risque de voir disparaître la manne. Il s’agit probablement de lointains échos du récit biblique.
La pratique s’explique plutôt du fait qu’il est plus facile de collecter les grains encore humides de rosée, ils adhérent ainsi d’autant mieux au tamis.
Après la récolte, on met les grains à sécher, puis on les pile avec de la paille dans des mortiers en bois pour en ôter les enveloppes. Une fois décortiqué, « le grain peut être conservé plus d’une année en bon état[418] ».
Voici la préparation et la recette d’après Malouin[419]. « On commence par éplucher la manne, dont nous venons de faire l’histoire, ensuite on la lave comme le riz ; on doit la laver deux fois plus que le riz : il faut pour bien faire, laver cinq ou six fois le riz ; et la manne a besoin d’être lavée dans dix ou douze eaux, avant que de la mettre à cuire. Il faut commencer par laver à l’eau froide, ensuite tiède, chaude, et enfin bouillante, augmentant par degré la chaleur de l’eau, qu’on tient au feu pour cela. »
Recette de la galette de manne d’après Malouin : « La manne ainsi préparée, on la met dans une casserole sur un feu doux, après y avoir versé de l’eau ordinaire dans l’état naturel, jusqu’à la hauteur de quatre travers de doigt, au-dessus de la manne. On y met un peu de beurre, et l’on entretient le feu jusqu’à consumer l’eau tout à fait. La manne renfle autant que le riz, pour le moins. Enfin on y ajoute encore un peu de beurre, et on laisse sécher la manne sur le feu dans la casserole, où elle devient comme un pain ; c’est du pain de manne. Il y en a qui en y mettant la seconde fois du beurre, y joignent un peu de sel. On peut mettre aussi ce pain dans le four ; mais les Polonais, qui en font grand usage, l’aiment mieux quand il n’a pas été cuit au four. Ou bien on le fait dans une tourtière, on le couvre d’une tôle, sur laquelle on met des charbons ardents, pour le sécher, et pour achever de cuire ce pain ; c’est ce que l’on nomme pain des Israélites, par une extension du mot Pain. »
X.18. Le Kernza® : ancien grain et nouvelle technologie de sélection.
Le Kernza®, on l’appelle généralement avec le nom latin Agropyron, de sa famille qui est importante en nombre et très voisine des céréales.
On trouve dans cette famille un Agropyron que l’on appelle communément « Chiendent », considéré comme une poisse de mauvaises herbes du fait de ses racines profondes et intenses.

Ces mêmes racines profondes et intenses lui donneraient un caractère pérenne, la graine est vivace et revient chaque année sans besoin de ressemer. On parle d’un caractère permanent sur culture de deux ans voire plus, jusqu’à cinq ans[420].
Après, s’il y a assolement pour lutter naturellement contre les pestes, il est peut-être normal que l’on ne puisse pas faire plus que cinq ans. Cette idée de graminées pérennes a germé au centre de recherche Rodale dans l’état de New York depuis les années 1980. Ces pionniers du bio aux États-Unis travaillaient sur le Thinopyrum intermedium, soit Agropyre intermédiaire, ils l’ont largement hybridé avec le blé dans le but de transférer des caractères. La recherche est ensuite reprise tout au début du siècle par un généticien américain, Lee DeHaan du Land Institute (Institut de la Terre) au Kansas. Celui-ci travaille en collaboration avec l’université du Minnesota[421], il en a fait son projet, sa recherche, qu’il a conduit au sein d’une association sans but lucratif. Pour lui, la raison pour laquelle le monde agricole a attendu l’arrivée du Kernza® est la façon dont cette graminée interagit avec le sol. La plante peut en effet réagir rapidement aux changements de sol et de température en absorbant l’eau, l’azote et le phosphore. La valeur nutritionnelle du Kernza® est comme beaucoup de plantes originelles, plus riche en vitamines et minéraux. Le blé annuel, lui, ne vit pas assez longtemps pour développer des racines épaisses et nécessite au moins un petit travail du sol avant chaque semailles. Mais les racines de Kernza®, elles, maintiennent le sol en place, empêchant l’érosion. Ceci est particulièrement crucial dans certaines zones agricoles des États-Unis où la crise du « dust bowl » (tempêtes de poussières et grandes sécheresses) des années 1930 a marqué les mémoires dans les Grandes Plaines des États-Unis. C’est une des érosions de terres arables les plus connues.
Lee DeHaan et le Land Institute ont envoyé les résultats de leurs premiers essais du Kernza® pour être testés au Minnesota, Manitoba, Wisconsin et en Suède puisque la plante se comporte mieux dans les zones à humidité abondante. Les obtenteurs utilisent le séquençage de l’Adn pour aider à atteindre les variétés et les traits qui comptent. L’équipe ne prend pas les gènes d’autres organismes, dit le site geneticliteracyproject. Leur objectif est de faire grossir la graine qui est petite et en plus, doit être décortiquée, c’est pourquoi je crois qu’ils risquent fort d’aller chercher des gènes ailleurs et il est impossible, sans intervention de modification génétique ou autres procédés mutagènes, de croiser dans les triticums, des engrains avec des blés durs ou tendres. Même le triticale a été obtenu par fusion de protoplasme en utilisant la colchicine ou d’autres méthodes plus « modernes », ainsi que pour le tritordeum et le blé Renan qui est issu du blé Vpm. Tous sont susceptibles d’avoir utilisé ces méthodes pour lier deux Adn. Donc, c’est clair, il y a manipulation génétique, mais allez savoir ce qu’ils mettent dans « ne prend pas les gènes d’autres organismes », est-ce dans l’espèce Agropyron, dans la famille des graminées ou genre Poacées qu’ils déclarent ce fait ? Et que s’autorisent-ils comme méthode de sélection, le rétrocroisement que l’analyse d’Adn permet de suivre, ou vont-ils jusqu’à la fusion de protoplasme aidé par la colchicine ou encore les « ciseaux génétiques » (III.1.) ?
Le Land Institute du Kansas travaille également pour l’obtention de sorgho et tournesol pérennes.
Au Canada, Doug Catanni, chercheur à l’Université du Manitoba et collaborateur du projet « Kernza », se souvient que « la première année, seulement 6 % des plantes ont survécu ». « La plante a compris qu’elle n’était plus au Kansas » écrit-il. Plusieurs années plus tard, les chercheurs de l’Université du Manitoba ont réussi à adapter la plante aux conditions des grandes prairies canadiennes au climat plus rigoureux. Les racines ont en moyenne une profondeur d’un mètre, et peuvent atteindre jusqu’à 3 mètres de profondeur.
Il existe sur le marché, mais à l’état embryonnaire actuellement, des pains où 30 % de kernza® entrent dans la composition[422]. Le boulanger de Tall Grass Prairies à Winnipeg, Loïc Perrot, pense même pouvoir aller jusqu’à 50 %.
On prévoit les premières commercialisations pour 2020, mais d’autres pensent qu’il faudra attendre 2030. Pourtant en mars 2017, General Mills prévoit d’utiliser un grain sucré à saveur de noisette (soit le Kernza®) qu’il affirme être plus écologique que le blé conventionnel et qu’ils vendront au travers de leur marque biologique Cascadian Farm®[423]. Cette firme provient d’une des fermes pionnières US du bio, et comme General Mills a acquis en 1999 Small Planet Food dans laquelle la Cascadian Farm® avait été intégrée, le marketing à venir sur le kernza risque d’être important, vu les moyens financiers de l’entreprise.
General Mills, la firme que Cadwaller C.Washburn a créé en 1866 (XII.9.), a investi dans la transformation de terres du conventionnel vers le bio en demandant à Gunsmoke Farms de faire passer en bio plus de 12 000 hectares pour 2020.
L’objectif de General Mills pour 2019 est de passer à 101 000 hectares en bio alors qu’en 2016, il en était à la moitié.
X.19. Les divers garnitures ou ingrédients aromatiques du pain.
Avec la forte présence de graines sur et dans le pain, le professeur Calvel, évoquant sa visite de la grande exposition allemande Iba dédiée à la boulangerie, en a retiré l’impression d’entrer dans une graineterie.
Il est vrai qu’il aimait la simplicité, ce qui est réalisé dans la nature des choses et qu’en Allemagne, on aimait à l’époque diversifier l’offre en boulangerie afin de lutter contre la baisse de la consommation du pain.
Les graines de sésame, de pavot bleu, de cumin, de tournesol, de courges, de lin brun ou jaune, de chia, les pignons de pins, etc. devaient être bien visibles et du coup subissaient en croûte de très fortes températures au risque évident d’être grillées, voire carbonisées, à la cuisson. Christian Rémésy incite les boulangers à « quitter les sentiers battus de la farine de blé et introduire la plus grande diversité possible de graines », cela pour améliorer la biodiversité autant nutitionnels, fermentaires et même agricoles[424]. Certes, en utilisant ces graines pour répondre dans notre fournil, à une demande venant d’enfants, on faisait des pains multi-graines que je dénomais benoitement « crunch » pour se faire plaisir, tellement je sentais qu’il fallait que cela croque pour eux. Mais bien avant cela, j’utilisais le sésame, non blanchi, que je grillais au four « reposé » en fin de journée, à l’aide d’un peu d’huile répandue et bien mélangée aux graines. Simplement ajouté à la pâte, je trouve que ce sésame grillé ’il apporte assez son goût comme cela, et cela évite le grillage trop prononcé du au topping (garniture externe de graines sur la croûte du pain). De toute façon, au ressuage, le goût du sésame grillé se transmet vers la croûte qui l’imbibe de son parfum.
Saupoudrer le pain « à titre cosmétique, sans modifier notablement sa densité nutritionnelle » semble une démarche nettement moins utile pour Christian Rémésy[425]
Pour moi, le pavot doit aller plus dans la mie que dans la croûte, aussi je préfère la manière que m’ont indiquée les propriétaires du gîte « Le fournil », Cécile et Marian Struzik-Septroux. Ils m’ont permis de voir comment, du côté de la Vistule, en Pologne, on sait valoriser le pavot pour en faire une pâte appelée « mak », soit, « pavot » en polonais.
On verse de l’eau bouillante dessus, après un petit temps, on laisse égoutter le plus possible et on broie les graines refroidies qui ont légèrement gonflé à l’ébouillantage.
À Noël, en Pologne, cette masse à laquelle on ajoute beurre, miel, poudre d’amande et raisins secs sert à garnir des gâteaux saisonniers. Le dessert traditionnel se dénomme makowiec et se présente souvent roulé en boudin sur un fond de pâte et coupé en tranches.
Si l’on utilise des herbes aromatiques ou des épices, il peut être utile de les infuser d’abord dans le liquide servant d’eau de coulage. Cela permet souvent de relever le goût que l’on veut apporter. Dans ce cas, le lait entier avec sa matière grasse et parfois plus captif d’arôme que l’eau.
Un livre de Marie-Pierre Avry est sorti en 2012. Il est consacré aux plantes, épices, graines et herbes aromatiques que l’on peut ajouter au pain. L’auteure vous donne plus de six cents pages d’idées et d’évaluations sensorielles sur le sujet. Elle veut apporter plus de goût, des sensations visuelles, un confort santé et constate que les Français restent très attachés à la baguette de tradition. C’est la préférence de son panel de dégustateurs qui porte en deuxième place sur le podium les pains à la farine de châtaignes et aux noisettes. Suivent dans toujours dans l’ordre, les pains à la farine d’avoine et de farine de maïs, puis le pain aux oignons, aux graines de sésame, aux olives vertes et aux figues[426].
Dans son livre, M.-P. Avry propose que le pain reçoive un des cinquante-neuf éléments présents dans ces choix d’ajouts (autant farine de céréales, pseudo-céréales, graines, fruits, légumes et épices) pour corriger ou améliorer le pain[427].
Comme le signale la revue « Le Boulanger-Pâtissier », qui discourra sur le sujet également en décrivant vingt-cinq recettes de pains aromatiques, ces pains peuvent être obtenus à partir d’une pâte identique, ce qui diversifie, sans trop complexifier ou aloudir le temps d’heures de travail[428]. Mais, ce qui est plus difficile à gérer dans ces pains qui rassemblent les goûts dans la mie plutôt que sur la tartine, c’est l’identification des allergènes à déclarations obligatoires -Ado) que la loi impose.
Les graines de lin vont souvent s’inviter dans le plan de lutte anti-cholestérol, puisque l’acide gras dit anti ou bon cholestérol porte le nom d’acide linoléique ou linolénique[429]. Le lin est aussi riche en bonnes fibres, d’où la dénomination linceul et son utilisation dans le secteur textile. Ces ligaments feront de ces graines, préalablement trempées, un mucilage bien reçu par la pâte en confection. Le côté laxatif doit être également évalué lors des apports. Ne favorisons quand même pas de trop le transit intestinal en couplant teneurs riches en son et en graines de lin.
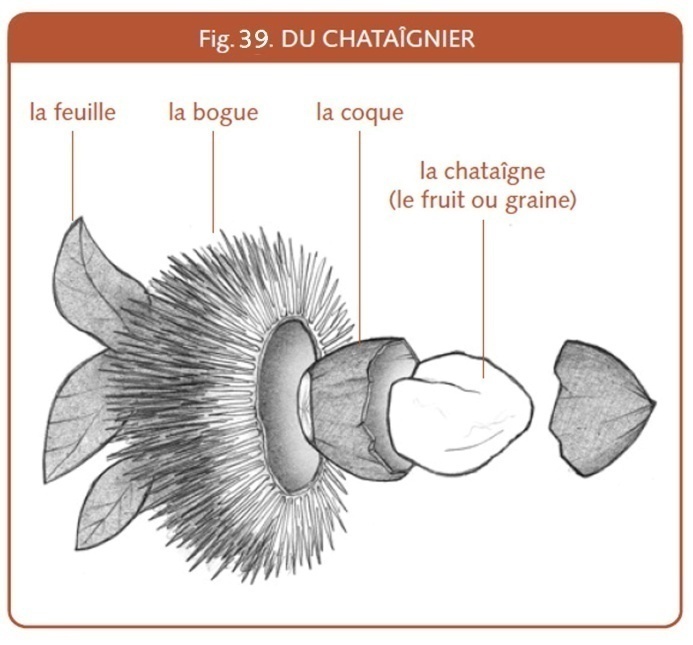
L’ajout de la farine de châtaigne pourrait porter nominativement le dilemme, arôme dans ou sur la tranche, puisqu’on appelle parfois le châtaignier (fig.38) l’arbre à pain, tant sa farine constituait la base de l’alimentation dans certaines régions montagneuses. Turgot qui fut ministre des finances de Louis XVI, avait en 1770, voulu détruire les châtaigniers du Limousin pour lui substituer la pomme-de-terre, alors que la châtaigne entrait par moitié dans la base de l’alimentation des campagnes[430]. Il n’y a pas si longtemps, au début de la première moitié du siècle passé, les châtaigneraies étaient une application type de l’agroforesterie naturelle procurant son fruit pour les humains comme pour les animaux, du bois imputrescible pour charpentes faitières ou bois d’œuvre contenant les tanins et enfin servant ombrage aux cèpes et girolles. L’exode rural a fait que les châtaigneraies dépérirent.
C’est plutôt les plus petits fruits de châtaigne qui seront réduits en purée, crème ou farine[431]. On les conservait dans leurs bogues (appelées aussi bugues ou boursiers) en tas recouvert de feuilles de fougère et de branchage, mais il est plus courant de les sécher doucement au-dessus du foyer pendant un mois. Après avoir pratiqué la séparation de leurs enveloppes, elles passaient au four à pain pendant deux jours y consommant le solde de la chaleur après cuisson. Une autre technique consistait au trempage dans l’eau pendant une semaine, ce qui permet d’éliminer les fruits véreux et vides que l’on élimine lors du changement quotidien de l’eau. De nos jours, dans le séchoir aménagé, elles passent quarante-huit heures et la conservation des fruits débogués et en bon état se réalise au surgélateur[432]. M.-P. Arvy nous rappelle le « pisticine », l’ancien pain corse à la farine de châtaigne au temps ou celle-ci remplaçait les céréales dans le maquis de l’Île de beauté[433].
De nos jours, on considère qu’à partir d’ajout de 15 % à la farine de froment, on apporte déjà un goût à la pâte de froment. La farina castagnina corsa est dite « biscuitée » et a obtenu une Aoc en 2006. Elle présente un bon apport d’éléments minéraux.
| fig.40 Analyse d’une farine de châtaigne corse | ||||
| Valeur maximale | Valeur moyenne | Valeur minimale | ||
| Perte à la dessiccation | 9,14 % | 6,60 % | 4,14 % | |
| Teneur en protides | 9,56 % | 7,10 % | 5,93 % | |
| Teneur en lipides | 3,66 % | 3,01 % | 2,19 % | |
| Teneur en glucides | 85,00 % | 81,11 % | 77,22 % | |
| Teneur en cendres | 2,85 % | 2,03 % | 1,30 % | |
| Teneur en tannins | 0,339 % | 0,15 % | 0,00736 % | |
| D’après AZéMA, 2007. | ||||
La noix se mêle en « invalides » (appellation des cerneaux de noix en brisures) à la pâte.
Il arrive fréquemment qu’on les fasse tremper une nuit, afin de retirer le très foncé et tanique, brou de noix. Cette façon de faire est controversée puisque pour certains, on ne retire pas que de l’amertume mais aussi du goût. La noix de Grenoble a une aire géographique délimitée par décret dès 1938 et doit être de certaines variétés[434].
M.-P. Arvy propose généreusement 25 % de noix au kilo de farine[435] légèrement broyées et pour d’autres, 15 % suffisent avec une pâte où la farine de seigle entrerait en partie[436].
La noisette sera légèrement toastée ce qui permettra de la libérer plus facilement de sa fine enveloppe, de l’émonder. Le concassage sera léger pour garder de grosses brisures.
On y incorpore 10 à 15 % au kilo de farine. Celle-ci sera bise ou complète, le seigle et d’autres farines seront les bienvenues. Le pain ainsi fait au levain accompagnera utilement les alpinistes dans leurs longues randonnées, étant à lui seul une solide nutrition.
Pignons de pain, noix du Brésil, de Macadamia/Queensland, de Cajou, amandes, cacahuètes, pistaches peuvent faire partie de vos choix de panifications, plus favorablement en hiver qu’en été puisque ses noix sont comme une réserve énergétique pour passer nos périodes de grand froid.
Les fruits ou légumes secs peuvent également être ajoutés, tout cela fait plus partie de notre imagination, de notre inventivité, pour un « pain du mois » ou d’une « surprise du fournil », comme le définissait Françoise dans sa boulangerie « Fleure bon le pain ». Les fruits ou légumes frais seront avantageusement roulés légèrement dans de la fine chapelure ou dans des petits flocons pour rester le plus intacts possible lors de leur douce insertion à la pâte parfois briochée, à moins d’effectuer des inserts à l’aide de fruits congelés.
X.20. Les farines de graines textiles servant d’apport protéique ou d’autres propriétés
D’autres farines seront mises parfois sur le devant de la scène par des efforts médiatiques d’un lobby de secteur (c’est leur travail), ou de recherches de marché de niche par des coopératives agricoles pour diversifier leurs offres principalement sur des sous-produits à valoriser. Ainsi on se verra notamment proposé par une filiale de Procter & Gamble[437], de la farine de ce nouveau coton alimentaire, dépourvu du pigment toxique, le gossypol et championne en teneur de protéines. Le coton qui va procurer la fibre végétale pour produire le textile est la houppe soyeuse qui entoure la graine contenant l’amande dont on extrait la farine. Du broyat de cette dernière, on obtient un contenu ayant 30% de proteines. Si on l’extrait du tourteau c’est 40% de proteines et sur la farine délipidée, on obtient 50% de protéines. Il faut souvent délipidé pour la conservation et veiller à la qualité microbiologique. Cette farine de coton « alimentaire » dite « glandless » arrivera sur le marché européen dans les années 1990. Au départ, cette farine de coton sans gossypol (qui peut être génétiquement modifiée) a été cultivée au Nord Cameroum, Mali et Tchad, pour améliorer en mélange, la teneur protéique des farines de sorgho ou de mil [438].
Comme le sera la farine de criquet, elle aussi, super-championne en teneur de protéines (78 %), et qui déjà en ajout de 10 % dans le mélange, donne un aspect brun foncé. C’est en 2017 qu’est venu cette proposition sur le marché[439].
La farine de chanvre résulte comme pour le soja et le coton du broyage du résidu de la plante (tourteau) lorsque l’on en a extrait l’huile.
L’apport de la farine de racines de chicorée est riche en liante inuline, une gomme alimentaire ou épaissisant.
Encore à ajouter dans la gamme des ajouts inédits, la farine de lupin, venant se proposer fin des années 1980, comme une alternative à la farine de soja. Cette dernière est devenue (avec le coton, le maïs et le colza) une des premières cultures Ogm dont le manque de tracabilité ne permettait pas de différencier les deux types de lots. C’est une coopérative agricole d’Ile et Vilaine qui proposera la farine de lupin sur le marché[440]. Le lupin est une légumineuse riche en protéines (près de 40%) et au pouvoir émulsifiant capable de remplacer le jaune d’œuf et la lécithine de soja et apportant même une teinte jaune. Ces 10% de matières grasses intéressantes lui impose des précautions à prendre lors de sa conservation. Important et à signaler, il faut penser de la mentionner dans l’étiquetage, car elle fait partie depuis 2006, des allergènes (Allergènes à déclarations obligatoires -Ado) à signaler en alimentation humaine.
X.21. Diversification ne doit pas être dispersion
Ce qui est sain dans la réflexion de diversification ou innovation, c’est que le client (ou le fournisseur) ne doit pas imposer sa demande sur votre offre. C’est vous qui devez surprendre, faire connaître, rendre curieux et marquer le temps avec une offre ou vous permettez à la clientèle de se réjouir à l’approche du produit ou d’une date. Pour redécouvrir des produits de saisons à certaines périodes de l’année, faites parfois confiance au folklore qui a su imprimer son calendrier dans la mémoire collective. A la date prévue, laissez-les arriver, puis passer la période, laissez-les repartir.
Autre désagrément, si l’on « se laisse faire » ou si la passion de découvrir l’emporte, cela risque d’élargir une gamme de petites productions toujours moins rentable que la production de pâte en masse. Et surtout cela demande beaucoup de suivis différents pour maitriser le tout, alors qu’il vaudrait mieux connaitre sur le bout des doigts, en profondeur une pâte dans sa réactivité plastique et de bien en saisir les limites nutritionnelles lors de ces mélanges et de la fermentation qui en résulte.
Si l’on veut ne pas se tromper d’ambitions sur nos capacités et recherches identitaires que soit au niveau physique ou inventif, essayons de ne pas nous disperser.
- Bibliographie du Chapitre X Le choix des grainesCommunication d’une Marocaine anonyme à l’atelier pain aux rencontres « Sème ta résistance » de septembre 2015 à Pau. ↑
- R. Stegassy et J.-P. Bolognini, p. 136 ; Étienne Mabille, septembre 2006. ↑
- Voir J.-F. Ledent, p. 7. ↑
- R. Buxo I Capdevila, p. 112. ↑
- Michel Markus, p. 123. ↑
- Claudia Piras et Eugenio Medagliani, p. 261. ↑
- Piet Debruyn, p. 12-14. ↑
- C. F. H. Longin et collab., p. 308. ↑
- A. Maurizio, p. 197. ↑
- Elsayed M. Abdel-Aal, Frank Sosulski et Pierre Hucl, p. 710. ↑
- Témoignage d’Hervé Cournède, Frab et Bio 82, p. 4. ↑
- Henri de Vilmorin, 1880, p. 158. ↑
- Frab et Bio 82, p. 2. ↑
- J.M.P. de Vilmorin, p. 2. ↑
- Jean Gayon et Doris Zallen, p. 235. ↑
- A.Bonjean, Histoire, 2001, p. 30. ↑
- E. D. Akhunov, A.R. Akhunova et J. Dvorak, p. 1617-1622 ; D.Zohary, M. hopf et E.Weiss, p. 47. ↑
- R.Dodoens et C. L’écluse, 1557, p.320. ↑
- Piet Debruyn, p. 6-7. ↑
- A. Karagöz, p.172-173. ↑
- R. Avni et al., p. 93-97. ↑
- Site : http://www.bioversityinternational.org/fileadmin/user_upload/online_library/publications/pdfs/54.pdf ; Concetta Vazzana, p. 147-152. ↑
- Site : https://www.umbriatourism.it/-/farro-di-monteleone-di-spoleto-dop-en ; Christina Papa, p.154-171. ↑
- Renseignement reçu grâce à un échange avec Florent Mercier ↑
- Observation transmise par Jean-François Berthellot ↑
- Yves Colombet, Et si on parlait d’étymologie, extrait de Graines de Noé, ouvrage associatif, 2020, p.144. ↑
- Piet Debruyn, p. 20. ↑
- E.M. Peligot, p. 16-17 du tiré à part. ↑
- Dirk Spennemann, p. 14. ↑
- Henri de Vilmorin, p. 130. ↑
- Louis De Villeneuve, p. 165. ↑
- Nicolas C. Seringe, p. 105. ↑
- Augustin Pyrame De Candolle dans la revue d’agriculture et de jardinage 1839-40, p. 7. ↑
- H. de Vilmorin, p. 134. ↑
- C. C. Mathon et M. Stroun, p. 20. ↑
- Gaspard Bauhin, p. 21. ↑
- C. C. Mathon et M. Stroun, p. 19-31. ↑
- Jaurès Medvedev, p.100 à 107 et p. 221 ; Article Wikipédia sur T.D.LYSSENKO à Blé ramifié ↑
- H.-C. Geffroy et P. Sauvageot, 1949, p. 7-8. ↑
- Marie-Lise Geffroy, p. 8. ↑
- Site : ekopedia.fr/wiki/Blé_des_pharaons ↑
- Salah Gowayed, p. 3, 128-129. ↑
- R. Stegassy et J.-P. Bolognini, p. 159-161. ↑
- Mlle Aline Dusseau, 1931, p. 79. ↑
- O. De Serres, p. 107. ↑
- Témoignage de Claudio Grossi en juin 2013 et reportage de Slow-Food d’émilie Romagne. ↑
- J. Pitton De Tournefort, p. 512. ↑
- Gaspard Bauhin, p. 21. ↑
- H. de Vilmorin, p. 144. ↑
- E. M. Péligot, p. 30. ↑
- éléna Khlestkina et collab., p. 172-180. ↑
- Roland Feuillas et J.-Philippe De Tonnac, 2021, p.54. ↑
- Francesco Inghirami, en 1823, p. 448. ↑
- Raconté dans la documentation de la Coopérative La terra e il cielo, grano estrusco. ↑
- Simonetta Lorigliola. ↑
- Site : kamut.com/fr, le grain, consulté le 7 avril 2017. ↑
- Ugo De Cillis, 326 pages. ↑
- S. Symko, chapitre Origine du Red Fife. ↑
- Site : kamut.com/fr, l’histoire. ↑
- Site : kamut.com/fr, la marque déposée. ↑
- Site : kamut.com/fr – Normes de la marque Kamut ; A. Edelbauer et collab., p. 183-184. ↑
- Site : https://www.kamut.com/en/health/research ↑
- Site https://www.verobiologico.it/verobio/il-gentil-rosso/ ↑
- « Kamut la marque du blé Khorasan », dans la revue Biolinéaires, mars-avril 2011, p. 63. ↑
- N. I. Vavilov, p. 6. ↑
- L. Ammann, p. 68 ; C. Willm, 04/1995, p. 20. ↑
- W. Bushuck et E. R. Kerber, p. 1019-1024. ↑
- N. I. Vavilov, p. 61. ↑
- Christophe Bonneuil, Frédéric Thomas, p. 460-462 ; A. Gallais et le site agriculture-environnement.fr/a-la-une/un-ble-bio-genetiquement-modifie-ca-existe-déjà, mis en ligne le 21/03/2013. ↑
- H. de Vilmorin, p. 42, 104, 106. ↑
- Revue d’agriculture et de jardinage, Librairie Roret, 1939-1940. ↑
- Jacob Allen Clark, J. Martin et C. Ball, p. 172-177. ↑
- Claire Casnin et collab. ↑
- R. Buxo I Capdevila, p. 114, 115 ; Leonor Penã – Chocarro, p.128 -146. ↑
- M. Jacqmain et C. Ancion, p. 21. ↑
- H. Zwingelberg, p. 85. ↑
- C. Billen, 1989, p. 179. ↑
- F. Sigaut, 1989, p. 34. ↑
- J.R. Harlan, p. 176. ↑
- F. Desportes, p. 12, 13 ; J.-P. Devroey, 1989, p. 93, 95. ↑
- Témoignages de Marc Van Overschelde à la ferme du Hayon et de la chercheuse Emmanuelle Escarnot du CRAW (B). ↑
- F. Desportes, p. 15 ; G. Sivery, p. 327. J.-P. Devroey, 1989, p. 96 ; François Sigaut, p. 36, 39. ↑
- Lilian Ceballos, 2022, p.161-163. ↑
- G. Comet, 1989, p. 150, 151. ↑
- Gottfried Hertzska et Wighard Strehlow, p. 45-59. ↑
- J.-P. Devroey, p. 89, 90 ; J.-F. Ledent, p. 14. ↑
- O. de Serres, p. 108. ↑
- F. Desportes, p. 16. ↑
- J.-P. Devroey, 1989, p. 101. ↑
- J.-P. Devroey, 1989, p. 99. ↑
- Edward P. Thompson, p. 35 ; Steven L. Kaplan, 1986, p. 226. ↑
- A. Sureges et M. Verlinden. ↑
- Claude Aubert, 11-1989, p. 67. ↑
- Peter Kunz, qui montrait un schéma sur son site en 1999. ↑
- Ute Rabe, p. 16. D. Meyer, p. 19. ↑
- G. Hoyois, p. 221 ; M. Jacqmain et C. Ancion, p. 19. ↑
- Anne Sureges. ↑
- Le Moniteur de la Boulangerie, mars 1983 et février 1985. ↑
- epeautredardenne.be ↑
- J.-F. Ledent, p. 7 ; L.Ceballos, 2022, p. 69-71. ↑
- M. Von Büren et collab. ↑
- E. Vogt, p. 54. ↑
- R. Buxo I Capdevila, p. 107. ↑
- Raymond Buren, p. 49 ; Noël Anselot. ↑
- Matthias De Lobel, p. 28 ; F. Baumgartner et L. Graf, p. 383. ↑
- A. Dauzat et collab. ; R.Van Santbergen, p 27, 84 ; J.-P. Devroey, 1989, p. 90 ; G. Comet, p. 149. ↑
- O. de Serres, p. 108. ↑
- A. T. Szabo et K. Hammer, p. 3 ; R. Ploner et C. Mayr, p. 58, 60 ; R. Buxo I Capdevila, p. 110, 112 ; F. Sigaut, p. 31. ↑
- A. A. Parmentier, p. 556. ↑
- Albert Deman p. 191 ; Françoise Ladrier, p. 284. ↑
- R. Buxo I Capdevila, p. 110, 121. ↑
- Jürg Schuppisser, 08-2019, p. 40-43. ↑
- C. I. Kling, p. 4. ↑
- L. Geissler, p. 267. ↑
- P. Schilperoord, p. 17 à 36. ↑
- J.M. Jacquemin, p.13 ↑
- Voir le site du Cimmyt, http://wheatpedigree.net/ ↑
- Revue Industries des Céréales, août-septembre 2000, p. 48, juin-juillet 2002, p. 48-49. ↑
- Site : « Création de variétés d’épeautre adaptées à la réduction des intrants et répondant aux besoins de l’agriculture durable », cra.wallonie.be, posté le 18/04/2016. ↑
- C. I. Kling, p. 4 ; M. Jacqmain et C. Ancion, p. 24. ↑
- G. Hoyois, p. 221-222. ↑
- C. I. Kling, p. 6. ↑
- Jean Duval ; Lafever H.N. et L.G. Campbell, p. 15-16. ↑
- Alfred Schädeli, p. 5. ↑
- Gottfried Hertzka, Wighard Strehlow, p. 45, 50. ↑
- A. A. Parmentier, p. 556. ↑
- G. Comet, p. 157. ↑
- Site : hildegard.de/dinkel.htm ↑
- H.-D. Belitz, W. Seilmeier et H. Wieser, p. 1-5. ↑
- Eckhard Rabe, 1993, p. 248 ; J. M. Brümmer, 1993, p. 140 ; N. L. Ruibal-Mendeita, p. 49-50. ↑
- J. M. Brümmer, 1993, p. 140. ↑
- Eckhard Rabe, 1993, p. 249 ; Nike L. Ruibal-Mendeita, p. 100. ↑
- Eckhard Rabe, 1993, p. 247 ; Nike L. Ruibal-Mendeita, p. 172-173. ↑
- N. L. Ruibal-Mendeita, p. 52-58, 169, 171. ↑
- J. M. Brümmer, 1993, p. 140 ; M. Jacqmain, p. 24 ; A. A. Parmentier, p. 557. ↑
- M. Jacqmain et C. Ancion, p. 22-23. ↑
- M. Jacqmain et C. Ancion, p. 25. ↑
- Le Moniteur de la Fédération francophone de la Boulangerie, mars 1983 et février 1985. ↑
- D. Meyer p. 44 ; J. M. Brümmer, 1993, p. 140-148. ↑
- J. M. Brümmer, 1993, p. 140-148. ↑
- J. M. Brümmer, 1993, p. 147-148. ↑
- A. A. Parmentier, p. 556-557. ↑
- J.-F. Ledent, p. 11. ↑
- Georges Comet, 1989 b, p.103 et 104. ↑
- René L. Desfontaines, p. 114. ↑
- Jean Gayon et Doris Zallen, p. 243 ; Georges Trébuchet et Christian Gauthier, p.23 et 81. ↑
- E. M. Péligot, p. 6, 30 du tiré à part. ↑
- Journal d’agriculture de la Société d’agriculture de l’Ain, 1823, p. 198. ↑
- Mémorial universel de l’industrie française des sciences et des arts, Tome second, avril 1820, p. 339-341. ↑
- H. de Vilmorin, p. 124. ↑
- « Céréales bio et production de pâtes en Marches », Revue Organic pro de mai 2012. ↑
- Corrado Barberis et Graziella Picchi, 1995. ↑
- consorziopanedimatera.com ↑
- Site de Rete Semi Rurali ↑
- Éric Jozsef, « Le boulanger a eu la peau de McDo », Libération, 3 janvier 2006. ↑
- Sergio Salvi, p.16. ↑
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_agricole_fasciste_en_Italie ↑
- Revue du mouvement Rete Semi Rurali, n°20 de mai 2018 consacré à l’affaire “Senatore Capelli”, 16 pages. ↑
- Site : agraria.org/prodottitipici/pagnottadeldittaino.php ↑
- Antonio Attore et collab. ↑
- H. de Vilmorin, p. 136. ↑
- Columelle, Tome 1er, 1844, livre 2, chap. 6. ↑
- Adriano Farano, 2020, p.141 à 146. ↑
- A. R. Delile, planche 14. ↑
- J. Abecassis, janvier 1993, p. 29. ↑
- Julie Bednarek, p. 16-19. ↑
- R. Drapron et al., 2005, p. 97. ↑
- M. Benoit et collab., p. 139. ↑
- Georges Comet, 1989 b, p.108 ; Emmanuel Le Roy Ladurie, 1037 pages . ↑
- E. M. Péligot, p. 16-17 du tiré à part. Analyse de L. N. Vauquelin relaté dans M. Benoit, p. 123-127. ↑
- J. Abecassis, janvier 1993, p. 28. ↑
- C. Willm, avril 1995, p. 22 et oct. 1995, p. 4. ↑
- I. Lempereur et col., p. 16. ↑
- Voir les cahiers des charges des pains d’Altamura et de la vallée du Dittaino. ↑
- J. Abecassis, janvier 1997, p. 12. ↑
- C. Willm, dans l’éditorial Résistance (à l’écrasement), janvier 1997, p. 1. ↑
- Jean-Paul Charvet, 1990, p. 15. ↑
- F. Baumgartner, p. 88. ↑
- R. Calvel, janvier 1995, p. 15, 16. ↑
- Jean-Pierre Devroey, 1993, p. 55. ↑
- Abbé François Rozier, 1784-1796, tome 5, p. 106. ↑
- C. Estienne et Jean Liebault, p. 533. ↑
- P.-J. Malouin, 1779, p. 18-19. ↑
- A. A. Parmentier, p. 116. ↑
- J.Le Couteur, p.36 à 45. ↑
- C.Vandenbroeke, p. 77 ; M.-J. Tits-Dieuaide, p. 135 et 142. ↑
- J. Bottin, p. 559, p. 562-563 ; J.-P. Blazy, p.138. ↑
- Dario Fossati et Marcel Ingold, p. 319. R. Dascotte, p. 11. ↑
- J.M.P. de Vilmorin, p. 48. ↑
- H. de Vilmorin, p. 54. ↑
- H. de Vilmorin, p. 86. ↑
- J.M.P. de Vilmorin, p. 20. ↑
- J.M.P. de Vilmorin, p. 22. ↑
- J.M.P. de Vilmorin, p. 46. ↑
- R. Goffaux, I. Goldringer, et col., p. 15. ↑
- J.M.P. de Vilmorin, p. 38. ↑
- Jacob Allen Clark, 1922, p. 92. ↑
- Jacob Allen Clark,, 1922, p. 64, 70, 93-95, 122, 150. ↑
- Patrick Shirreff, p. 2-97. ↑
- Yoanne Scottez et Th. Debailleul, p. 17. ↑
- Louis Amman, p. 70. ↑
- Wolfgang Porsche & Michael Taylor, p. 179 ; Basilio Borghi, p. 296 ; D. Soltner, 1987, p. 112. ↑
- Voir Stephan Symko ; Jacob Allen Clark et coll., 1922. ↑
- H. de Vilmorin, p. 54. ↑
- Aliéonor Bertrand, p.12. ↑
- P. Jonard, p. 9. ↑
- P. Jonard, p. 11-12. ↑
- Jean-Paul Charvet, 1990, p. 15-18, 56. ↑
- D. Soltner, p. 13 ; Jean-Paul Charvet, 1988. ↑
- Soltner, 1987, p. 101. ↑
- V. Rabaud. ↑
- J.-P. Charvet, 1988, p. 56. ↑
- D. Pecot, p. 33. ↑
- D. Soltner, 1987, p. 131. ↑
- Michel Deloingce, p. 2. ↑
- L. Ammann, p. 70-72. ↑
- R. Calvel, 2002, p. 162. ↑
- P. Jonard, p. 200-201. ↑
- R. Stegassy et J.-P. Bolognini, p. 170-171. ↑
- M.Rousset et J.Autran, Cnrs, 1979. ↑
- G. Branlard et collab., 1999, p. 5-8. ↑
- J. Abecassis et collab., 1993, p. 93. ↑
- Gyanendra Singh et collab., 2011. N. Mori et collab., 2013. ↑
- Pline, Histoire Naturelle, Livre 18, XXI. ↑
- Jean-Paul Charvet, 1985, p. 71 ; Corinne Beutler, p. 169. ↑
- Wilfried Seibel, 1988, p. 17 ; Heinrich Eduard Jacob, p. 301. ↑
- Werner Christian Simonis, p. 62-67. ↑
- Claude Macherel, p. 79 ; Jacques et René Mamnent. ↑
- Claude Macherel, p. 80-81. ↑
- Hubert Francois, p. 38-44 ; Dominique Soltner, 1987, p. 10 ; E. J. T. Collins, p. 132. ↑
- G. Svensson et A.Nilsson, p.128. ↑
- Sigrid Grosskopf, p. 65 ; Heinrich Eduard Jacob, p. 302. ↑
- Peter Rietzel, p. 46-47. ↑
- François Bellin, juin 2000. ↑
- A. Merlin et A.Y. Beaujour, p. 50. ↑
- La revue en ligne de www.edicom.ch news.suisse du 5 novembre 2002. ↑
- Site :www.paindeseiglevalaisan.ch ↑
- Site Wikipédia sur Ferdinand von Lochow ↑
- Michel Sandmeier, p. 18. ↑
- Peer Wilde, p. 37 ; Hartwig Geiger p. 25-39. ↑
- Alain Bonjean, 2018. ↑
- N. Vavilov, p. 64. ↑
- M. Del Curto, p. 87-89. ↑
- Myriam Deboeuf, p. 30. ↑
- Journal officiel, Le Moniteur Belge du 7 novembre 1985, arrêtés royaux relatifs à la farine (art.3, § 4) et aux pains et autres produits de boulangerie (art. 3, 6°). ↑
- Eckhard Rabe, 1988, p. 190. ↑
- Jacky Fischer, p. 22 ; Eckhard Rabe, 1988, p. 190. ↑
- Jacky Fischer, p. 22-30. ↑
- Eckhard Rabe,1988, p. 190. ↑
- Heinz Zwingelberg, 1988, p. 72-74 ; Michèle Populer, p. 204. ↑
- Wilfried Seibel, 1988, p. 22 ; Joe Ortiz, p. 166. ↑
- Hans-Dieter Ocker et Jörg Brüggeman, p. 11-25, 43-64. ↑
- Wilfried Seibel, 1988, p. 18-20. Directive 1415/69 du 22/07/1969 publié au Jour.Officiel de la CEE le 24/07/1969, p. 11. ↑
- Jalal Qarooni, p. 94-97. ↑
- Heinz Zwingelberg, 1988, p. 80 ; Otto Doose, p. 10-13. ↑
- Otto Doose ; Jurgen-Michael Brümmer et Holger Neumann, p. 169 ; Andrea Huppe et collab., p. 21. ↑
- Andrea Huppe et col., p. 6-7. ↑
- Stéphane Lacroix, p. 18-19. ↑
- Andrea Huppe et col., p. 6-7. ↑
- Otto Doose, p. 63. ↑
- Andrea Huppe et col., p. 124-189. ↑
- Arne Müntzing, p.13 à 30 ; Anne Bruneau, p.15 à17 ↑
- Anthony Wolff, 1976, p.6. ↑
- Philippe Joudrier, 2010, 260 pages. ↑
- Gaël Monnerat, p. 42 ; Anthony Wolff, p.15. ↑
- Encyclopédie citoyenne Wikipédia à l’article « Triticale » ↑
- A.A. Parmentier, 1779, p. 20. ↑
- F.Fleurat-Lessard, 2015, p.31 – 32. ↑
- Max Währen, p. 49 et 63. ↑
- Augustin François Villers, p. 132. ↑
- R. Calvel et Nuret, 1948. ↑
- Corrado Barberis et Graziella Picchi, 1995, p. 280-281. ↑
- Marianne Mesnil, 232 pages. ↑
- W. Seibel et W. Steller, 1993. ↑
- R. Calvel et Nuret, 1948. ↑
- M. Währen, p. 55, 63 et 65. ↑
- E. M. Péligot, p. 1, 2 du tiré à part. ↑
- Revue de Rete Semi Rurali de mai 2020. ↑
- M.Benoit et coll., p.169 à 173. ↑
- C. et H. Denaiffe, 848 pages ↑
- Gill Hyslot, 2022. ↑
- Stéphane Neron, 2009-2010, p. 5. ↑
- Freddy Vander Linden, p. 7. ↑
- GUT Fondation, mai 2004. ↑
- S.Kaplan, 2020, p.211 – 229. ↑
- Cathy Remilleux-Rast de l’Adiag (Association des intolérants au gluten), diapo 24. ↑
- Revue, Cœliac Info no 4, de la (Sbmc) Soc. belge de malades coeliaque, 1995, p. 5. ↑
- Aliénor Bertrand, p.33. ↑
- Revues Cœliac Info n°4 de 1988, p.13, revue n°2, p.5 & 6, revue n°3, p.8, revue n°4, p.9 de 1989 et revue n°4 de 1990, p.15. ↑
- Hetty Van Den Broek, p. 1527-1539. ↑
- Ruhong Cheng et Zhiping Dong, p. 87-89. et Alain Bonjean, 2010, p.5-6, dans Zhonghu He et Alain Bonjean . ↑
- Ibn Al Awan, tome 2, p. 76. ↑
- F. Sigaut, oct. 1994, p. 23-31. ↑
- G. Comet, 1992, p. 281 à 285. ↑
- Ibn Al Awan, tome 2, p. 76. ↑
- Roland Portère, p. 733. ↑
- Molly Gabaza et coll. ; F. Saubade et coll. ↑
- R. Drapron, 1994, p. 28-31. ↑
- Ababcar N’Doye, p. 25. ↑
- Martine Dugué, articles sur le site terramillet.com ; Ababcar N’Doye, p. 23-27. ↑
- B. Poirier, p. 12-16. ↑
- Martine Dugué, déjà cité. ↑
- B. Poirier, p. 15-16. ↑
- Raymond Calvel, janvier 1995, p. 15-16. ↑
- W. Seibel et W. Steller, p. 28-32, 99-102, 170-171, 264-274. ↑
- Site Wikipédia sur l’éleusine coracana ↑
- J.-P. Collaert, p. 605. ↑
- Julie Bourdin en juillet 2018 ↑
- M. Barboff, p. 859-874. ↑
- N. Vavilov, 2015, p. 71. ↑
- D.Guillet, p.425-426. ↑
- A.Gallais, 2015, p.26-27. ↑
- James Watson, p. 157. ↑
- C. Bonneuil et F. Thomas, 2009, p. 73 ; S.Kaplan, 2020, p.53. ↑
- C. Bonneuil et F. Thomas, 2009, p. 167, 168 ; Hervé Kempf, p. 11-15. ↑
- J.-P. Collaert, p. 498-501. ↑
- J.-P. Collaert, p. 512. ↑
- C. Willm, 1998, p. 381, 388. ↑
- M. Währen, p. 69. ↑
- Corrado Barberis et Graziella Picchi, 1995. ↑
- Antonio Attore et col., p. 50, 105, 132, 135, 184, 265, 271, 277, 304, 316. ↑
- Ricardo Garcia, 2015. ↑
- Hélène Zaharia et col., p. 15-48. ↑
- Laurence Dessimoulie, 2015. ↑
- Marie Astier, Reporterre oct. 2016 ; Agrobio Périgord, Du Maïs paysan dans votre assiette, 2016. ↑
- W. Kronberger (a), p. 124. ↑
- W. Kroneberg (a), p. 123, 124. ↑
- L. Delisle, p.324 ; J.Dalechamps, p.321. ↑
- C. Zewen et C. Ries (a), p. 132. ↑
- R. Wintsch, p. 144 ; W. Kronberger, p. 141-142 ; Jeanne Garenne. ↑
- U. Körber-Grohne p. 126. ↑
- S. Morand, p. 1, 9. ↑
- R. Lacour, p. 48, 49. ↑
- T. Delogne, p. 8. ↑
- P. et Y. Dejeammes, p. 20. ↑
- W. Kronberger (a), p. 123. ↑
- D. Meyer, p. 36. ↑
- P. et Y. Dejeammes, p. 20. ↑
- C. Zewen et C. Ries (b), p. 163, 164. ↑
- A. Maurizio, p. 198. ↑
- Peter Kurth, p. 130. ↑
- I. Kreft (d), p. 149. ↑
- C. Zewen et C. Ries (b), p. 165. ↑
- « La céréale de luxe est slovène », journal Vecer de Maribor, 1997. ↑
- H. Zwingelberg, p. 108. ↑
- H. Zwingelberg, p. 108 ; P. et Y. Dejeammes, p. 20. ↑
- P. et Y. Dejeammes, p. 19 ; C. Zewen (b), p. 171 ; W. Kronberger (b), p. 142. ↑
- I. Kreft (a), p. 15 ; Témoignage d’A. Heinskill ; H. Zwingelberg, p. 110. ↑
- C. Zewen et C. Ries (b), p. 169. ↑
- « La céréale de luxe est slovène », journal Vecer de Maribor, 1997. ↑
- Voir Le tour du Monde en 80 pains, catalogue de l’exposition réalisé par les élèves de CM2 de La Chapelle-sur-Erdre, milieu des années 1990. ↑
- S. Morand, p. 5 ; I. Kreft (a), p. 15. ↑
- E. Rabe, 1993, p. 244. ↑
- E. Kaiser, J.-C. Ribaut et F. Gambrelle, p. 39. ↑
- E. Kaiser, J.-C. Ribaut et F. Gambrelle, p. 102. ↑
- F. Lalos, p. 98-101. ↑
- J.-M. Brümmer, p. 173-174. ↑
- J.-M. Brümmer, p. 173. ↑
- J.-C. Ribaut et E. Kaiser, p. 42. ↑
- I. Kreft (a), p. 15. ↑
- I. Kreft (b), p. 48-50. ↑
- Valérie Cuppilard, p. 9. ↑
- Wikipédia à l’article Quinoa. ↑
- Sophie Calonne, p. 10-11. ↑
- anapqui.org.bo ↑
- Martine Pédron, 184 pages ↑
- J.-M. Brümmer et G. Morgenstern, p. 78-84. ↑
- Michelle Jeanguyot et Nour Ahmadi, p. 15. ↑
- Michelle Jeanguyot et Nour Ahmadi, p. 17- 20. ↑
- Michelle Jeanguyot et Nour Ahmadi, p. 30- 32. ↑
- J.-P. Collaert, p. 551-558. ↑
- N. Doboin et T. Teffri-Chambelland, p. 34. ↑
- G. P. Nabhan, p. 80. ↑
- J.-P. Collaert, p. 566-570. ↑
- Article Takaki Kanehiro sur Wikipédia. ↑
- Michelle Jeanguyot et Nour Ahmadi, p. 44. ↑
- Michelle Jeanguyot et Nour Ahmadi, p. 128 ; Article Riz sur Wikipédia. ↑
- W. Seibel et W. Steller, éd. Behr, 1993. ↑
- Anne Muratori-Philip, 405 pages. ↑
- Jean-Pierre Gourdain et Marie-France Maltzkorn, partie 9 de leur site. ↑
- A.A. Parmentier, 1777, 108 pages. ↑
- A.A. Parmentier, 1779, p. 4. ↑
- S.Kaplan, 2020, p.59. ↑
- Anne Muratori-Philip, 405 pages. ↑
- A. A. Parmentier, 1777, p. 84-85 et A. A. Parmentier, 1778, p. 576-577. ↑
- A. A. Parmentier, 1779, p. 27-44. ↑
- Daniel Lejeune, p.4. ↑
- A. A. Parmentier, 1778, p. 580-583. ↑
- P.W.Fouassier, p.99-100 ↑
- P.-J. Malouin, p. 236. ↑
- A. A. Parmentier, 1778, p. 553. ↑
- Mouvement Générations Cobaye, Et notre santé alors ?, 2015. ↑
- Tayo, 14-01-2016; Gill Hyslop, 04-2018. ↑
- Article Igname sur Wikipédia. ↑
- Philippe Roussel, 1998, p. 596-602. ↑
- R. Drapron et coll., 1979, p. 149-150. ↑
- R.Calvel, Mai-Juin, 1979 et R.Calvel, Décembre 1986. ↑
- A. Matagrin, p. 300-307. ↑
- A. Matagrin, p. 72-93. ↑
- Le Monde du 24/05/2012. ↑
- Fiche no 23 Lima-nouvelles. Le soya : un cadeau pour l’humanité, années 1980. ↑
- A. Matagrin, p. 11, 220-228. ↑
- Bruno Guéhin et col., p.118. ↑
- Bruno Guéhin et col., p.121. ↑
- M. Ferzli, p. 9. ↑
- Marie-Pierre Arvy, p. 192-194. ↑
- Marie-Pierre Arvy, p. 170-172. ↑
- Piero Camporesi, p. 197. ↑
- Adam Maurizio, p. 68-88. ↑
- Adam Maurizio, p. 68, 88. ↑
- J. R. Harlan, p. 17-20. ↑
- R.Dodoens et Ch.L’écluse, 1557, p.319. ↑
- N. Bas , I.Berentschot, D.Heerkens, T.Jennissen, p.13. ↑
- A. Maurizio, p. 326-333. ↑
- J.-P. Collaert, p. 609-613. ↑
- P.-J. Malouin, 1779, p. 150-154. ↑
- Jakub Łuczaj Łukasz et col., 2012. ↑
- Adam Maurizio, p. 77-82. ↑
- P.-J. Malouin, 1779, p. 150-154. ↑
- Denis-Michel Thibault, 2017. ↑
- Article sur Thinopyrum intermedium dans Wikipédia. ↑
- Denis-Michel Thibault, 2017. ↑
- Gill Hysop, 2018. ↑
- Christian Rémésy, 2020 b, p.141 ; Christian Rémésy, 2002, p.99 à 118. ↑
- Christian Rémésy, 2020 b, p.141. ↑
- Marie-Pierre Arvy, p. 25-26. ↑
- Marie-Pierre Arvy, p. 45. ↑
- Anonyme, mai 1987, p. 18-19, juin 1987, p. 18-20 et juillet 1987, p. 18-20. ↑
- Marie-Pierre Arvy, p. 258. ↑
- Aliénor Bertrand, p.25. ↑
- Robert De La Taille, p. 80. ↑
- Robert De La Taille, p. 118-120. ↑
- Marie-Pierre Arvy, p. 151, 162. ↑
- Robert De La Taille, p. 165. ↑
- Marie-Pierre Arvy, p. 284. ↑
- Anonyme, mai 1987, p. 20. ↑
- H.U. Grimm, 2004, p.167. ↑
- A. Cornu, F. Delpeuch et J.-C. Favier, p.349 à 364. ↑
- Revue Industries des céréales, n° 205 de décembre 2017. ↑
- Bruno Guéhin et col., p.117. ↑